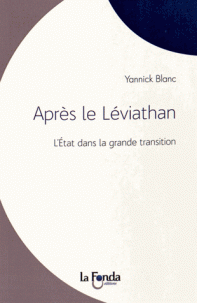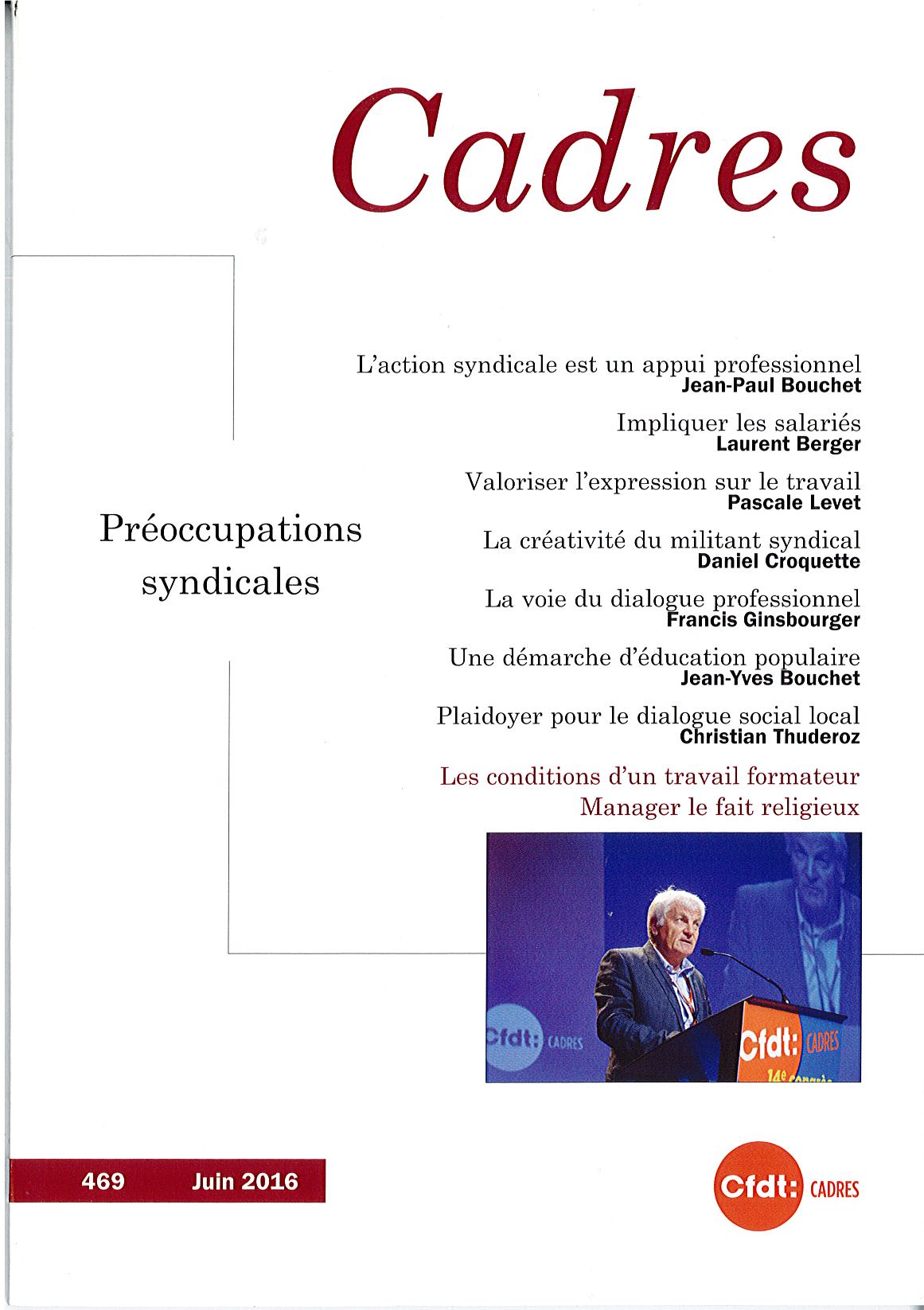L’auteur nous invite à repenser l’Etat. « Ce Léviathan démembré gît désormais devant nous, encore impressionnant par sa masse et par la complexité de son anatomie mais dépourvu de force et de mouvement ». Construit sur le modèle d’une « matrice tutélaire », cet État a accompagné la sécularisation de notre société. La possibilité du vivre ensemble est réalisée au prix d’un consentement à un abandon de souveraineté individuelle.
Aujourd’hui, dans une société d’individus, le consentement et l’engagement des citoyens ne sont plus acquis par l’acceptation d’une tutelle. Le monopole du savoir légitime, de l’un qui sait mieux que l’autre ce qui est bon pour lui, est révolu. L’exigence d’une possibilité et d’une capacité de parcours lui succède. Pour autant, une société d’individus ne veut pas dire la possibilité d’individus sans société. La possibilité et le respect de parcours individuels exigent une société forte, démocratique, intégrée et régulée, une société dont les différents niveaux sont « emboîtés ». L’individu institué, encore faut-il qu’il trouve des formes également instituées et cohérentes de familles, de collectifs, d’entreprises, de territoires, d’ensembles intégrés au niveau national, voire supra national.
C’est bien sûr l’enjeu d’une capacité de l’administration des fonctions régaliennes adossées au fameux monopole de l’exercice légitime de la violence. Très au-delà, c’est l’enjeu de l’immersion quotidienne des services de l’État dans des niveaux d’actions très hétérogènes ; la santé, l’habitat, la mobilité, l’emploi, la prévention, la protection, la sécurité, le développement des territoires... Si, comme l’auteur le démontre, le levier de l’action ne peut plus se résumer à l’exercice d’une domination au nom d’une transcendance, celle de la Nation ou de la République, quel peut en être un principe alternatif ?
L’auteur refuse ainsi d’attendre la victoire des « tyrannies » qui menacent de combler l’espace laissé vacant. L’affaissement d’un médiateur universel ouvre en effet la voie à l’hystérie identitaire et à « l’émiettement des tribus ». Il déchaîne la concurrence des institutions et avec elle, la suspicion grandissante à l’égard des représentations politiques au profit de la représentation médiatique, non démocratique et diversement influencée. Il s’agit alors de rendre possible et de promouvoir une puissance publique à nouveau capable d’agir et de faire agir, à défaut de pouvoir encore exercer une tutelle, serait-elle bienveillante.
L’auteur mobilise la réflexion de John Dewey sur la crise démocratique des États-Unis des années vingt. Il emprunte la conception anthropologique de l’Etat comme conséquence de l’action. L’action de l’État consiste toujours à énoncer des règles, à définir les limites des actions des individus et des communautés pour en canaliser les conséquences non calculables. Mais ce ne sont plus des commandements, ce sont des conditions de gouvernance instituées, organisant l’emboîtement de ces interactions ou associations. L’auteur dit ensuite sa dette à Gaston Berger et l’invention de la prospective en France en 1955, créateur d’une « une éthique de la connaissance tournée vers l’action ». En résonance avec la démarche de l’enquête, il insiste sur la nécessité, dans le contexte de panne politique, d’un investissement dans ce domaine.
Sommes-nous condamnés à l’entropie juridique, à l’anomie par excès et à l’incohérence des règles ? L’auteur s’adosse sur cette question aux enseignements qu’il tire de Wittgenstein, de Reynaud et de Dworkin. Il défriche la possibilité d’institutions (de règles) qui n’ont besoin, ni d’un sens caché ou révélé, ni d’un sens indépendant de notre volonté mais qui seraient le fruit de notre pratique et de nos délibérations.
Vient ensuite la question de la définition de l’acte élémentaire « d’être en commun, de mettre en commun, d’avoir en commun ». L’auteur convoque ici les travaux d’Elinor Ostrom pour cerner des pistes méthodologiques d’une institution de l’action collective. Il met en exergue un cadre d’analyse et une « grammaire des énoncés » dont il fait l’hypothèse de la fécondité pour penser l’institutionnalisation d’ensembles plus vastes, plus grands que celui de la gouvernance des « communs ».
Au-delà d’un pari sur la « reliance » ainsi activée, il voit dans le « moment associatif » (Yannick Blanc préside la Fonda) bien plus qu’un palliatif, mais un principe d’action et de ré-emboîtement de la société. « Agir est de plus en plus synonyme du mot s’associer ». « A l’emboîtement vertical des institutions déterminé par l’ordre symbolique, on substitue un emboîtement horizontal » permis par l’intégration de communautés d’action formées par les individus grâce à un langage commun et non par l’assignation des places et la subordination.
Le lecteur non initié aux questions de la science politique ou administrative trouvera matière à penser bien au-delà de l’État et de l’action publique. Il aborde les questions de la famille, de l’entreprise, de l’école, des quartiers..., également concernés par l’effondrement de la matrice tutélaire. Les enjeux que connaissent l’entreprise et le management sont éclairés d’une lumière nouvelle. C’est précisément dans le dés-emboîtement des principes d’autorité verticale que se lisent aussi les impasses du management. Les enjeux liés à l’édiction de règles nouvelles, d’une capacité d’action retrouvée par la maîtrise d’une grammaire innovante sur les organisations et les relations..., concernent très directement l’entreprise et le management. La lecture de Yannick Blanc sur l’État est ainsi un analyseur des impasses du modèle industriel, de l’incapacité à intégrer les externalités négatives environnementales et sociales, de la maltraitance du travail, de l’« infobésité » et de la financiarisation.
Il faut faire l’expérience d’une plongée dans cette pensée incarnée et résolument optimiste sans irénisme.