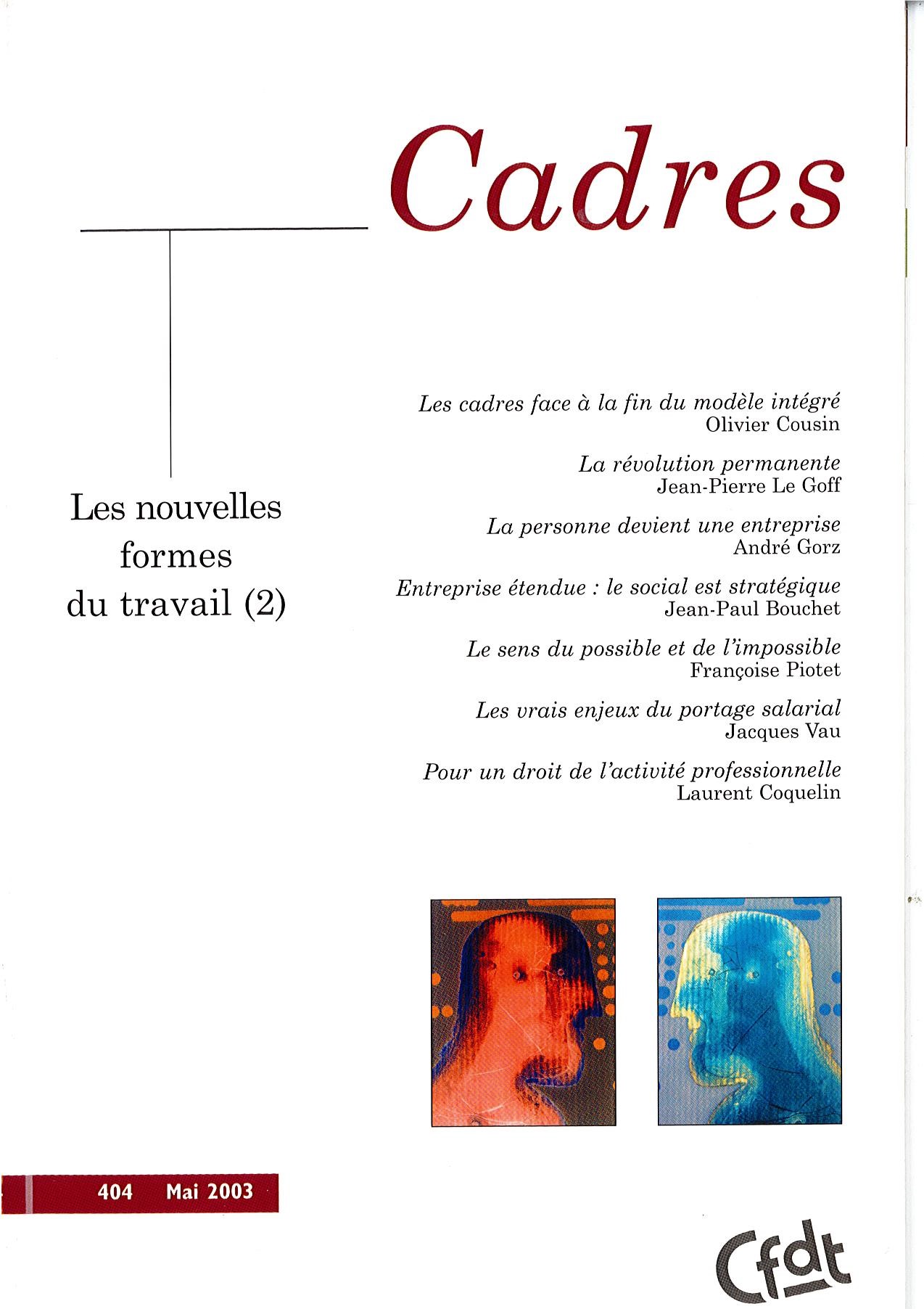Pour tenter de comprendre quelle place occupe le travail pour les cadres et saisir le sens qu’il acquiert, il faut tenir compte du lien particulier qui existe entre les cadres et les organisations. Le travail des cadres peut être défini à partir de trois dimensions qui s’ordonnent de manière singulière. Schématiquement, être cadre, c’est combiner une place particulière dans une entreprise, généralement définie par une forte intégration liée à une position hiérarchique ; un type de travail, caractérisé par une fonction d’un certain niveau de responsabilité ; et une image sociale, qui se traduit le plus souvent par la réussite et la promotion, résumées dans la notion de carrière. Dans la construction de l’image sociale du groupe des cadres, ces trois dimensions sont en étroite relation. Elles forment un système clos, résumé par la formulation suivante : plus l’intégration à l’entreprise est forte et plus l’identification à la fonction est grande, alors plus l’image de soi est positive et forte, donc plus les perspectives de carrière prennent de réalité. Ce modèle, qu’on appellera par convention « intégré », repose en partie sur la notion de loyauté réciproque. Plus les cadres sont intégrés et fidèles, plus l’entreprise permet le déroulement des carrières. Réciproquement, plus l’entreprise prend en charge la gestion de leur carrière, plus les cadres cherchent l’intégration1.
Ce modèle n’a jamais existé à l’état pur : il faut le lire comme une construction théorique, comme un modèle de référence, qui a néanmoins assez largement dominé l’univers du travail jusque dans les années 802. Depuis, il connaît des variantes et ne se présente plus comme un système clos. La défection s’est substituée à la loyauté, donnant un autre sens au travail. Le propre des nouvelles organisations du travail est d’introduire de l’incertitude à travers les notions de flexibilité, d’employabilité, d’individualisation des traitements et des carrières et la nécessité de se prendre en main. L’intégration et la loyauté ne sont plus des piliers nécessaires et suffisants pour construire une carrière. Au regard du modèle intégré, dans le lien qui unissait les cadres à leur entreprise, les rôles s’inversent. Ce n’est plus l’organisation qui gère la carrière des individus, mais ces derniers qui doivent la prendre en charge3. La gestion de sa carrière devient une activité en soi et l’intégration peut même parfois apparaître comme un obstacle à son bon déroulement. Un nouveau modèle se dessine : les trois dimensions du rapport au travail sont toujours là, mais leur articulation se transforme. Elles peuvent être appréhendées comme des épreuves relativement indépendantes. Par exemple, l’intégration à l’entreprise reste une nécessité, mais ne commande pas nécessairement l’activité ou le niveau de responsabilité, ou ne les garantit pas.
Pour comprendre les changements qui affectent les cadres et le sens qu’ils donnent à leur travail, il faut partir des mutations structurelles qui animent aujourd’hui les entreprises. Certes, les logiques du système n’ont pas un effet mécanique sur les acteurs. Les cadres disposent de marges de manœuvre et d’action, et le sens qu’ils donnent à leur travail varie selon les dimensions qui le structurent. Pour le dire autrement, ils ne disent pas et n’éprouvent pas la même chose quand ils parlent de leur entreprise, de leur activité ou de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. C’est en ce sens qu’on parlera de l’expérience du travail4 : une expérience qui varie selon les contextes, les situations et les parcours des individus. Cette approche permet de surmonter l’idée de crise.
L’affaiblissement de l’intégration
L’organisation du travail a connu des changements importants depuis deux décennies. Les logiques de planification ont été délaissées au profit de structures souples, capables de s’adapter aux aléas du marché. Les cadres partagent les grandes lignes de ce changement sans nécessairement y adhérer pleinement et sans toujours s’y reconnaître. Ils n’en sont pas les acteurs, ils le subissent. Mais ce n’est pas le changement en tant que processus qui modifie le lien à l’entreprise. Ce sont les repères qui se transforment et créent une plus grande distance entre eux et leurs organisations. L’entreprise devient opaque (qui dirige, où s’arrêtent ses frontières ?) et finalement les cadres se réfèrent plus souvent aux départements, aux services, ou à l’unité dans lesquels ils travaillent. L’entreprise, sa politique et ses stratégies perdent de leur consistance et rares sont ceux qui en ont une vision d’ensemble.
Les cadres restent attachés à leur entreprise, mais ils savent que la fidélité et la loyauté ne sont plus des ressources stratégiques. Dans le modèle intégré, les cadres, comme les organisations, ont intérêt à jouer la loyauté ; quand le modèle s’affaiblit, cette carte n’a plus la même valeur. L’entreprise devient le lieu où se tissent les réseaux, un lieu d’opportunité où, en fonction de leurs ressources propres (parcours, formation initiale, type de diplôme…), ils tenteront des coups. C’est pourquoi la défection, comme stratégie, prend le pas sur la loyauté qui n’est plus suffisante5. A l’extrême, l’entreprise n’apparaît que comme un tremplin et n’a de sens qu’en fonction des opportunités qu’elle offre. Si cette stratégie est rarement revendiquée et assumée, elle est régulièrement évoquée, par exemple quand la presse spécialisée évoque les plans de carrière des jeunes cadres.
Le passage de la loyauté à la défection n’est pas le simple résultat d’un changement de comportement d’hommes et de femmes simplement soucieux de tirer leur épingle du jeu. Elle résulte du brouillage d’un système qui prône le risque et l’instabilité, quand quelques années plus tôt la stabilité était une vertu. Cette logique conduit les cadres à mettre à distance les relais institutionnels. A l’égard de leurs directions, les cadres manifestent une forme d’éloignement. Ils s’y reconnaissent d’autant moins qu’elles deviennent inaccessibles et impersonnelles. Dans de nombreux cas, ils ne sont pas en mesure de savoir et de comprendre qui gouverne, tant la figure du patron s’est diluée dans celle de l’actionnaire, du marché, du conseil d’administration… A l’égard des syndicats, le phénomène est du même ordre, mais pour des raisons différentes. Les cadres ne s’y reconnaissent guère, car dans un contexte qui privilégie l’engagement, la responsabilité et la prise de risque, toute référence à une prise en charge collective est perçue comme une entrave à l’action individuelle. En d’autres termes, ils estiment qu’il est plus bénéfique d’entretenir des réseaux et de gérer individuellement les situations que de passer par une action collective qui est toujours appréhendée comme un nivellement par le bas, ou qui finalement reste incertaine.
Le délitement de la loyauté ne signifie pas que les cadres deviennent déloyaux. Il serait plus juste de dire qu’ils se libèrent d’un poids, ou plus exactement qu’ils sont libérés d’un poids puisque cette rupture n’est pas de leur fait. Ce sont les entreprises qui ont coupé le « cordon ombilical », obligeant les cadres à devenir pleinement acteurs de leur destinée. De la même façon, l’intégration et la fonction occupée ne sont plus forcément liées. Cela peut se comprendre : la différence de ce qui se passait dans le modèle intégré, il n’y a plus de garantie de réciprocité.
Les nouvelles organisations du travail modifient en partie la rôle et la fonction des cadres dans l’entreprise. Ils étaient les relais d’une politique, devant veiller aux respects des procédures ; ils deviennent des animateurs, chargés de coordonner des équipes en vue d’atteindre des objectifs. L’obligation de moyens cède le pas devant l’obligation de résultat.
L’autonomie, valeur traditionnelle du monde des cadres, se voit ainsi mise en valeur. Elle se conjugue sous différents registres : autonomie dans l’organisation du travail, en particulier dans la gestion de son emploi du temps, autonomie dans la capacité à négocier sa charge de travail, en particulier quand il s’agit des objectifs où les délais, par exemple, peuvent être parfois discutés. Autonomie, enfin, dans le rapport au travail où les cadres, parce qu’ils sont très investis, donnent parfois l’impression de travailler pour eux-mêmes comme s’ils étaient leur propre patron. On pourrait ainsi discuter si ce n’est pas le sentiment d’autonomie, plus que l’autonomie elle-même, qui est mis en jeu.
Contrainte et autonomie
L’autonomie réelle reste en effet limitée, car elle s’inscrit dans un univers où la contrainte est forte. Les cadres sont soumis à un système de contrôle et d’évaluation permanent. L’obligation de résultat les oblige à rendre des comptes et les soumet à une pression constante. Ils s’organisent comme ils le veulent mais ils doivent être performants dans un temps qui s’est notablement contracté depuis l’application de la loi sur la réduction du temps de travail. L’autonomie se paie, et se paie cher puisque la frontière entre le travail et le hors travail est de plus en plus poreuse. La question qui se pose est de savoir qui en garde la maîtrise. Il en va ainsi, par exemple, du travail emporté le soir ou de la possibilité d’être joint grâce aux téléphones mobiles et aux ordinateurs portables. Les cadres autonomes sont des cadres dépendants.
Les contraintes s’exercent surtout à travers les procédures d’évaluation, qui deviennent un enjeu central. Ces procédures concernent moins les résultats à atteindre que la gestion de la carrière. Ici l’incertitude domine. Car si de mauvais résultats hypothèquent largement toutes chances de promotion, de bons résultats ne garantissent rien. En effet, dans un système qui se réfère de moins en moins à des grilles de qualification et à l’avancement à l’ancienneté, bref à une gestion codifiée, les critères deviennent flous et aléatoires. Les cadres doivent être performants, innovants, s’engager, et mettre leurs compétences au service de leur travail. Mais ces critères sont parfois sans limites et relèvent dans bien des cas de jugements subjectifs. Par ailleurs, dans bien des cas, l’évaluation est soumise à un système de quotas, ce qui signifie que l’engagement n’est pas nécessairement récompensé, car les places à distribuer sont moins nombreuses que les candidats.
Les cadres peuvent se retrouver dans ce système, mais il les place dans une situation de grande tension : ne sachant pas quels seront les critères pertinents et quel sera le résultat de l’évaluation, ils sont obligés de s’engager sans relâche, et de se surinvestir.
Ainsi, et en comparaison avec le modèle intégré, la relation entre l’intégration à l’entreprise et l’activité exercée est faible. Tout se passe comme si ces deux dimensions étaient indépendantes, au sens où elle n’ont pas besoin nécessairement de s’alimenter. L’efficacité et la responsabilité des cadres ne sont pas liées à leur intégration à l’entreprise, mais à leur qualité propre et à leur volonté d’être à la hauteur. La relation entre le travail et la carrière s’érode, puisque l’obtention de résultat n’offre plus de garanties suffisantes.
Carrière et identité
Etre cadre implique de se situer dans la perspective d’une mobilité professionnelle et sociale. A la différence de nombreux salariés, les cadres ont vocation à changer de postes, d’activités et de fonctions. Ils exercent moins un métier que des responsabilités, appelées à s’accroître au fil des années. Dans le modèle intégré, ces responsabilités sont en grande partie gérées et orchestrées par l’entreprise, en retour de l’investissement et de la loyauté du cadre. Quand ce modèle s’affaiblit, c’est à l’individu de prendre en main une carrière relevant d’un projet personnel. Cette démarche est au principe même du délitement du modèle intégré ; la défection devient alors un des instruments privilégiés de la construction de carrière6.
Prendre en main sa carrière est valorisant : cela revient à s’affirmer comme le maître du jeu. Optant pour une gestion individuelle de leur carrière, les cadres agissent comme des entrepreneurs, mettant en œuvre diverses stratégies qui leur garantissent de rester compétitifs. La gestion de la carrière est en soi un travail, une mission à réussir et où rien ne sera laissé au hasard. Ainsi, ce n’est pas seulement l’entreprise qui gomme la frontière entre le travail et le loisir, mais les cadres eux-mêmes qui entretiennent le flou, car rester connecté devient une nécessité. Sous cet angle, les cadres retirent de nombreux bénéfices d’un système apparemment ouvert et malléable et leur trajet ressemble à une longue ascension.
En contrepartie, cette logique a un coût. Les cadres réussissent à condition de ne jamais lâcher prise. Ils sont pris dans une course permanente, où toute pause est perçue comme définitive. En d’autres termes, les cadres ne courent pas seulement pour avancer, mais aussi pour ne pas chuter. Et comme ils sont pris dans ce système qu’ils défendent et où les filets de sécurité sont réduits au minimum, ils ne peuvent en définitive compter que sur eux-mêmes, sur une constante relance de leur investissement et de leur engagement – que cette relance se joue dans une seule entreprise ou dans plusieurs. Cette relance, par ailleurs, est un élément nécessaire, mais pas suffisant. La carrière n’est pas seulement le résultat d’un investissement personnel, elle reste très largement conditionnée par le niveau de formation initial et par le type de diplôme obtenu. Ainsi, alors que les cadres revendiquent le mérite et l’effort, leur itinéraire sera balisé d’avance, selon un schéma surdéterminé par leur scolarité. Quand on parle de carrière professionnelle, on devrait intégrer cette étape initiale discriminante qu’est la carrière scolaire.
Ce système n’est supportable qu’à la condition d’introduire un troisième élément, trop souvent évacué ou occulté. Le travail n’est pas commandé par la seule logique instrumentale, il est aussi un élément de satisfaction personnelle. Les cadres travaillent et s’investissent car cet engagement est au cœur de leur identité. Le travail et l’investissement étayent profondément le sentiment d’existence, et plus ils montent dans la hiérarchie, plus ce sentiment est fort et devient le moteur de l’engagement. Les cadres se sortent plutôt bien de cette épreuve, mais on comprend quels enjeux se cachent sous la peur de l’échec qui se manifeste soit par la menace du placard, soit par la mise à l’écart pour les seniors : ce n’est pas seulement une trajectoire professionnelle qui est en jeu, mais l’identité personnelle et plus profondément le sentiment d’exister. Dans les faits, la carrière se joue sur un laps de temps assez court puisque à partir de 45 / 50 ans les espoirs de promotions s’amenuisent en dehors de la catégorie des cadres dirigeants. La contraction de leur carrière, les incertitudes quant à sa gestion et le poids du diplôme initial donnent donc à cette dimension les allures d’une dramaturgie où les chances de gagner sont réelles, mais où rôde le spectre de l’échec.
Conclusion
La rupture du contrat de confiance met en exergue la nécessité de gérer sa carrière et transforme le rapport au travail. Dans le modèle intégré, ce sont pour l’essentiel les logiques du système qui s’imposent aux individus et guident ou bornent leurs actions. Les acteurs ont des marges de manœuvre qu’ils puisent dans un stock fourni en très grande partie par les entreprises. Dans une logique de « désinstitutionalisation », c’est-à-dire quand le système ne gère plus formellement les carrières mais impose la mobilité, quand il ne privilégie plus l’intégration mais pousse à la défection, ce sont les acteurs qui doivent donner du sens à leur action et prendre en main leur destinée. Le rapport au travail devient une expérience dans le sens où il est le produit de ce que les individus y mettent, de leur capacité à lui donner de la cohérence là où elle n’est pas apparente. L’analyse du rapport au travail des cadres d’aujourd’hui repose donc sur l’hypothèse d’une dissociation des trois dimensions structurant le modèle intégré ; l’insertion dans l’entreprise, l’activité exercée et la carrière comme mode de formation de soi. L’expérience du travail pour les cadres s’appuie sur leur capacité à les articuler.
Les deux premières dimensions, celles où finalement les logiques du système sont les plus présentes et les plus visibles, sont à la fois les plus contraignantes et celles où l’incertitude est la plus faible. En effet, l’organisation reste un univers circonscrit. Les cadres n’adhèrent pas nécessairement à la politique et aux stratégies de leur entreprise, ils se sentent parfois coupés de leur direction, mais l’entreprise reste une réalité dans laquelle ils se reconnaissent et à laquelle ils s’identifient. De même, leur fonction reste très largement définie par leur degré d’autonomie et de responsabilité, en dépit des contraintes croissantes pesant sur le travail, des modalités de contrôle qui s’intensifient et de l’obligation de résultat qui devient la norme. Ces deux dimensions n’échappent qu’en partie aux cadres parce qu’ils en maîtrisent encore les règles du jeu, et le système garde une part de visibilité. Ainsi, leurs marges de manœuvre restent conséquentes.
En revanche, les repères sont plus complexes à propos du troisième axe qui s’organise autour de la gestion de leur carrière. Tout d’abord, parce qu’il n’y a plus de liens immédiats entre l’intégration à l’entreprise, l’identification à une fonction et la construction d’une image de soi. Ensuite, parce que l’identité se joue sur un autre registre. Il y a un changement de repère et de point d’appui. Ce n’est plus l’organisation qui sert de point d’ancrage mais soi-même. C’est la raison pour laquelle l’incertitude est beaucoup plus importante et déstabilisante pour les acteurs. D’un côté, les cadres par leur investissement et le plaisir qu’ils retirent de leur travail se construisent une image positive d’eux-mêmes. Cette image est d’autant plus forte qu’elle s’appuie sur leurs propres ressources. Ils sont les acteurs de leur destinée. D’un autre côté, cette réussite reste fragile. Elle est hantée par la peur de chuter ou de stagner, de ne pas faire les bons choix aux bons moments et de ne pas être à la hauteur. Les cadres offrent donc une représentation d’eux-mêmes ambiguë et complexe. Ils sont sûrs d’eux, source de leur grandeur, tout en étant hantés par l’échec et par le vieillissement, signe d’une remise en cause de leur identité au travail.
1 : Ce modèle correspond à ce que Paul Bouffartigue nomme le salariat de confiance (voir à ce sujet Les Cadres. Fin d’une figure sociale, Paris, La Dispute, 2001, et Cadres : la grande rupture, Paris, La Découverte, 2001.
2 : Luc Boltanski et Guy Groux en tracent les contours tout en soulignant déjà son déclin (L. Boltanski, Les Cadres. La formation d’un groupe social, Paris, Editions de Minuit, 1982 et G. Groux, Les Cadres, Paris, La Découverte, 1983).
3 : Une formule résume bien cette nouvelle culture : on attend aujourd’hui des cadres qu’ils soient « entrepreneurs de leur carrière ».
4 : J’utilise ici la notion d’expérience dans le sens que lui a donné F. Dube (Sociologie de l’expérience, Seuil, 1994, et Le Déclin des institutions, Seuil, 2002, pour une application de ce concept à l’univers de travail).
5 : Les notions de loyauté et de défection renvoient aux travaux d’A. Hirschman, Défection et prise de parole (Fayard, 1995).
6 : Ainsi, d’après l’étude Cadroscope menée par l’Apec en 2001, changer d’entreprise est la voie la plus sûre pour progresser en salaire (l’augmentation serait de l’ordre de 15% en moyenne), et c’est également un moyen plus sûr que les promotions internes pour accéder à un poste plus élevé hiérarchiquement.