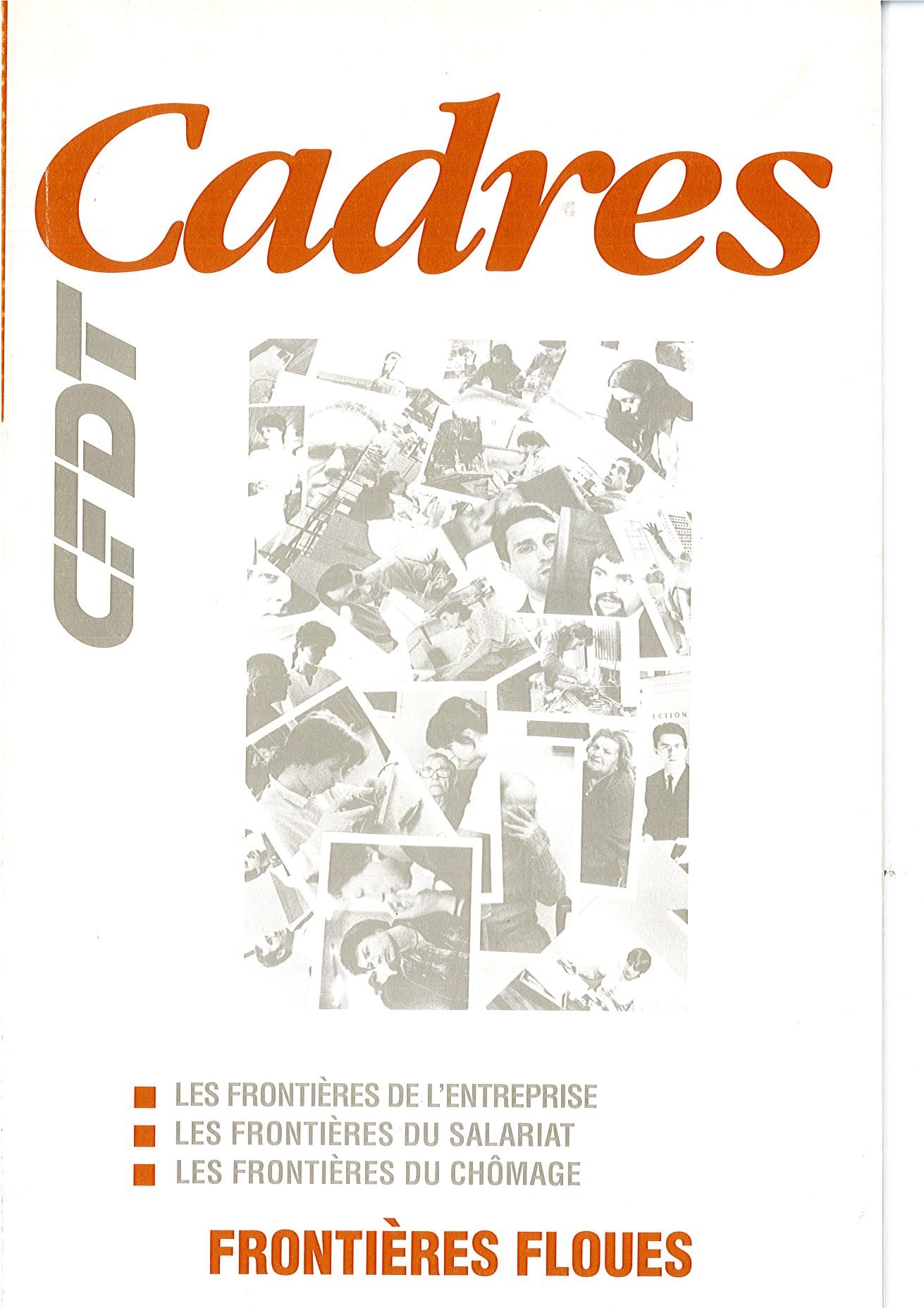En dix ans, le nombre de journalistes payés à la pige est passé de moins de 7 % à près de 15 % de l’effectif. Mais ce chiffre, en constante augmentation, est en fait sous-évalué car calculé sur les seuls titulaires de la carte de presse. Il faut aussi compter avec les confrères engagés en CDD, avec ceux rémunérés - illégalement - en droits d’auteur ou en honoraires, et même avec ceux qui, sous prétexte de stage ou de « numéro zéro » ne sont pas payés du tout. Certains journaux, parfois d’excellente réputation ou cités en exemple pour leur rigueur gestionnaire, fonctionnent avec une majorité de pigistes et ne salarient régulièrement que leur hiérarchie, réduite quelquefois à une seule personne.
Tous ces « statuts » de précarité ont en commun de maintenir un vivier de journalistes extrêmement « motivés », disponibles en permanence, et évidemment payés en conséquence, c’est-à-dire moins que les autres, à compétence égale. Ainsi, le pigiste-rédacteur est payé au feuillet. Le minimum syndical - de moins en moins respecté - étant fixé à un peu plus de 300 F brut, il faut ainsi que le pigiste décroche et rédige quelque quarante-trois feuillets mensuels pour atteindre un salaire de 14 000 F brut, salaire qui n’est pas excessif pour un cadre. Or, ce rendement typographique est sensiblement supérieur à la production moyenne des rédacteurs mensualisés. Autant dire que beaucoup de pigistes touchent environ le SMIC et fréquentent régulièrement l’ANPE.
Le journalisme à la pige recouvre une importante diversité de situations, elles-mêmes permises par une réglementation complexe et ambiguë. A l’origine, « la pige » est la rémunération d’un travail commandé par un média à un journaliste extérieur. Certains journalistes, dits encore « indépendants » ou « free lance », qui disposent d’une notoriété acquise après de longues années de pratique, gagnent ainsi confortablement leur vie, mais ils ne constituent qu’une minorité. Ils s’identifient parfaitement à des travailleurs indépendants, surtout lorsqu’ils emploient un salarié ou s’associent entre eux pour monter une agence.
Beaucoup plus nombreux en revanche sont ceux qui doivent s’épuiser à courir d’un titre à un autre pour décrocher une commande ou un remplacement, ou encore se disperser entre deux ou trois employeurs plus ou moins réguliers. Ce purgatoire est pourtant la voie d’accès fréquente au plein statut journalistique, qui se maintient souvent deux ou trois ans, et parfois plus, avant que la priorité d’embauche reconnue formellement aux pigistes déploie son effet intégrateur. Et cela même pour ceux qui sortent d’une école idoine.
Pour d’autres, licenciés après des années d’emploi régulier, « la pige » est le complément habituel des indemnités de chômage qu’ils peuvent continuer à toucher, à condition de ne pas dépasser un seuil fatidique. Cette situation les rapprocherait assez du statut, enviable par comparaison, des intermittents du spectacle.
Enfin, il y a tous ceux qui travaillent régulièrement, parfois à plein temps, disposent d’un bureau et même de tickets-restaurant. C’est le cas notamment des maquettistes et secrétaires de rédaction dont l’activité doit obligatoirement s’exercer au siège du journal, mais aussi de rédacteurs, photographes, reporters ou preneurs d’images, souvent ceux que l’on envoie en première ligne lors des conflits armés pour ramener des scoops au péril de leur vie. On voit mal alors, hormis le salaire, les avantages sociaux et la fragilité du statut, ce qui différencie ceux que l’on appelle au choix « pigistes permanents » ou « journalistes non permanents » de leurs confrères.
Vrai indépendant, intérimaire, tâcheron, grouillot, intermittent ou salarié de seconde classe, les figures du pigiste sont, on le voit, multiples. Il dispose cependant de quelques avantages sur d’autres formes de contrats dits « atypiques ». D’abord, c’est un journaliste, une qualité que lui confère sa carte professionnelle. A ce titre, sa « responsabilité vis-à-vis du public prime toute autre, en particulier à l’égard de ses employeurs et des pouvoirs publics », comme le stipule la déclaration des droits et devoirs des journalistes. Bien sûr, le « lien de subordination » du journaliste à l’organe de presse qui l’emploie est une autre réalité, en général plus décisive. Car, on le conçoit, les pigistes ne sont pas les mieux armés pour résister aux pressions des annonceurs ou ignorer les « suggestions » de leur hiérarchie. Ensuite, le journaliste est un cadre, redisons-le, même si cette qualité n’intervient pratiquement que pour déterminer la chambre des prud’hommes compétente pour régler un conflit.
Journalistes à part entière, les pigistes sont donc des salariés qui bénéficient pleinement de toutes les conséquences juridiques attachées à ce statut et notamment la convention collective, le régime de retraite de l’ANEP, le régime général de la Sécurité sociale, ainsi que d’une loi spécifique à la profession, la loi Cressard 1. Ainsi, le fait que les pigistes réguliers ne signent pas de contrats les fait considérer juridiquement comme bénéficiant d’un contrat tacite, à durée indéterminée qui plus est. En cas de licenciement, leurs employeurs doivent donc leur verser les indemnités légales. Idem en cas de réduction progressive et important des piges que la jurisprudence analyse comme un licenciement. Il reste cependant que ces textes, qui contiennent d’excellents principes, ne donnent pas toujours aux pigistes le moyen efficace de les faire appliquer.
Au total, les pigistes ne sont que des journalistes non mensualisés, souvent isolés par ce sceau désobligeant du reste de leurs rédactions et, par ce fait aussi, souvent en peine de faire valoir leurs droits. Leur précarité sera encore accrue par la suppression annoncée des déductions fiscales dont ils bénéficiaient comme tous leurs confrères. Or, si une catégorie de journalistes a bien besoin de cette aide pour couvrir ses frais de documentation et autres, ce sont bien les pigistes.
1 : La loi Cressard, adoptée en 1974, a octroyé un statut légal et juridique aux collaborateurs réguliers d'une rédaction. Parmi les principales dispositions, la reconnaissance d'un « lien de subordination » qui ouvre aux pigistes les mêmes avantages que les journalistes en place : mutuelle, ancienneté, ticket-restaurant.... La loi Cressard a également fixé minimums conventionnels et barèmes. En 1974, cette loi était destinée à aider les rédactions à « fidéliser » ses collaborateurs. Aujourd'hui, les pigistes ont souvent les plus grandes peines du monde à la faire appliquer.