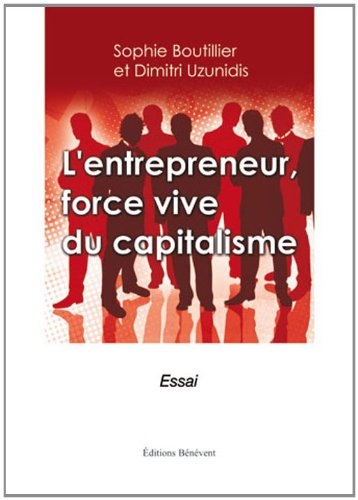On raconte que l窶册x-Prテゥsident George W. Bush aurait dit un jour : ツォ Regardez les Franテァais, ils n窶冩nt mテェme pas de mot dans leur langue pour dire ツォ entrepreneur ツサ ! ツサ. S窶冓l lit le livre (pas trop long !) de Sophie Boutillier et Dimitri Uzinidis, tous deux professeurs テ l窶儷niversitテゥ du Littoral Cテエte d窶儖pale, l窶册x-prテゥsident amテゥricain y apprendra au contraire, que les テゥconomistes franテァais, notamment Jean-Baptiste Say (1787-1832) ont テゥtテゥ les premiers テ longuement analyser le rテエle de l窶册ntrepreneur dans l窶凖ゥconomie. Leurs idテゥes ont d窶兮illeurs traversテゥ l窶僊tlantique avec un grand succティs tout au long du XIXティme Siティcle.
La figure de l窶册ntrepreneur et de l窶兮uto-entrepreneur, notamment en France, oテケ ツォ l窶僞ntrepreneuriat Assistテゥ par l窶僞tat ツサ est dテゥclinテゥ sous toutes ses coutures, reprテゥsente dans ce livre la force vive du capitalisme. Cette force est テ la fois solitaire, quand elle mobilise son potentiel de ressources propres, et collective quand elle tire parti de rテゥseaux de proximitテゥ multiples et variテゥs. Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis テゥlargissent le domaine d窶兮nalyse, qui est loin d窶凖ェtre entiティrement couvert par la recherche en sciences sociales et humaines, en proposant des passerelles transversales entre l窶凖ゥconomie et la sociologie.
La premiティre partie de ce court ouvrage rテゥcapitule la lignテゥe des テゥconomistes qui voyaient en l窶册ntrepreneur le ツォ deus ex machina ツサ du capitalisme. Une bonne quinzaine d窶兮uteurs sont prテゥsentテゥs ainsi que la maniティre dont ils ont approfondi la rテゥflexion sur l窶册ntrepreneur ツォ hテゥroテッque ツサ. Sans lui, nous dit-on, l窶冓nnovation et le progrティs techniques n窶兮uraient pu s窶冓ncarner dans les biens de consommation et la croissance. Les regards portテゥs par les テゥconomistes sur les entrepreneurs sont toujours admiratifs. De Jean-Baptiste Say (1803) pour qui la ツォ capacitテゥ de jugement ツサ est dテゥterminante dans le succティs de l窶册ntrepreneur, テ Mark Casson (1991), pour qui le dテゥsir de prouver que son jugement est correct est au cナ砥r de la motivation entrepreneuriale, en passant par Schumpeter, Knight, Hayek et quelques autres, les テゥconomistes s窶册nthousiasment pour la dynamique du crテゥateur d窶册ntreprise, d窶册mploi, de marchテゥ et de demande solvable. Il ne faut pas s窶凖ゥtonner alors si la rテゥflexion politique et sociale s窶兮pproprie l窶册ntrepreneuriat considテゥrテゥ comme l窶冰ne des solutions possibles au chテエmage.
La deuxiティme partie pose la question de savoir si l窶冩n peut reproduire la logique entrepreneuriale sous l窶凖ゥgide de l窶僞tat. La discussion sur ツォ l窶僞ntrepreneuriat assistテゥ par l窶僞tat ツサ, illustrテゥe par le cas franテァais, en particulier, dテゥvoile un aspect de ce qui pourrait テェtre un recul de l窶僞tat social face テ la crテゥation d窶册ntreprises. L窶册ntrepreneur autonome permet le dテゥsengagement de l窶僞tat-Providence : on passe d窶冰ne sociテゥtテゥ salariale テ une sociテゥtテゥ entrepreneuriale. Mais alors comment faire cohabiter les grandes entreprises et les petites ? En effet, les premiティres engendrent frテゥquemment les secondes, avec l窶兮ide de l窶僞tat, pour mieux les phagocyter quand celles-ci passent le seuil de rentabilitテゥ. Il existe lテ une ツォ aliテゥnation entrepreneuriale ツサ qu窶冓l faut テゥlucider, notamment en cas d窶凖ゥchec. Ceci fait l窶冩bjet de la partie suivante.
La troisiティme partie nous mティne aux conditions テ remplir pour devenir entrepreneur. Dans ce genre d窶册xercice il est toujours difficile de distinguer clairement ce qui est nテゥcessaire et dテゥterminant pour assurer le succティs. Le ツォ potentiel de ressources ツサ que Sophie Boutillier et Dimitri Unizidis nous rテゥsument est une base d窶兮touts d窶冩テケ l窶冩n sait bien que l窶册ssentiel est encore absent ou invisible. En effet, les ressorts mentaux, comme la capacitテゥ de rテゥsister テ la frustration de l窶凖ゥchec, par exemple, s窶冓nscrivent dans un contexte institutionnel. Au-delテ de l窶僞tat national, aujourd窶冑ui les institutions multilatテゥrales (UE, OCDE, ONU,窶ヲ) traitent de cette question de l窶册ntrepreneuriat pour en ツォ mondialiser ツサ le concept et en faire un outil de dテゥveloppement. Ce thティme est liテゥ au dテゥveloppement actuel de l窶兮uto-entrepreneuriat, en France.
Enfin, une quatriティme partie rテゥhabilite les idテゥes de proximitテゥ et de milieu entrepreneurial, qui reviennent en force aujourd窶冑ui dans nos rテゥgions. Alfred Marshall (1919) parlait d窶卍ォ atmosphティre industrielle ツサ propice テ l窶冓nnovation entrepreneuriale. Peut-テェtre faut-il maintenant regarder du cテエtテゥ du Sud-Est asiatique pour approfondir la recherche dans ce domaine ?
Ce livre stimulant peut faire l窶冩bjet de trois remarques.
On nous dit (page 42) que les syndicats sont テ l窶冩rigine du chテエmage parce qu窶冓ls ツォ imposent un taux de salaire trop テゥlevテゥ ツサ. Indirectement donc, ils favorisent la crテゥation d窶册ntreprise en la prテゥsentant comme seule issue au chテエmage. On pourrait aussi bien dire テ l窶冓nverse, qu窶册n luttant pour la hausse du pouvoir d窶兮chat, ils テゥlargissent les dテゥbouchテゥs et les opportunitテゥs de crテゥation d窶册ntreprise. En cas de plan social, par exemple, les indemnitテゥs de licenciement forment un apport en capital.
Autre remarque : (page 32) Keynes (1883-1946) dテゥnonce le comportement ツォ peureux ツサ des entrepreneurs qui rテゥduisent leurs activitテゥs en pテゥriode de crise, contribuant ainsi テ l窶兮ggraver et テ rendre nテゥcessaire l窶冓ntervention de l窶僞tat. Cela suggティre aussi qu窶册n temps d窶册xpansion, les entrepreneurs qui accroissent leurs activitテゥs favorisent la croissance. Mais alors quels sont les ressorts qu窶冓ls mettent en ナ砥vre ? Et pourquoi cela se transforme-t-il en crise ?
Ce qui nous mティne テ la troisiティme remarque.
Si l窶冩n en croit la loi de Say, dont toute la science テゥconomique est tributaire, ツォ les marchandises s窶凖ゥchangent contre des marchandises ツサ テ l窶冩rigine desquelles se trouvent les entrepreneurs. Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis nous rappellent, テ propos de Lテゥon Walras (1834-1910) que ツォ l窶册ntrepreneur vend pour son propre compte ツサ (page 19). Mais si les entrepreneurs doivent attendre que leurs marchandises soient vendues pour recevoir leurs profits, comment s窶凉 prennent-ils pour acquテゥrir des marchandises pour eux-mテェmes en attendant ? Ils sont exclus de la consommation de ce qu窶冓ls mettent sur le marchテゥ car c窶册st de la vente de ce qu窶冓ls ont produit テ d窶兮utres qu窶凖 eux-mテェmes qu窶冓ls tirent leurs profits.
Les marchandises ne s窶凖ゥchangent donc pas que contre des marchandises. Il est nテゥcessaire que dans la sociテゥtテゥ un entrepreneur prenne l窶冓nitiative de faire une avance sur ses profits pour pouvoir acheter une marchandise. Comme tous les entrepreneurs sont dans la mテェme situation il en dテゥcoule que la demande solvable des entrepreneurs provient, non pas des ventes pour leur propre compte, mais des avances qu窶冓ls se font テ eux-mテェmes. La thテゥorie de l窶册ntrepreneur de Say et de ses successeurs ne prend jamais en compte l窶册xercice de la capacitテゥ de jugement appliquテゥe au calcul des avances. Or, c窶册st lテ que se trouve l窶冩rigine du profit capitaliste : pendant l窶册xercice de production, les acomptes des uns font les bテゥnテゥfices des autres. Autrement dit, le caractティre salvateur de l窶册ntrepreneur rテゥside dans le risque qu窶冓l prend, aprティs avoir dialoguテゥ avec lui-mテェme, de (se) payer ses profits d窶兮vance. Il ne sait pas ce que font les autres entrepreneurs parce que l窶凖ゥconomiste ne le lui dit pas mais il s窶册n doute et il l窶册spティre. Et si ses espoirs sont dテゥテァus, c窶册st la surproduction-dテゥflation, quoiqu窶册n dise la loi de Say. Ainsi, la dialectique de l窶册ntrepreneur, thテゥorisテゥ par Say, rテゥfute la loi des Dテゥbouchテゥs, thテゥorisテゥe par le mテェme Say. Et si la loi de Say est rテゥfutable, c窶册st qu窶册lle est scientifique.
Pour conclure, si l窶册ntrepreneur est une force vive, comme le disent Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis, ce n窶册st pas seulement dans la sphティre de la production et de l窶冓nnovation, qu窶冓l faut en chercher les sources, c窶册st aussi dans la sphティre financiティre, oテケ les initiatives (risquテゥes !) viennent renforcer la demande sans laquelle l窶冩ffre ne trouve pas preneur. Bien des ressorts cachテゥs animent le ツォ deus ex machina ツサ. L窶凖ゥconomiste doit dテゥbusquer ceux qui ont une influence sur l窶冩ffre et la demande.