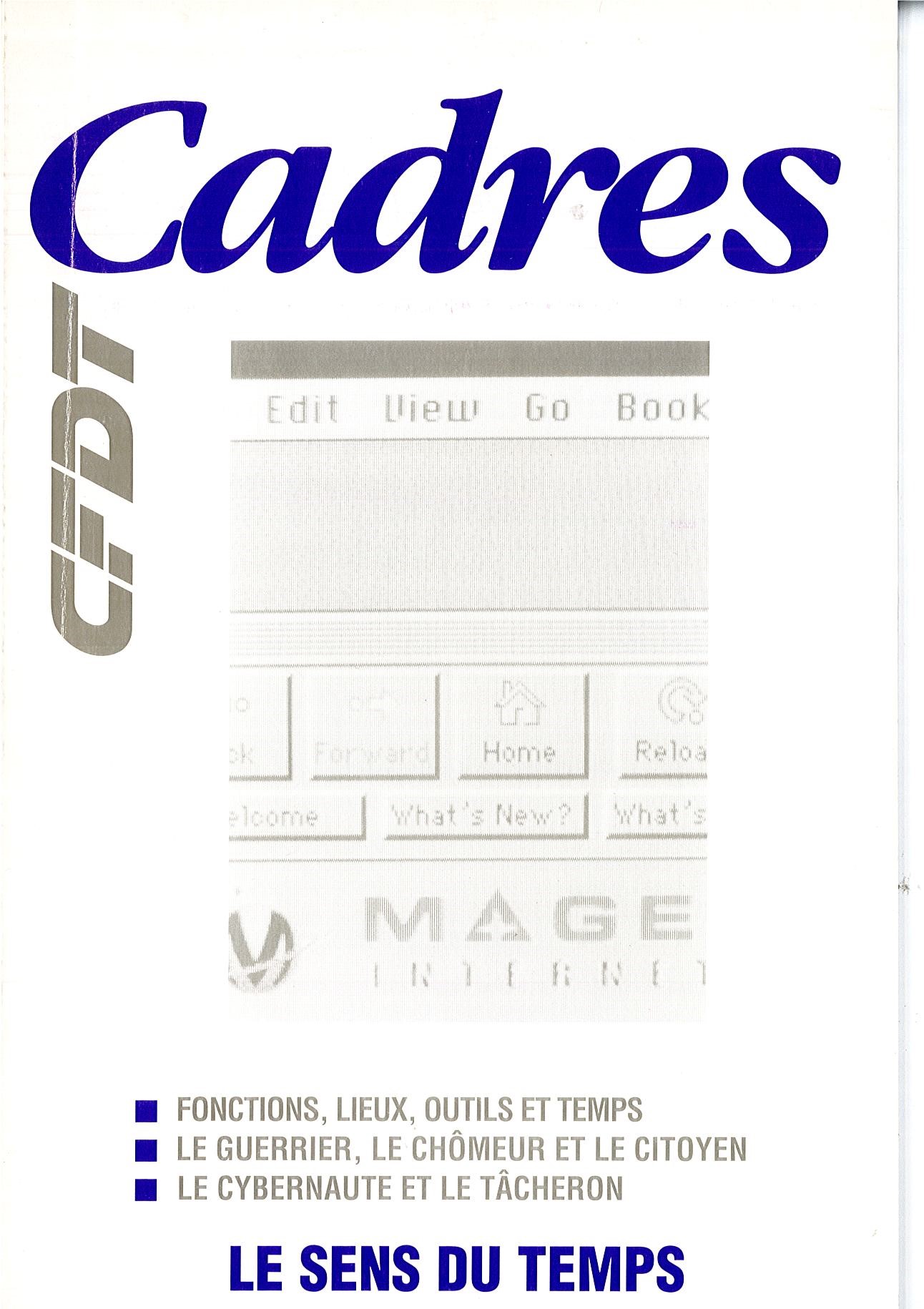Le club « École de Paris » organisait le 20 mai une soirée sur le thème « l’entreprise, la cité et la guerre économique », dont l’intervenant central était Michel Berry, directeur de recherches au C.N.R.S. et principal animateur de l’École de Paris.
Dans son ouvrage de 1930, intitulé « Perspective économique à l’usage de nos petits-enfants », John Maynard Keynes se demandait ce qu’il adviendrait de nos sociétés si la richesse était multipliée par huit. Il craignait une « dépression nerveuse universelle » et concluait que les pays les mieux placés pour y échapper seraient ceux où existait un certain art de vivre.
Chômage, exclusion, violence à l’école, solitude des personnes âgées, drogue... nos sociétés vivent une crise de sens, dit Michel Berry. Face à la crise, on demande à l’entreprise d’embaucher plus, d’intégrer mieux, on demande à l’école de se rapprocher de l’entreprise : ce sont des attentes déraisonnables. La cité attend beaucoup trop de l’entreprise, elle ne doit pas lui laisser le monopole du sens.
Les macro-économistes disent qu’il faudrait une croissance de 6 % par an pour diminuer le chômage de moitié en dix ans ; or nous connaissons actuellement des taux de croissance de 2 % par an et une productivité qui s’accroît de 3 % par an. Cela signifie que la croissance ne constitue pas la réponse au chômage. Les optimistes disent que les marchés mondiaux sont infinis et qu’ils ouvrent donc des perspectives pour les entreprises françaises. Certes, mais perspectives pour les entreprises françaises ne signifie pas nécessairement création d’emplois en France, les entreprises ayant intérêt à produire sur place avec de la main d’œuvre locale.
Les micro-économistes proposent de changer les arbitrages capital/ travail en diminuant le coût de ce dernier par des allégements de charges et des primes à l’embauche. Cela a été fait par les différents gouvernements et cela n’a eu que peu d’effet sur l’emploi. Les modèles économiques ne tiennent pas compte du fait que les entreprises ne se préoccupent plus du coût du travail. Les entreprises sont sous pression, elles se composent de plus en plus d’un noyau dur entouré de sous-traitance, elles font appel à la délocalisation, le droit commercial remplace le droit du travail. Les entreprises ont besoin de capitaux, elles vont à la recherche d’actionnaires, ces derniers sont exigeants et exercent une forte pression sur l’entreprise. Les entreprises sont engagés dans une course à la réduction d’effectifs et à l’augmentation de la productivité, particulièrement les entreprises « opéables ». Elles sont de plus en plus exigeantes envers le personnel. Certains proposent la suppression du SMIC. Mais les entreprises cherchent des durs et les gens mal payés ne sont pas à la hauteur des enjeux. Une baisse du SMIC n’aurait d’utilité que pour les services de bas de gamme.
La réduction du temps de travail est considérée par beaucoup comme une solution au problème de l’emploi. Il y a des idées ingénieuses sur le plan local et incitatif : suppression des cotisations Assedic, modulation des charges. Ces idées sont mal vues dans les entreprises compétitives qui valorisent le stress et renâclent à embaucher. Le temps de travail est un repère de moins en moins pertinent. Dans les systèmes bureaucratiques, les personnes ont une obligation de moyens ; dans la vie en réseau, ellels ont une obligation de résultat. La réduction du temps de travail est adaptée aux industries tayloriennes et aux services standardisés mais ces secteurs sont globalement en déclin. Ou alors il faut donner tellement de sens au temps passé hors de l’entreprise que la réduction du temps de travail deviendra une revendication même de ceux qui travaillent beaucoup. Car les arguments en faveur de la réduction du temps de travail (mettant l’accent sur la possibilité qu’elle offre d’ouvrir l’entreprise à plus de personnes) ont l’effet inverse : ils conduisent à une survalorisation de l’entreprise.
Les activités associatives ainsi que le bénévolat sont interdites au demandeur d'emploi qui, condamné à chercher un emploi qui n'existe pas, sombre dans un état délétère. « C’est proprement ne rien valoir que n’être utile à personne » disait déjà Descartes. Dans la guerre militaire, on honore les blessés, dans la guerre économique on les humilie.
La crise du lien social doit conduire à s’interroger sur les diverses modalités de la production de sens. L’entreprise produit du sens : elle donne une identité sociale, elle permet des liens avec d’autres personnes ; quand on quitte l’entreprise, on n’a plus de contacts. Pourtant le sport, le jeu, l’animation de jeunes, la culture produisent du sens.
Le chômage est aussi dramatique qu’il l’est en raison de la place prédominante qui est prise par l’entreprise. Et si on changeait de perspective ? Face à la crise, l’urgence est de multiplier les activités productrices de sens.
Michel Berry propose donc de mettre des chômeurs - sur la base du volontariat - à disposition des associations d’utilité collective. Ils continueraient à toucher leurs indemnités, augmentées de dix pour cent et échappant à la dégressivité. Ceci serait financé par l’État, qui supprimerait par ailleurs une partie des aides à l’emploi, et par les recettes propres. Ces associations devraient recevoir un agrément pour éviter une concurrence déloyale. L’obsession de la création d’emplois sans chercher le sens conduit au gaspillage. Activer les dépenses sociales est une bonne idée mais il faut que cela fasse sens.
Saurons-nous faire cette révolution pacifique ? Il faut de nouvelles articulations entre les entreprises et le reste de la société. Honneur aux militaires, honneur aux civils.
Pierre-Noël Giraud , professeur à l’école des Mines, présente son propre diagnostic sur le chômage : dans les pays riches englobés dans la mondialisation, se produit une polarisation entre compétitifs d’un côté, protégés de l’autre. Les compétitifs produisent des biens et services pour l’économie mondiale, les protégés des biens et services qui ne peuvent pas voyager. Cette distinction est totalement différente de la distinction qualifiés non qualifiés : un ouvrier qui fait des boutonnières dans le Sentier est un compétitif, un professeur de droit constitutionnel est un protégé. Le compétitif vit dans le danger de ne plus l’être, dans le stress, le travail intensif ; le protégé vit dans le danger qu’on n’ait plus besoin de lui. Dans un territoire donné, s’il y a des compétitifs assez nombreux et assez riches pour que leur demande permette de faire vivre les protégés, il n’y a pas de chômage, c’est le cas de la Suisse. S’il n’y a pas assez de compétitifs ou s’ils ne sont pas assez riches, leurs demande est insuffisante et il y a du chômage. Dans ce cas, pour créer des emplois, il faut que la demande des compétitifs aux protégés augmente. Si le nombre des compétitifs est constant, il faut que le prix des biens et services protégés diminue. L’arbitrage des compétitifs entraînera alors des embauches dans les entreprises protégées. Il faut donc baisser les coûts des biens et services protégés, ce qui permettra un reversement du travail domestique vers le travail marchand. Les seules personnes qui ne bricolent pas chez elles sont les hyper-compétitifs, car il faut être très riche pour payer un plombier. Si le coût de celui-ci diminue, il y aura plus d’externalisation et augmentation de la demande de plomberie. C’est ce qu’on observe aux États-Unis.
Il n'est que partiellement d'accord avec Michel Berry quand celui-ci dit que les entreprises ne peuvent pas créer d’emplois : c’est vrai des entreprises compétitives, pas des entreprises protégées. Mais si nous sommes sur un territoire où il n’y a pas assez de compétitifs, ou pas assez riches, il faut pour créer des emplois un accroissement des inégalités de revenu. Il faut choisir entre deux types d’inégalité, l’inégalité par le chômage ou l’inégalité des revenus.
Philippe d’Iribarne, directeur de recherche au C.N.R.S. est d’accord sur le fait qu’on peut choisir entre le chômage ou la pauvreté, comme l’ont fait l’Europe et les États-Unis. Il est aussi d’accord avec l’importance des questions de sens mais il présente une objection concernant les activités porteuses de sens : elles ne sont valorisées que pour ceux qui sont dans une position secondaire (femmes au foyer, immigrés...). Une idée est profondément ancrée dans notre culture : celui qui ne gagne pas sa vie n’est pas à la hauteur des autres, ce n’est qu’un citoyen de seconde zone.
Les raisons qui font que les solutions de recherche de sens hors travail font difficulté sont les mêmes que celles du chômage.
La société devrait accepter de donner du sens à des activités non professionnelles. Etre blessé à la guerre est le signe qu’on s’est battu. Etre blessé à la guerre économique est le signe qu’on a perdu.
L’état de guerre économique, considéré par Michel Berry comme un fait, est bien une donnée dans l’état actuel des choses, la religion de notre temps (quand l’O.C.D.E. parle des sacrifices nécessaires, on pense aux sacrifices humains offerts aux dieux) mais une question se pose. Est-il plus facile de donner du sens aux perdants de la guerre économique (ce qui conduit à la remise en cause de nos mythes fondateurs) ou de remettre en question la religion de cette guerre ?
Michel Berry se demande si nous allons revenir à la Grèce antique dans laquelle les citoyens s’adonnaient aux plaisirs de la discussion pendant que les esclaves travaillaient. Aujourd’hui, ce seraient les compétitifs qui seraient dans la position des esclaves grecs, juste retour des choses.