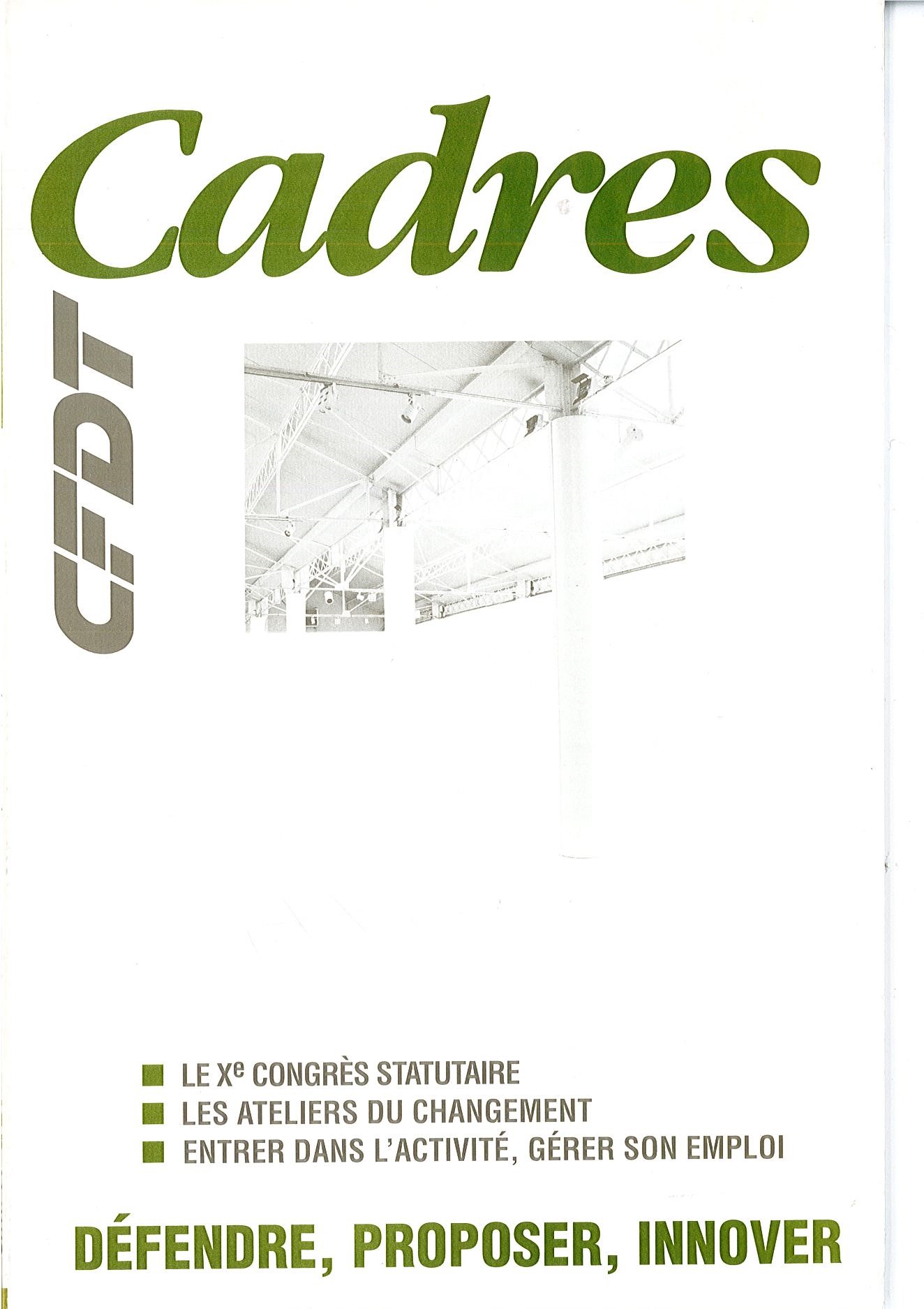Cet ouvrage constitue le n° 2/97 des « cahiers d’Evry » édités par l’Université d’Evry Val d’Essonne (e-mail : cpn@socio.univ-evry.fr). Sous-titré « Tentative de construction d’un objet sociologique », il commence par un préambule intitulé « pour l’imagination sociologique fondée en raison », à réserver strictement aux sociologues professionnels. Heureusement, le corps du texte est accessible aux amateurs, c’est-à-dire à ceux qui s’intéressent à l’entreprise et à la société sans pour autant nécessairement maîtriser le langage et les références de la discipline universitaire qui en a fait ses objets.
L’hypothèse centrale est la définition des entreprises comme « l’une des modalités d’organisation de la population », qui est à la fois « une configuration de production, de distribution et de consommation » et « une alliance contrainte entre propriétaires, dirigeants, encadrement, exécution des entreprises de production et de distribution, et consommateurs », processus « à la fois structuré et structurant pour et dans l’ensemble de la société, sans qu’on puisse mettre cette dernière à côté ou en face de ces configurations qu’il faut par contre articuler à d’autres activités sociales qui sont en partie distinctes ».
Les entreprises ne sont pas toutes sur le même modèle « il y a ainsi des entreprises plutôt incluantes, participatives et républicaines, d’autres plutôt ségrégatives, excluantes et dominatrices » mais « les orientations majoritaires ne sont pas exclusives, chaque entreprise est un compromis instable entre plusieurs tendances combinées (...) l’entreprise n’est pas un acteur collectif homogène qui marche d’un seul pas, mais une configuration structurée par des rapports de forces représentés par des sujets en chair et en os, où les décisions des uns peuvent être contrecarrées par la résistance ou l’inertie des autres. De ce fait les dirigeants ne sont pas les seuls « décideurs » et ne doivent pas être confondus avec la totalité de l’entreprise . (...) Les entreprises sont des combinaisons de multiples composantes, qui fonctionnent selon un double mouvement de concentration et d’externalisation. Condensés de la société, elles exercent aussi des effets en retour de plus en plus puissants sur la société ». Cette idée, déjà présente chez Durkeim et Weber, était reprise par Naville, elle est faite sienne par Mispelblom.
L’entreprise est donc un acteur politique, le lecteur en est convaincu en lisant cet ouvrage, qui ouvre des perpectives de réflexion très stimulantes. Citons quelques extraits qui nous semblent particulièrement intéressants :
A propos de la gestion
« Le refus de participer à la gestion et à l’organisation des entreprises, qui fut une attitude assez systématique (du moins au niveau national) de syndicats comme FO ou la CGT, pourrait bien être encore une façon d’y participer quand même, en « laissant faire ». C’est ce qu’ont conclu même certains responsables syndicaux, et une certaine modification est ici en train de s’opérer. Des sociologues n’hésitent pas à parler des représentations « marxo-tayloriennes » qui caractériseraient des organisations syndicales, pointant les logiques et orientations transversales reliant syndicats et patronat dans divers domaines. Loin d’exister côte à côte en toute autonomie, l’interdépendance entre dirigeants et responsables syndicaux, organisations patronales et syndicales, implique au contraire que les uns se positionnent toujours en référence aux autres et se constituent réciproquement. Collaboration et coopération doivent donc être analysées sur différents plans, (...) la négociation du consentement des salariés, obtenu auparavant principalement par les salaires et les contraintes des moyens de production, est devenue aujourd’hui un enjeu tel qu’il provoque l’invention de toutes sortes de dispositifs spécifiques ayant pour but la négociation du consensus et de l’adhésion. Mais avant même qu’il y ait des « projets d’entreprise », usines et magasins avaient leur « esprit maison », dont les salariés se réclamaient ».
Un capital moins nomade qu’on ne le croit
« Le capital financier, qui passe facilement d’un secteur à l’autre mais reste généralement très discret, qui a certes une influence décisive sur la vie de millions de gens liés à chaque secteur, se fait représenter dans chacun d’entre eux par des dirigeants qui doivent tenir compte de la spécificité de chaque production de biens ou de services dont la liaison avec les salariés et consommateurs comporte sa logique propre. Peut-être même ne faut-il pas exagérer le caractère « apatride » du capital financier, qui est peut-être moins indifférent aux spécificités des industries ou services dans lesquels il est investi, qu’on ne le croit ; A l’exception éventuellement des capitaux spéculatifs, les représentants des capitaux investis dans des fabrications et des services sont aussi liés entre eux et aux dirigeants d’entreprise par des alliances diverses, des liens de famille, des amitiés et des obligations. Eux aussi aiment plutôt tel pays ou telle région, telle industrie locale ou telle culture d’entreprise, considèrent l’image de marque dans laquelle ils investissent, et en tiennent compte dans leurs décisions qui ne sont jamais purement financières, purement comptables ».
Entreprise et souveraineté
« La question du chômage concerne très directement la souveraineté, et menace le pouvoir des gouvernements, car aucun d’entre eux n’a encore réussi à imposer aux entreprises d’embaucher, alors que les effets des licenciements menacent directement la cohésion sociale, par exemple par l’intermédiaire de la montée d’un parti comme le Front National. Les conflits d’orientation, les normes de vie et les conditions d’existence qui se forgent dans et à travers les entreprises constituent les conditions sociales « de base » sur lesquelles les luttes proprement politiques s’appuient ».
Les syndicats et la gestion
« Les politiques patronales divisent aussi les organisations syndicales, comme en témoignent les divergences entre la CGT et la CFDT. Car les syndicats ont du mal à se positionner vis-à-vis de démarches mais aussi de nouvelles revendications qui concernent le contenu même du travail, son organisation et sa gestion. Autant il est aisé d’unifier le personnel sur la base d’une demande d’augmentation de salaire égale pour tous, autant il est difficile de surmonter les divisions qui traversent chaque catégorie de salariés à propos des manières de travailler et de s’y investir, de résister aux stratégies patronales de participation ou de s’y laisser prendre. Les syndicats en sont partagés entre des stratégies de refus, de participation et de détournement. Là encore, la politique, comme mouvement d’opposition d’intérêts et de conception du monde, donne aujourd’hui le ton, en se moquant en partie des clivages institutionnels traditionnels. Car les transformations en train de s’opérer mettent finalement en cause le terrain des « revendications économiques » sur lequel les organisations syndicales ont été bâties. La mise à nu des dimensions idéologiques et politiques des entreprises transforme de fond en comble les significations habituelles du travail, car cela rapproche la sphère de la production de celle de la consommation, le travail du hors-travail, l’économie du reste de la société ».
(Ici, nous nous permettrons un petit reproche à l’égard de l’auteur : il n’a jamais été aisé d’unifier le personnel sur la base d’une demande d’augmentation de salaire égale pour tous : certains (salariés et syndicats) préféraient x % pour tous et d’autres y francs pour tous. Et ce n’est pas du tout la même chose).
La vraie nature du management
« Le management renforce donc certaines valeurs contre d’autres, dans et en dehors du travail. Il s’agit d’un dispositif de pouvoir. Mais celui-ci n’est pas omnipuissant, contrairement à ce que les promoteurs du management prétendent parfois, inversement ce n’est pas non plus de la simple « poudre aux yeux » comme le pensent un certain nombre de ses critiques, dont des sociologues. Il constitue au contraire un enjeu, un terrain de confrontation bien réel ».