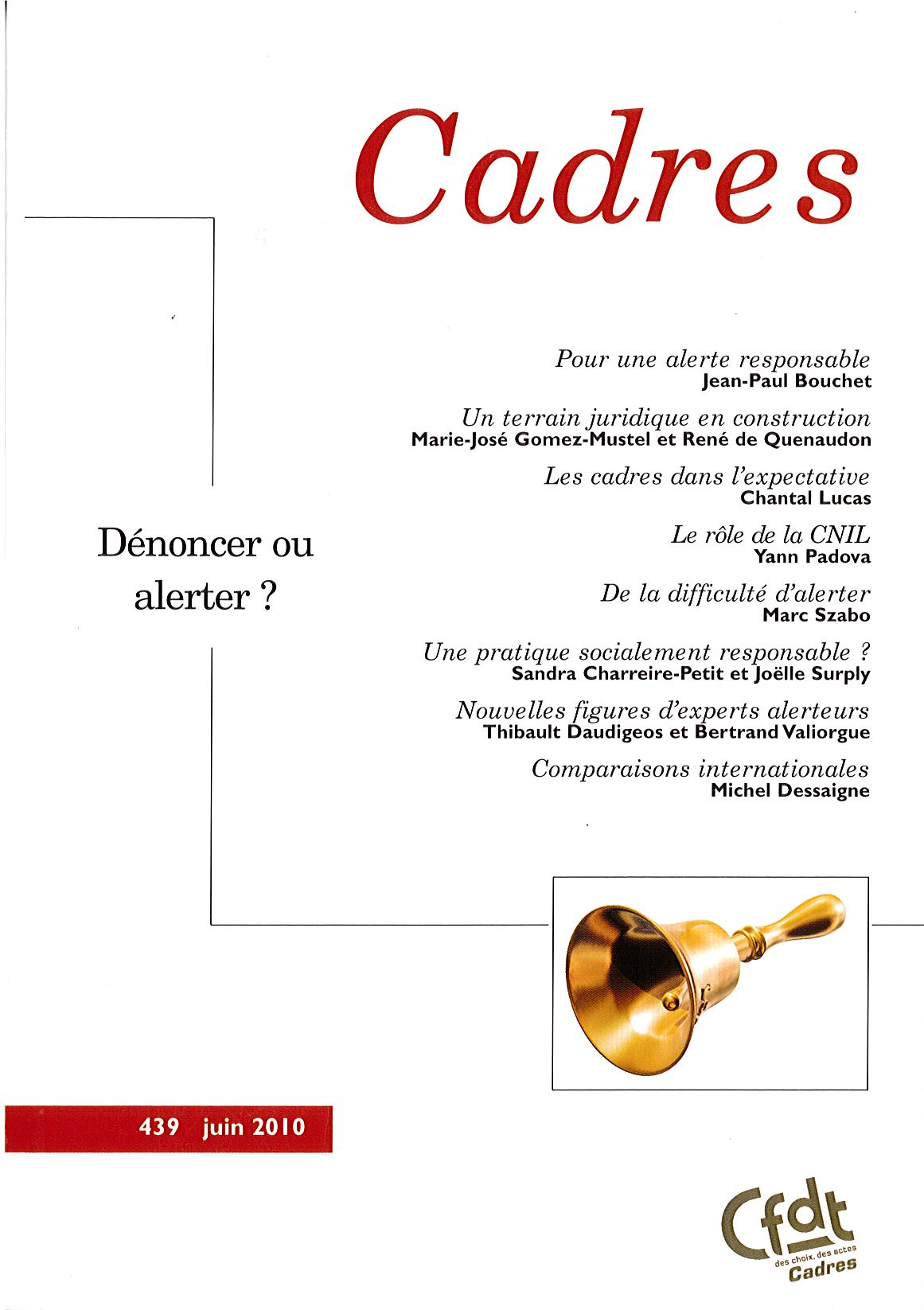Après la lecture du livre d’Alain Ehrenberg, on ne peut que mettre des guillemets à l’expression « souffrance sociale » et à son succédané qu’est la « souffrance au travail ». Ces catégories traduisent une représentation que la société française se donne d’elle-même.
Chaque société a sa propre façon de se représenter son présent au regard de son passé, de parler de son déclin, de s’expliquer ses tensions et ses conflits, d’interpréter les pathologies, de faire le lien entre le « mal individuel » et le « mal commun ». Là où la France se livre volontiers à une complainte à propos de la souffrance sociale, les Etats Unis aiment à entonner une « jérémiade » dont la tonalité n’est pas si lointaine, mais dont les paroles sont comme inversées.
Là où, en France, nous parlons du mal causé par le système (néo) libéral et le recul de l’Etat, Ehrenberg montre qu’aux Etats-Unis d’Amérique, le mal est vu comme engendré par… l’excès de pression étatique, empêchant l’individu d’exprimer sa personnalité. L’affirmation de soi, vue ici comme conditionnée par les institutions, est vue là-bas, à l’inverse, comme dépendant au premier chef de l’individu, de sa propre confiance en soi, du pouvoir qui lui est laissé de se gouverner lui-même (self-government).
L’exercice de sociologie comparée auquel nous convie La société du malaise consiste à faire la genèse et l’histoire du sens accordé, de part et d’autre de l’Atlantique, à la notion d’autonomie. Exercice complexe, et combien enrichissant, car à travers cette comparaison, nous nous rendons compte de ce que les lunettes que nous portons sur le nez en France nous donnent à voir le réel d’une certaine façon… mais il nous est possible de faire varier les focales.
Le self made man américain et l’ascèse puritaine
Dans la tradition américaine, la notion d’autonomie véhicule l’idée d’un cercle vertueux : compétition, coopération et indépendance vont de pair.
Etre autonome, sur un continent neuf où « le futur est ce qui rassemble », c’est saisir les opportunités qui s’offrent à vous. La confiance en soi est une foi en l’Amérique. Le self made man américain est ce citoyen qui, en créant de la richesse par son travail, contribue au bonheur public. De cette indépendance obtenue à la sueur de son front, il a le droit de tirer une part personnelle pour son bonheur privé. L’individu a donc des devoirs envers la société - comme envers Dieu. Le sociologue y voit la trace de l’ascèse protestante puritaine, dans laquelle chaque individu mène une sorte de guerre intérieure entre soi et soi, dont l’enjeu est d’« être élu ou damné ». De par ce moteur intérieur, -résume Ehrenberg- « le groupe est, pour ainsi dire, dans l’individu ».
Cette éthique du travail, au fondement de la citoyenneté américaine, explique le faible rôle dévolu à l’Etat en temps de paix - « la seule activité étatique devant être développée est l’éducation, parce qu’elle donne le goût de l’effort et le sens civique, augmentant ainsi les capacités à saisir des opportunités » - ainsi que la répulsion qu’inspire un Etat « nounou » (« nanny state »). L’étatisme est vu comme source de privilèges mais surtout comme un « poison de la confiance en soi ». Au monde (libéral) qui offre des opportunités invitant à agir s’oppose aux Etats-Unis le monde « socialiste » (quelle injure !) qui écrase l’individu de son poids. Au passage, Ehrenberg nous aide à mieux cerner les ressorts de l’ascension du néo-libéralisme apparu avec Reagan aux Etats Unis : au fur et à mesure qu’il est devenu l’opérateur central du progrès, l’Etat fédéral est apparu comme maternant des individus ayant abandonné la saine compétition.
L’utopie révolutionnaire française
Dans notre tradition républicaine et révolutionnaire, la société, via l’Etat, a des devoirs de protection envers l’individu. Individu est ici associé à individualisme, à une division artificielle du corps social, à une compétition destructrice, à un libéralisme désagrégateur, à la « psychologisation ». Certes, explique le sociologue, nous aspirons à une autonomie-indépendance. Mais nous refusons l’autonomie comme condition d’existence.
Notre jérémiade à nous, c’est l’affaiblissement des régulations étatiques, la « privatisation ». Notre complainte, c’est la perte d’autorité des institutions encadrantes et protectrices – la famille, l’école, l’entreprise – et par dessus tout la crise de l’Etat, représentatif de l’intérêt général et grand horloger qui mettrait en mouvement toutes les autres institutions et par conséquent les individus eux-mêmes. En France, l’obligation de s’affirmer, de faire montre d’initiative, l’appel à la responsabilité individuelle, l’impératif d’être à la fois compétitif et coopératif… sont des foyers d’inquiétudes.
L’un des passages les plus passionnants de La société du malaise réside dans la mise en perspective historique du paradoxe de l’individualisme à la française.
La révolution des droits de l’homme a consacré l’indépendance des individus grâce à l’Etat, en lieu et place des formes de dépendance antérieures. Notre manière d’instituer l’individu, rappelle Ehrenberg citant Tocqueville, découle de l’égalité accordant la même valeur à chacun, quelle qu’ait été sa condition d’origine. Le primat de l’indépendance de l’individu est co-substantiel à la démocratie, différant en cela d’un régime aristocratique où prime l’interdépendance, ce régime dans lequel les hommes sont reliés par « quelque chose qui est placé en dehors d’eux ».
Le paradoxe est que toute forme d’appartenance « particulière » est vue comme ouvrant une brèche dans la République Une et indivisible : corporatismes, égoïsmes catégoriels, etc. « L’intérêt particulier est l’ennemi commun intérieur qui doit se subordonner à l’intérêt général (lequel) est unanimité ». L’Etat incarne seul l’intérêt général et ne connaît guère les corps intermédiaires qui en seraient une « dénaturation ».
Cet Etat promulgue la loi et considère sa mise en œuvre comme « une simple exécution par une administration qui la décline sur l’ensemble des rouages de la société ». Il est « l’instituteur du social », ne se conçoit pas comme un juge ou un arbitre.
Car « l’idée qu’il puisse y avoir une société autonome et auto-suffisante lui est étrangère ». C’est pourquoi il faudra attendre 1884, avec l’instauration du syndicalisme, et le droit d’association de 1901, pour que soient légalisées des institutions donnant une substance à la société civile.
La société française ainsi organisée secrète une conception éthérée de la justice, attentive aux grands principes plus qu’à leur application, à l’égalité devant la loi plus qu’à l’égalité devant les opportunités, plus attachée à la justice immanente qu’au bonheur ici bas. La Révolution Française reste éternellement grosse de promesses à accomplir, de la « la question sociale » et de ce que François Furet appelle « l’illusion de la politique » : illusion d’un monde où tout changement social (serait) imputable à des forces connues, répertoriées, vivantes ; pensée mythique d’un univers objectif entièrement soumis à des volontés subjectives, qu’ils soient responsables ou boucs émissaires. « L’action n’y rencontre plus d’obstacles ou de limites, mais seulement des adversaires » (p 192).
Le bourgeois, l’homme qui se fait par lui-même, le self made man, n’a guère de place ici, il est au mieux un parvenu, un intrus dans un monde où c’est à Dieu ou bien à l’Etat de distribuer les richesses, et non aux individus de les acquérir.
La « souffrance au travail », nouvelle question sociale ou clameur a-politique ?
Cet arrière fond historique éclaire le sens – et la fonction – des expressions : souffrance sociale (ou psycho-sociale) et souffrance au travail. Ce que l’auteur souligne, c’est l’automatisme de pensée par lequel se trouvent reliés le substantif souffrance et l’adjectif social. Re-lié : tel est le substrat de « religion ». La thématique de la « souffrance sociale » mobilise émotionnellement, fait vibrer la compassion et le sens d’une commune humanité avec son prochain ; elle est une clameur, un rituel d’exorcisme par lequel nous disons notre culpabilité collective vis à vis d’un système réputé producteur de souffrances.
Or cette clameur ne laisse entrevoir nulle perspective politique pour y faire face et en sortir.
Il y est question d’une société morale ou éthique où règnent des consciences (bonnes et mauvaises), de relations interpersonnelles où se disputent des positions et des discours, mais pas d’une société réelle. Ce qui manque pour opérer ce passage au politique, c’est la prise en compte de l’action située.
Pour qu’on puisse parler de souffrance au travail, encore faudrait-il qu’il y ait « travail », or ce dernier est passé à la trappe : ce par quoi des personnes se coordonnent en vue d’une action collective.
La thèse de la « souffrance au travail » mobilise la compassion, mais il y manque le travail en action. Loin d’être sous-tendues par des rapports de co-opération et d’interdépendance en vue d’accomplir une œuvre commune, les relations sociales y sont de purs rapports de forces. Le management n’y a d’autre raison d’être que d’être une forme de domination.
Héritier de la réthorique enflammée de « la question sociale », Christophe Dejours ainsi célèbre l’unité défaite d’un peuple dominé, souffrant de la corruption de dirigeants plus ou moins pervers, lesquels enrôlent des collaborateurs zélés dans leur jeu fondé sur la peur (du licenciement) et le mensonge (l’information est falsifiée), tant et si bien que les victimes se voient réduites à l’impuissance. On retrouve ici « l’illusion de la politique » conçue en termes de pur rapport de force entre des adversaires, ce qui est finalement… anti-politique.
La souffrance sociale ou au travail est un miroir - « plutôt qu’une analyse du désarroi français (elle) en est l’expression » - qui permet d’éviter d’affronter la responsabilité de chacun dans le « système » et dans ses relations avec Autrui.
L’individu et le collectif : une opposition à dépasser
Alain Ehrenberg nous montre aussi que la fameuse opposition individu (el) versus collectif en recouvre une autre, plus subtile. Dans l’idéal démocratique américain, on l’a vu, réussite personnelle et contribution à la communauté sont inséparables, indépendance et interdépendance sont comme fusionnés. Notre tradition révolutionnaire opposant irréductiblement intérêt « particulier » et intérêt général dissocie radicalement indépendance et interdépendance, individu (el) et collectif. Le seul trait d’union possible passerait par l’Etat « instituteur du social » : notre Etat n’est-il pas pensé sur le modèle de l’Eglise guidant le croyant vers Dieu ?
Cette remarque iconoclaste éclaire le soubassement de notre « romantisme de la chute », de notre « déclinologie » à nous, le corollaire de ce qu’est aux Etats-Unis l’invraisemblable haine contre un Obama déterminé à ce que l’Etat garantisse un droit universel à la santé. Comme si une dose de protection allait tuer à jamais le self-government. Le corollaire ici, c’est la déliaison sociale imputée au retrait de l’Etat, prélude à la fin de la société, abandonnant l’individu à lui même. Non, dit Ehrenberg, « montée de l’individualisme » n’équivaut pas à « affaiblissement du lien social ». Ce qui est vu comme une montée de l’individualisme traduit « un nouveau régime de tension entre déliaison et liaison sociale », dans lequel les valeurs de l’interdépendance sociale sont subordonnées à celles de l’indépendance des individus.
La période actuelle appelle ici, conclut Alain Ehrenberg, à se saisir de « deux problèmes bien réels ». D’une part, le problème politique de la justice et des inégalités devant l’autonomie, ce qui doit conduire à compléter l’égalité formelle devant la loi par une politique de l’autonomie réelle des individus, et à envisager des dispositifs non seulement protecteurs vis à vis de risques, mais aussi apporteurs de ressources aux individus pour faire face à des opportunités.
D’autre part, le problème sociologique d’institutions faisant référence à la personnalité. Institutions, instituer : l’Etat monopolise l’institutionnalisation. Tout doit-il passer par le haut pour être légitime ? Des formes « intermédiaires » plus tournées vers l’individu ne sont-elles pas à instituer ? Au travail, n’est-ce pas d’acteurs intermédiaires et d’individus acteurs de leur vie dont nous manquons, plus que de nouvelles protections étatiques ?
Dans son mémoire de 1995, Damien Cru1 pose le problème du rapport entre individu et collectif au travail, indiquant : « il y a collectif lorsque plusieurs travailleurs concourent à une œuvre commune dans le respect de règles ».
La règle, explique-t-il, ça n’est pas seulement la référence professionnelle qui définirait la bonne manière de faire dans une situation (les « règles de l’art »), c’est bien autre chose : les règles de métier introduisent la loi au sein du groupe professionnel.
La règle, écrit Damien Cru, libère chacun de la tendance à s’auto-référer et à se replier sur lui-même. Elle organise les relations de coopération en stipulant ce qui y est admis, toléré, autorisé. Elle est la référence autour de laquelle se construit une liberté de chacun dans la façon de faire. Elle est ce qui permet que chaque être ne se sente pas atteint en tant qu’individu privé, car elle vise chacun en tant que rôle social. Elle constitue la personne, « per-sona », nous rappelle Damien Cru, c’est à dire le masque : peu importe celui qui le porte, l’important, c’est ce que le masque représente. Ce qui est antinomique à « collectif », conclut-il, ça n’est pas « individuel » : c’est le groupe sans loi, sans règle.
Ce dont nous manquons, ça n’est pas d’une résurrection collective ou du retour d’on ne sait quel collectif de travail, mais d’une institution des métiers et de leurs règles. En tissant des fils originaux entre des domaines souvent disjoints, Alain Ehrenberg nous aide puissamment à sortir d’une pensée fossilisée et à frayer un chemin balisé par quelques petits cailloux épars, à élargir une perspective selon laquelle la question dite de l’organisation du travail pourrait bien renaître sous la forme de nouvelles formes d’institution de l’individu au travail.
1 : Damien Cru, « Règles de métier, langue de métier : dimension symbolique au travail et démarche participative de prévention » Mémoire d’ Ecole Pratique des Hautes Etudes, juin 1995.