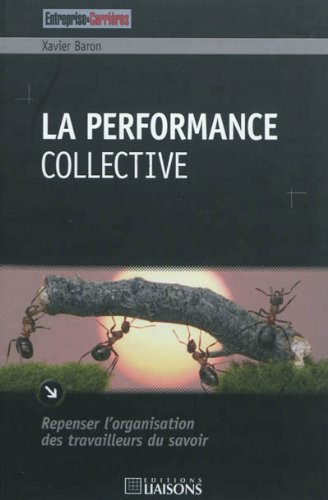Plusieurs éléments militent pour une lecture attentive de La performance collective. Repenser l’organisation des travailleurs du savoir. Le premier, qui est le point de départ du livre, est ce constat selon lequel nous appliquons des « recettes de la performance » toujours tributaires de la tradition de l’organisation scientifique du travail, sans voir que le travail que connaissait F.W. Taylor et les enjeux auxquels il était confronté n’existent plus. Dès l’introduction, Xavier Baron pose que l’économie n’est plus tirée par l’industrie (dans laquelle la subordination et la division des tâches étaient selon lui principalement légitimes et efficaces). Le travail est désormais « un travail intellectuel, serviciel, communicationnel, informationnel ». Le travail a changé, nos modes de management doivent changer.
Le deuxième élément est son parti pris, celui de réfléchir à ces questions de management, de performance et de compétitivité sous la double approche de l’efficacité et de la légitimité. Dans le chapitre consacré à l’évaluation, Xavier Baron revient sur ce point : « si l’on veut que l’évaluation favorise le travail collectif, l’instrumentation de gestion de cette évaluation doit être régulièrement négociée et organisée avec, et largement par, des collectifs… Pour que l’instrumentation fonctionne, il ne faut pas qu’elle soit conçue comme un automate de contrôle, mais plutôt comme un arbre à palabres ». C’est la différence entre organisation et gestion.
Enfin, et ce n’est pas le moindre des arguments en faveur de cette invitation à une lecture attentive, c’est le parcours de l’auteur, parcours alternant, qui l’a conduit à occuper des fonctions opérationnelles dans les directions des ressources humaines de grands groupes industriels et des fonctions d’études, de recherches et d’interventions, dans le cadre de Développement et Emploi et d’Entreprise et Personnel. Et à participer aux travaux de l’Observatoire des Cadres.
Xavier Baron propose neuf principes d’organisation de la production immatérielle et du travail intellectuel, principes censés nous guider pour « transformer efficacement du travail (intellectuel) en valeur (immatérielle) ». Les reprendre rapidement permet de rendre compte de l’ouvrage.
Le premier principe insiste sur la nécessité pour l’organisation de dire « la cause » (celle qui permet de travailler en connaissance de cause), de dire le sens, les finalités de l’entreprise. Dans l’économie immatérielle « chaque unité organisationnelle doit pouvoir expliquer (s’expliquer, justifier), faire comprendre la cause de son existence ». Ceci plaide pour des organisations simples et lisibles. Le deuxième principe part du fait que l’information n’étant ni matière ni énergie, elle n’a de valeur que contextualisée, elle n’a de valeur que dans l’interaction et donc au sein de collectifs. La réciprocité des échanges est une condition à la fois de la transformation de l’information en « potentiel d’usage » et de la vie durable des collectifs ; à la condition d’éviter la surcharge informationnelle ! Cette coopération, c’est le troisième principe, exige un investissement psychoaffectif, individuel et collectif, que l’entreprise doit reconnaître en donnant une contrepartie qu’elle seule peut donner : l’accès durable à un travail de qualité (qui est plus que le salaire, la promotion, la formation, de bonnes conditions de travail, mais n’en dispense pas !). En attendant peut-être de lier la « rétribution de la confiance et de la coopération des cerveaux » à la question de la propriété intellectuelle, comme il est suggéré dans le dernier chapitre.
Le quatrième principe porte sur le caractère collectif de la production immatérielle et sur les conditions opératoires de la solidarité, elle-même étant une condition de la coopération. La durée et la proximité (dans l’espace, socialement, culturellement) favorisent ainsi la « perception d’un devenir en commun ». Solidaire, le collectif est une ressource qui permet d’assumer un surcroît d’empowerment et de responsabilité dans des organisations qui seraient sinon anxiogènes. Dans la suite de ce principe et « solidairement » à lui, l’organisation doit aussi développer l’autonomie des travailleurs du savoir par l’accroissement des responsabilités. Lorsque la compétence consiste à tirer parti des ressources de son environnement, la force d’invention va au-delà de la force de travail. Les guides d’action sont endogènes à l’individu. L’organisation doit faire sa place à une autonomie de condition (« je suis autonome » et non pas « je voudrais être autonome »). Mais cette autonomie n’est pas isolement, l’organisation doit aussi fournir des « espaces de traitement des contradictions, des conflits éthiques ».
Le principe suivant est plus pratique, il n’en est pas moins fondamental. Xavier Baron y revient d’ailleurs dans le chapitre consacré à l’ergonomie du travail. Il concerne la traduction spatiale des exigences des collectifs de travailleurs du savoir. Les espaces de bureau sont « un opérateur de solidarité et de coopérativité ». L’espace étendu du travail intellectuel, coworking, travail nomade, à distance, le télétravail, doit être pensé. C’est un sujet que l’auteur connaît bien, et ses convictions sur l’influence de notre environnement de travail sur nos comportements, sont affirmées avec force : « C’est nous qui construisons nos espaces. Mais une fois construits, les espaces nous gouvernent… Aménager des bureaux, c’est influencer des comportements, c’est organiser le travail des collectifs ». Le principe suivant porte sur la mesure de la performance et sur la nécessité, et la difficulté, qu’il y a à « appréhender le réel » lorsqu’on ne peut se satisfaire d’indicateurs quantitatifs : « Les organisations et leurs instrumentations de gestion, les évaluations des process comme des résultats doivent être co-construits et intégrés par une élaboration sans cesse renouvelée dans le dialogue ». L’instrumentation de gestion ne doit pas seulement répondre à des besoins de contrôle. Elle doit fournir un cadre, faire sens. L’idée de l’arbre à palabres de nouveau…
A la différence des organisations tayloriennes, la production immatérielle est interactive et collective. Les organisations du travail intellectuel doivent combiner l’enjeu d’une intégration et d’une différenciation des acteurs individuels au sein des collectifs et d’une intégration/différenciation entre les collectifs eux-mêmes. Les travailleurs du savoir ne sont pas tous des cadres. Quel contrat leur est proposé ? Les directions des ressources humaines doivent inventer et faire vivre de nouvelles catégories adaptées à ces travailleurs et fidèles aux rôles, aux responsabilités et aux hiérarchies. Enfin, cette liste se termine par un principe d’investissement sur un « actif immatériel à haut rendement » : la qualité du lien social et la confiance. Ce dernier principe d’action renvoie à la qualité de l’animation managériale. Il ouvre en même temps à la perspective optimiste du développement d’une offre de travail de qualité et d’une « extension raisonnée des principes démocratiques à l’intérieur des entreprises, dans les organisations du travail ». Ainsi les organisations seront plus efficaces et plus légitimes, et nous serons plus compétitifs par d’autres voies que la régression sociale et le moins-disant salarial.
Prudemment, Xavier Baron s’arrête là. Nous n’aurons donc pas les dix commandements ni les Tables de la loi ! Les autres chapitres du livre développent certains de ces principes, les confrontent à la pratique. C’est le cas en particulier pour l’ergonomie et l’évaluation (et les entretiens du même nom), avec des illustrations par des retours d’expérience.
Au final, tout en adhérant très largement à ces principes, deux choses me laissent un sentiment d’inachevé. La première concerne les conséquences sur le « compromis salarial » des mutations du travail telles qu’elles sont décrites et analysées. Pour rappel, en droit, le contrat salarial repose sur la rétribution d’une obligation de moyens (mettre à disposition sa force de travail) et non de résultat. Le salarié n’est (n’était ?) pas comptable des résultats qui sont l’affaire de l’entreprise. Les termes de ce contrat ne sont sans doute plus tenables, pour reprendre l’expression de Xavier Baron dans le chapitre 9. Il n’est pas sûr qu’un management par les objectifs et les résultats, même encadré de « justice procédurale », puisse fonder un nouveau deal acceptable sous le double registre de l’efficacité et de la légitimité. Où sont les débats sur le travail, ses dilemmes pratiques et ses dilemmes éthiques, évoqués ailleurs dans le livre ? Où sont les collectifs, la coopération et la confiance ? Le débat est à venir. Enfin, et je terminerai là-dessus, je ne suis pas sûr d’avoir une meilleure compréhension de qui sont les travailleurs du savoir et ce qu’ils font. Le côté fourre-tout de cette catégorie n’est pas levé. Parle-t-on des savoirs pour la production, des savoirs pour l’innovation, des savoirs pour les activités de service ? Parle-t-on des grands groupes ou des PME ? Parle-t-on des scientifiques et chercheurs, des manipulateurs de symboles, de ceux qui transmettent les savoirs, de ceux qui informent, des managers d’hommes et/ou de projets, de ceux dont l’activité est au cœur de réseaux et d’interdépendances multiples, de ceux qui « travaillent sur autrui » ? Il n’est pas sûr qu’ils soient concernés par les mêmes questions en termes d’organisation du travail, de rétribution et de rapport à leur employeur.
Nous laisser ainsi sur notre faim et ouvrir à de nouveaux échanges, à de nouveaux débats et à de nouvelles propositions, doit-il être mis au débit ou au crédit du livre de Xavier Baron ? A vous de le lire et de juger !