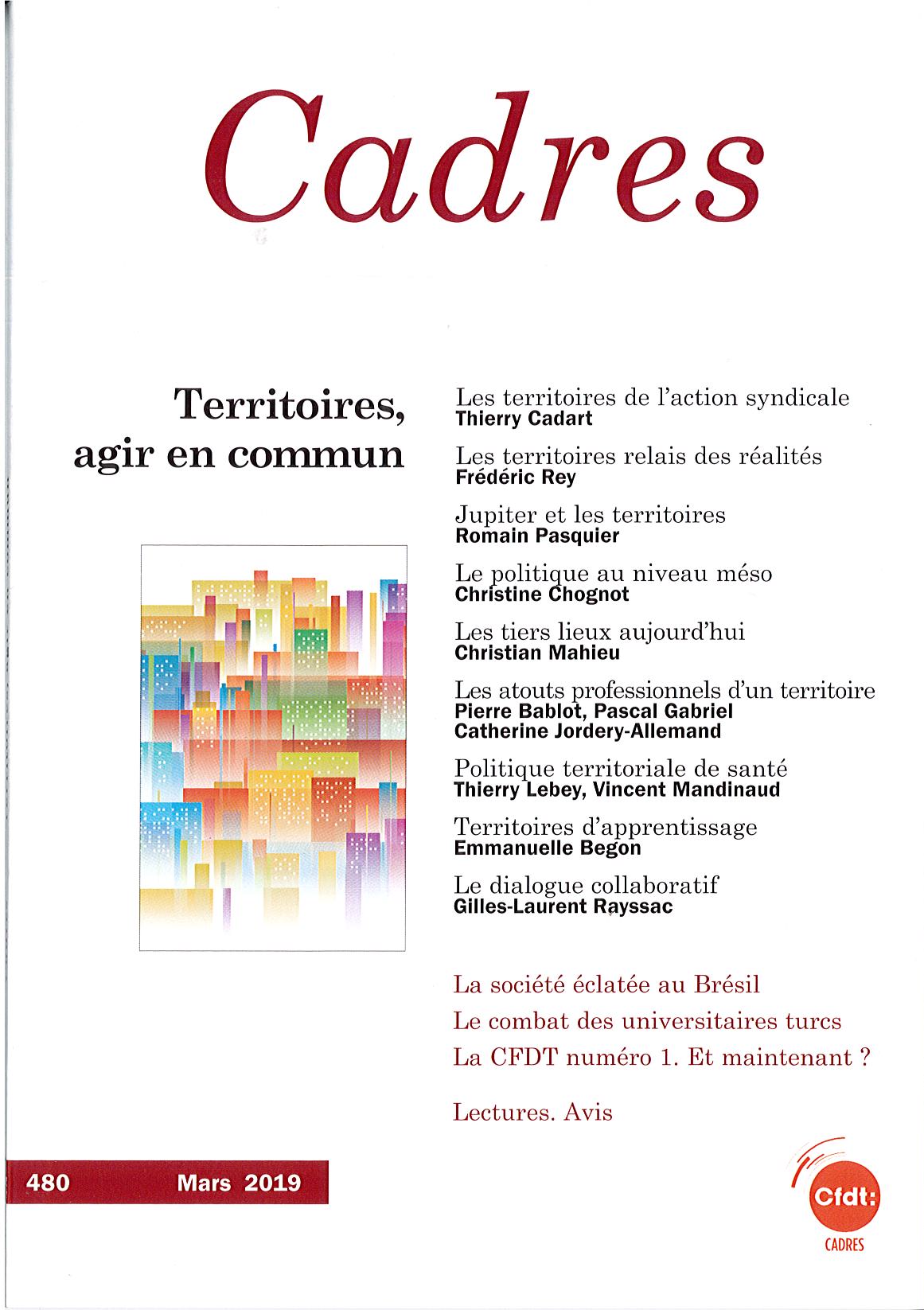À l’heure où se déploie sur les routes de France un mouvement social basiste et informel aux revendications confuses, la lecture du livre de Guy Groux, Michel Noblecourt et Jean-Dominique Simonpoli rappelle les difficultés, les vertus et les potentialités des formes institutionnelles qui, depuis plus d’un siècle à présent, organisent la confrontation des visions et des intérêts autour du monde du travail.
La forme même de l’ouvrage rend hommage à son objet. Car les visions des trois auteurs ne se confondent pas, et s’ils sont capables d’accorder leurs vues en proposant en fin d’ouvrage un manifeste commun, ce sont bien trois points de vue différents qui guident leur propos. Guy Groux, est sociologue au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) ; Michel Noblecourt est éditorialiste au journal Le Monde, spécialiste des syndicats et de la gauche politique ; Jean-Dominique Simonpoli, un ancien responsable national de la CGT, dirige l’association Dialogues, dédiée au dialogue social, et il a rédigé des rapports remis à la ministre du Travail Muriel Pénicaud.
Un académique, un observateur, un acteur : trois façons de saisir les dynamiques qui animent un moment d’inflexion de l’histoire déjà séculaire du dialogue social en France.
La première vertu de l’ouvrage est bien de pointer l’importance de ce moment, en saisissant un ensemble de tendances qui, sans être linéaires ni parfaitement cohérentes, signalent une évolution dans laquelle on pourrait presque voir une révolution.
Cette évolution a pour particularité de se jouer à la fois à bas bruit, dans le détail des pratiques, et dans le fracas de la vie publique. Sa partie la plus visible, la plus formelle aussi, se développe sur vingt ans dans une série de textes de loi dont certains n’ont suscité aucune réaction, quand d’autres déclenchaient des concerts de protestation. Les lois Larcher, la loi El Khomri, les ordonnances Macron sont les principales étapes de ce mouvement dont le sens est de donner toujours plus d’autonomie aux partenaires sociaux, en leur conférant une responsabilité toujours plus grande dans l’écriture des normes qui encadrent le monde du travail.
Cette évolution a pu inquiéter les acteurs et certains juristes, au motif qu’elle remettait en cause, avec la hiérarchie des normes, un « ordre public social » dont le code du travail était la meilleure incarnation : puissant, détaillé, prescripteur, façonné par le politique et décliné par le ministère du Travail. Mais là où certains s’inquiétaient de la « casse du code du travail », d’autres saluaient la libération des potentialités d’une économie française corsetée dans un ensemble si minutieux qu’il en était illisible.
Or, nous montrent les auteurs et en particulier Guy Groux dans la seconde partie de l’ouvrage, cette évolution ne saurait se réduire aux caprices de politiques saisis par une fièvre thatchérienne. Elle s’inscrit dans – et répond à – une évolution d’ensemble touchant à la fois à l’organisation de l’économie (fin du fordisme et segmentation du salariat), à l’organisation de la société (élévation du niveau d’éducation, numérisation du monde), à l’organisation des entreprises (allongement des chaînes de valeur, nouvelles relations d’emploi), et enfin aux nouveaux enjeux qui pénètrent la négociation sociale à ses différents niveaux, notamment l’emploi et la compétitivité, consacrant l’essor d’un « dialogue social managérial » qui mérite d’être appréhendé sans naïveté mais sans refus de principe non plus, ne serait-ce que parce qu’il s’est imposé dans les pratiques.
Guy Groux suggère ainsi qu’en toile de fond de l’évolution législative se joue une « révolution culturelle » : « Après le XIXe siècle et l’anarcho-syndicalisme, puis un XXe siècle longtemps dominé par une culture de « lutte de classes », assiste-t-on à l’essor d’une tendance historique où le syndicalisme contractuel deviendrait à son tour hégémonique ? »
Cet essor ne va pas de soi, et c’est tout l’intérêt des deux autres parties de l’ouvrage que de pointer les contraintes qui s’y opposent.
Contraintes politiques d’abord, mises en évidence par Michel Noblecourt dans une première partie lumineuse sur l’histoire des rapports entre syndicats et partis politiques – une histoire tissée de malentendus et de rencontres manquées qui a marqué à la fois la culture politique française dans son ensemble (les principaux acteurs se rejoignant après 1945 dans la prépondérance accordée au politique, à l’État, à la loi), mais aussi les traditions et habitudes des partenaires sociaux, et en particulier de syndicats dont la conversion à la loi, au fil du XXe siècle, est fascinante au regard de leur histoire précédente. Mais la partie n’est pas jouée, et l’observateur avisé qu’est Noblecourt met en évidence, aussi bien à la CFDT qu’à la CGT, les signes d’une capacité à entrer dans un autre régime.
Pour autant cette capacité reste contrainte, et c’est là tout l’intérêt de la troisième partie rédigée par Dominique Simonpoli, par une question majeure : la confiance. Question politique et culturelle à la fois, grevée par des décennies de pratiques, de discours, de postures. Mais à l’inertie de ces traditions l’auteur oppose à la fois la nécessité d’évoluer – les syndicats, comme les civilisations de Valéry, sont mortels – et les multiples signaux qui attestent ou promettent un élargissement de la démocratie sociale. Évoquant la figure de Georges Séguy, Dominique Simonpoli insiste particulièrement sur les enjeux d’une évolution de la CGT confrontée, si elle veut continuer à assumer son ambition de transformation sociale, à la question de sa propre transformation.
Ainsi, sans nier des blocages et des difficultés qu’ils analysent au contraire avec précision, les trois auteurs se retrouvent sur l’idée d’une évolution significative, en rupture avec des traditions qui n’ont rien d’absolu mais représentent simplement la pétrification de solutions historiques. Dans le « Manifeste » qui termine l’ouvrage, ils appellent les acteurs à se saisir de ce qui apparaît en somme comme une opportunité pour les partenaires sociaux, et les syndicats au premier chef, de jouer dans le monde qui commence un rôle aussi significatif que celui qui a été le leur au XXe siècle. Des propositions donnent corps à cet appel, parmi lesquelles on notera en particulier la création de nouveaux espaces de dialogue (réels et virtuels) dans les entreprises, en complément des institutions représentatives du personnel, afin de saisir toutes les potentialités d’un « dialogue social » qui ne se réduirait plus à la négociation mais, au diapason des évolutions de la démocratie politique, embrasserait un vaste champ partant de la concertation et intégrant des formes de participation allant jusqu’au référendum.