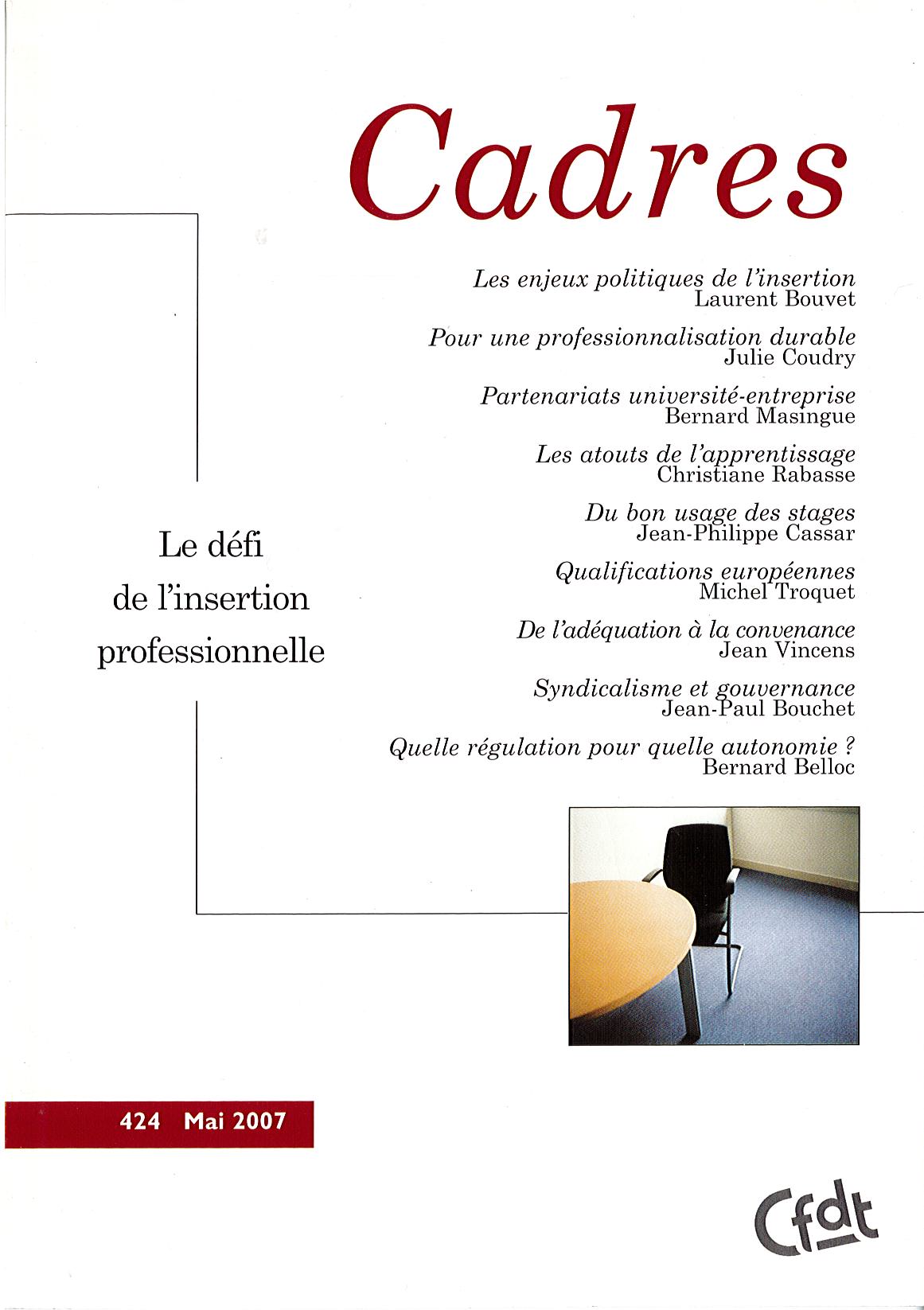La réforme de l’université est urgente. Le rattrapage est indispensable sous peine d’une relégation définitive de la France comme pays de seconde zone sur le plan de la formation de sa population, avec le déclin économique que cela impliquerait.
Une réforme nécessaire
Les problèmes de l’université française sont connus. Elle pâtit d’abord d’un grave déficit de moyens : elle est sous-financée à la fois par rapport à l’enseignement secondaire, privilégié à son détriment ces dernières décennies, par rapport à ses homologues étrangères et par rapport aux autres institutions de l’enseignement supérieur (grandes écoles, STS, IUT).
Elle rencontre également un problème d’organisation et de direction, du fait de l’absence d’autonomie, d’une gestion centralisée et uniforme, d’une taille souvent trop petite des établissements, d’une obligation d’accueillir tous les bacheliers et d’un cloisonnement entre disciplines et entre filières. Enfin, elle se caractérise par une piètre gestion des ressources humaines marquée par une rigidité statutaire des enseignants-chercheurs, une faible attractivité de la carrière en termes de rémunérations et de mobilité, une insuffisance du personnel d’encadrement administratif et une faible prise en compte de la différenciation des tâches des enseignants-chercheurs.
Ces problèmes demandent à être considérés dans le cadre d’une compétition universitaire désormais internationale. Même si l’on peut critiquer leurs critères, tant l’Université Jiao Tong de Shangaï que le Times Higher Education Supplement parviennent à un résultat préoccupant : sur les 50 premières universités mondiales, seulement une ou au mieux deux sont françaises et dix ou treize européennes. L’Europe est très en retard et la France est quasi absente.
Un aspect déterminant de la compétitivité du système universitaire tient à sa capacité à attirer les meilleurs étudiants et chercheurs étrangers, et à pouvoir retenir les meilleurs enseignants-chercheurs nationaux. Il s’agit là d’un défi essentiel pour la France qui accueille beaucoup d’étudiants des pays en développement, notamment d’Afrique. Or, notre pays perd de plus en plus de chercheurs et d’enseignants de qualité au profit de systèmes universitaires mieux dotés et mieux organisés (notamment aux États-Unis) au sein desquels ils trouvent les moyens de travailler plus efficacement et plus dignement.
Une réforme s’impose donc. Elle ne peut consister en un replâtrage ; elle doit être substantielle et suivie sur toute une législature et un mandat présidentiel. Elle sera difficile car elle devra s’attaquer de front aux différents aspects de la crise de l’université. Cette difficulté peut d’ailleurs nous mettre sur la piste d’une solution. Comment faire passer une réforme qui ne manquera pas de dresser contre elles tous les corporatismes ? En lui donnant sens. Le souci d’une meilleure performance du système ne peut prendre sens que si on l’intègre dans une ambition politique et sociale. La question des inégalités s’impose alors comme le cœur de cet agenda réformiste, car la mauvaise performance de notre système universitaire n’affecte pas que l’économie française : ses premières victimes sont les étudiants.
Un système inégalitaire
L’université en effet est marquée par l’inégalité : inégalité des chances entre étudiants issus de milieux sociaux différents, inégalité entre étudiants de l’université et des grandes écoles, inégalité de traitement entre étudiants des différentes filières et des différentes universités, inégalité d’accès aux études entre étudiants en formation initiale et salariés en formation continue.
La première inégalité à combattre tient à la différence de traitement dans le budget de l’État entre les élèves du secondaire et les étudiants de l’université. Il faut mettre un terme au déséquilibre de traitement entre secondaire et supérieur. Comme l’ont montré Elie Cohen et Philippe Aghion, la France est le seul pays de l’OCDE à avoir privilégié le secondaire par rapport au supérieur depuis une vingtaine d’années, ce qui lui donne une configuration éducative plus proche d’un pays en développement que d’un pays développé. Un élève de lycée coûte ainsi plus de 10 000 euros par an alors qu’un étudiant à l’université ne coûte que 6 700 euros. La priorité budgétaire éducative doit désormais être concentrée sur l’enseignement supérieur après l’avoir été sur le secondaire.
La deuxième inégalité touche les étudiants de l’université par rapport aux autres formes d’enseignement supérieur. Elle est flagrante dans la mesure où l’étudiant universitaire est le moins bien doté : 6 700 euros par an contre 9 160 pour l’étudiant d’IUT, 12 300 pour l’élève de section de techniciens supérieurs et 13 760 pour l’élève de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE). Il s’agit là encore d’une priorité à afficher dans la mesure où le problème est celui de l’université et non des autres types d’établissement.
L’intégration des CPGE dans les universités, une fois celles-ci réformées dans leur mode de gouvernance, pourrait être un moyen de combattre cette inégalité sans altérer la qualité de la formation, de même que le rapprochement des grandes écoles et de l’université doit être accentué, au-delà des quelques laboratoires communs qui existent aujourd’hui.
L’accentuation de la professionnalisation de certaines formations universitaires (licence et master) est également une manière de rompre avec ces différences entre filières, les passerelles entre formations professionnelles et générales devant être développées à tous les niveaux de diplôme.
Enfin, les moyens d’étude (bibliothèques, technologies de l’information et de la communication, télé-enseignement) doivent être démultipliés dans des locaux dignes de ce nom.
Reproduction sociale
La troisième inégalité à combattre est la différence de traitement entre les étudiants de l’université selon les filières et les localisations. Il s’agit ici de mettre fin à la fois à l’arrivée massive d’étudiants dans les premiers cycles de certaines filières qui manquent de débouchés (notamment sociologie, psychologie, sciences de l’éducation, information et communication, STAPS) et au gâchis que représente une politique non réfléchie de création d’antennes universitaires dans des villes de taille moyenne. Il s’agit également de revoir la taille des universités et la pertinence du découpage actuel : il existe près de 90 universités sous un seul statut malgré des différences considérables en termes de taille, de pluridisciplinarité, de part des différents cycles et de vocation professionnelle ou de recherche. Il y a là de nombreuses sources d’inégalités entre étudiants dans leur formation (qualité de l’enseignement, liberté de choix d’options, taux d’encadrement, environnement de travail) et dans leurs conditions de vie (logement, transport, loisirs).
Il faut également combattre la reproduction des inégalités sociales à l’université. Parallèlement à une réforme des droits d’inscription qui pourraient être modulés en fonction du revenu des parents, la mise en place d’un nouveau système de bourses et de prêts est indispensable. Les bourses devraient être réservées aux étudiants les plus démunis en mixant critères sociaux et universitaires sous la forme de « contrats d’étude » permettant un engagement réciproque et les prêts devraient être à la fois diversifiés et en partie garantis par un système public de cautionnement et de mutualisation du risque permettant de prendre en charge le remboursement du prêt des diplômés dont l’emploi n’assure pas un niveau de rémunération suffisant. L’État pourrait amorcer le système en investissant par exemple 1% des emprunts d’État, soit 1,2 milliard d’euros, ainsi que l’avait proposé Alain Trannoy.
La cinquième inégalité à combattre est celle devant l’orientation et la sélection. C’est aujourd’hui la plus déterminante compte tenu de la massification de l’enseignement supérieur marquée par un doublement en 20 ans des effectifs. On connaît depuis longtemps le privilège des étudiants disposant d’un « capital social », la sélection par l’échec à la fois féroce et opaque et l’existence de filières « détournées » : les IUT et les STS accueillent sur dossier de bons élèves des séries générales alors que les baccalauréats technologiques, voire professionnels, se retrouvent dans les filières non sélectives de l’université pour lesquelles ils ne sont pas préparés. On marche sur la tête !
D’ailleurs, près de la moitié des étudiants sont aujourd’hui inscrits dans des filières sélectives sur dossier, examen ou concours. Il est urgent de mettre fin à ce système au nom d’une égalité effective des chances, de la transparence et de la responsabilisation de chacun.
Dans son contenu, la réforme de l’université sera principalement celle du premier cycle, et notamment de la première année de l’université, puisque c’est là que se concentrent les problèmes en raison de l’accueil obligatoire de « tous » les bacheliers non admis dans de meilleures filières, de l’inadaptation des formats pédagogiques (cours magistraux et TD souvent surpeuplés) et de l’hyper-sélection par l’abandon (45% de taux d’échec les deux premières années mais avec des différences notables selon l’origine sociale et scolaire des étudiants : 60% d’échec pour les moins favorisés).
Une des actions prioritaires serait d’orienter les étudiants lors de leur premier cycle à l’université par le biais d’une première année généraliste de type propédeutique ou collège universitaire, l’entretien-discussion d’orientation avec un enseignant à l’issue de celle-ci et la mise en place de passerelles entre les filières grâce à la généralisation du système majeure-mineures dans le choix des matières durant les trois premières années (licence).
Une meilleure gestion prévisionnelle des filières et de leurs débouchés à 3 et 5 ans devrait également être organisée aussi bien pour les concours de la fonction publique que pour l’emploi dans le secteur privé. Enfin, l’université doit pouvoir accueillir des formations différentes – professionnelles (initiale et continue), généralistes et à la recherche – en assumant ces différences sans que cela pénalise l’une ou l’autre de ces spécialisations, mais sans laisser aux étudiants l’illusion d’une égalité de résultats. Il faut donc refuser à la fois la secondarisation de l’université, c’est-à-dire des objectifs quantitatifs du type 60% d’une classe d’âge au niveau licence par exemple, et sa sanctuarisation – une université faite par les chercheurs pour les futurs chercheurs. L’université doit être à la fois généraliste et spécialisée.
Développer les formations à vocation professionnelle peut alors être un axe fort de la réforme. Dans le cadre d’ensemble d’une université généraliste, les formations professionnalisantes doivent être développées. Elles représentent à la fois une garantie d’insertion professionnelle pour les titulaires de diplômes de ce type et l’assurance d’une qualité de la formation orientée non seulement vers les besoins du milieu professionnel mais aussi vers ceux du futur salarié.
Ensuite, les formations à vocation professionnelle qui existent à l’université (IUT, licence pro, master pro et l’essentiel des formations des facultés de médecine et de droit) apparaissent généralement comme des réussites.
Enfin, la vocation professionnelle de l’université doit être rappelée, compte tenu de l’amélioration nécessaire du niveau de qualification des emplois. Toutefois, le développement et l’amélioration des filières professionnelles ne doivent pas se faire au détriment des autres missions de l’université, notamment de la recherche, comme cela a trop souvent été le cas.
Il convient ensuite de développer les dispositifs existants et « lisser » les parcours entre les niveaux de formation en assurant une continuité entre IUT, licence pro et master pro jusqu’au doctorat. La professionnalisation doit intervenir à tous les niveaux de sortie de l’université (Bac + 2/3/5 ou 8).
La spécificité de l’université doit tenir à la qualité de la formation par des enseignants-chercheurs alliés à des professionnels et à la présence d’éléments de formation générale dans les cursus « pro » afin de faciliter évolution et reconversion des étudiants et des salariés. Il faudra également améliorer l’alternance dans les formations à vocation professionnelle à l’université, notamment par le biais des stages, que l’université ne parvient pas aujourd’hui à organiser faute de collaboration entre les universités et les employeurs potentiels et d’un personnel compétent.
Enfin, il sera utile de renforcer le rôle de l’université dans la formation professionnelle continue, qui doit devenir un modèle en termes de qualité et de certification des formations.