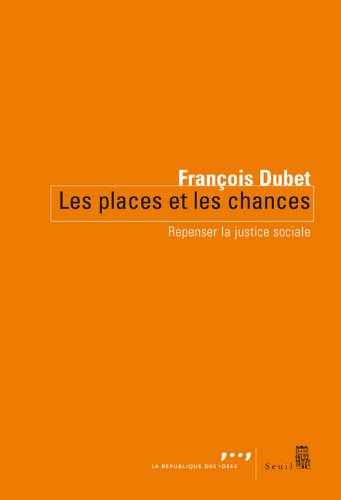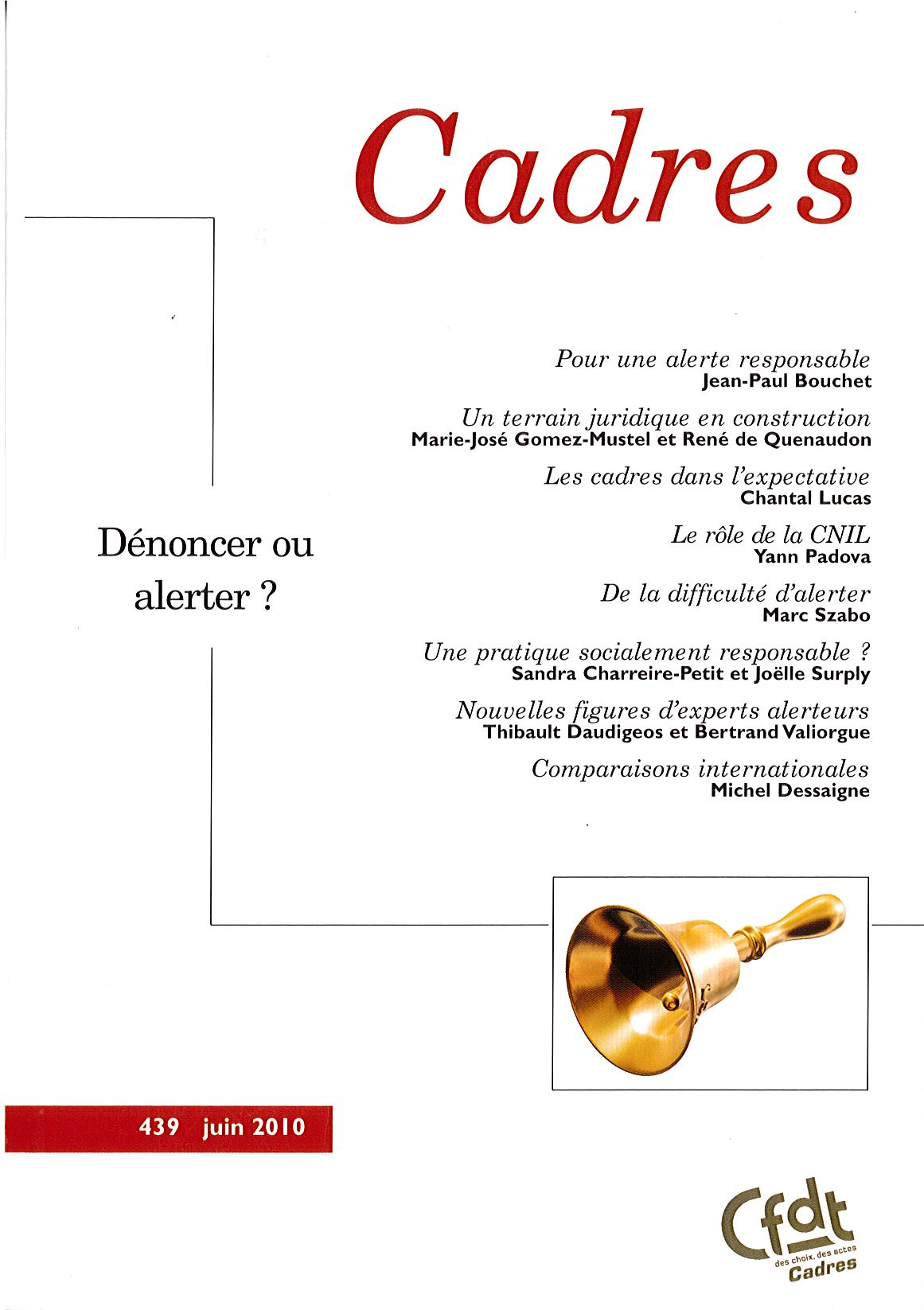Cet essai, remarquablement pédagogique, fait fond des nombreux travaux de François Dubet sur les inégalités et les marges sociales pour intégrer son matériau dans une pensée plus large de philosophie politique. L’avènement des régimes démocratiques, à la suite de l’effondrement des sociétés d’ancien régime, n’a cessé de questionner la contradiction entre le principe d’égalité de tous les citoyens et les inégalités sociales produites par les effets de la libre concurrence des intérêts dans le capitalisme.
A travers le prisme empirique de résultats d’enquête sur les inégalités scolaires, ethniques et de genre, François Dubet examine les représentations de la justice sociale qui sous-tendent la volonté et les programmes politiques contemporains dans la résolution de cette contradiction. La ligne argumentative se condense dans une opposition bipolaire entre le système de l’égalité des places, minoritaire car partiellement conservateur de prime abord, et celui de l’égalité des chances, majoritaire du fait de la prééminence de la pensée de Rawls en matière de justice sociale. Successivement avocat de chacun des modèles, il expose le type de société auquel ils conduisent en exemplifiant leurs effets respectifs dans le domaine de l’éducation, des femmes et des minorités.
Le modèle de l’égalité des places, historiquement envisagé dans un premier temps, est corrélé à l’apparition du capitalisme et de la société industrielle qui donnent naissance dans leur confrontation à une société salariale.
Conceptualisé en termes de lutte des classes, cette contestation, impulsée par des acteurs disparates (confédérations syndicales, catholicisme social, penseurs utopiques, philanthropes, fonctionnaires, et tendance mutualiste), s’incarne dans les revendications ouvrières du XIXième et du XXième siècles, principalement soucieuses de négocier à un meilleur prix de vente leur force de travail. Ces rapports de force aboutissent à des formes de compromis social et à des règles de droit qui rendent possible la concertation et la négociation. S’enracine alors progressivement la certitude qu’aux droits et aux principes démocratiques issus de la révolution correspondent des droits sociaux inaliénables.
Ainsi, aux premiers accords de branche se substituent des droits universaux qui, à dessein d’égalité, sécurisent les places occupées par les travailleurs sur le marché de l’emploi en parant aux risques qu’ils encourent – chômage, soins, retraite, logement, etc. Dans cette optique, l’État providence émerge sous la figure du garant de la « démarchandisation » des biens publics et de la redistribution des revenus prélevés. L’État met à disposition des biens qui furent longtemps l’apanage d’une catégorie de la population (écoles, transports, postes, commissariats, bibliothèques, piscines, etc.) en agissant, ici, moins sur la réduction des écarts des revenus que sur la gratuité des biens accordés.
Ensuite, attelée à une conception de la société en termes d’utilité collective et de fonctions dans la division sociale du travail, la redistribution devient un principe moral destiné à rétribuer l’utilité des travailleurs dans la production des richesses et le bien-être collectif en se substituant aux manquements du système économique dans la juste répartition des revenus.
Ce contrat de solidarité implique le centralisme et l’uniformité du système éducatif dont le principal objectif, à travers la transmission d’une langue, d’une culture et de valeurs communes, est d’assurer par un enseignement minimal le resserrement des positions sociales.
Les avancées récentes des femmes dans le monde du travail, sans remettre en cause la division sexuelle des emplois, est aussi le lieu de promotion de l’égalité et de l’amélioration de la condition salariale. Réduit au travail et au salariat, la question de la justice sociale, ramassée sur un principe de bénéfice et de détention des droits sociaux subordonnés au statut de travailleur, relègue les phénomènes migratoires dans l’appareil partisan et syndical censé canaliser l’intégration des populations au sein de la classe ouvrière et opérer la transformation des étrangers en nationaux.
Finalement, la poursuite de l’égalité des places, crispée sur la défense de droits perçus à travers la rhétorique des « acquis », se cristallise sous la forme de corporatismes et de régimes spéciaux qui induisent l’exclusion de la liste des ayants droit ceux qui n’ont pas accès au marché de l’emploi – ce n’est que très récemment que le RMI a pallié cet écueil. Cela participe de l’apparition d’une importante classe moyenne, largement issue de la fonction publique qui cumule une forte protection et l’accès à des avantages différentiels, et d’un sentiment concomitant de clivage d’avec les plus pauvres.
Cette défiance à l’égard de cette sous-classe est accentuée par la rigidité du tissu social, dont les individus, plus soucieux de la conservation de leur position que de la nature du lien qui fait entre eux société, attendent de l’État qu’il fabrique de la cohésion sociale au détriment de leur capacité d’action et de mobilisation. Une forme d’enlisement et de défiance généralisée des membres de la société civile concourraient à la faillite de ce contrat social.
Le monde scolaire, attaché à cette croyance de l’équivalence entre le diplôme et la position professionnelle, devient le catalyseur de la frustration massive des diplômés, déçus et défiants à l’égard des institutions étatiques. Quant aux femmes, lorsqu’elles parviennent à intégrer le monde du travail, le phénomène du plafond de verre fait obstacle à l’accession des postes à hautes responsabilités et à fortes rémunérations.
En effet, malgré une volonté affichée des politiques et des dirigeants, ni les modèles culturels pourvoyeurs de stéréotypes, ni l’économie de la vie familiale n’ont profondément changé. L’intériorisation de ces schèmes et les anticipations biographiques des femmes attachées à une vie de famille reproduisent les inégalités dans les espace privé, public et professionnel.
Enfin, l’échec du modèle laïc et républicain de l’intégration des populations étrangères, dopé d’une part par la naissance d’une génération moins désireuse d’occuper les emplois non qualifiés de leurs parents et d’autre part par l’avènement de sociétés pluriculturelles dans lesquelles les diasporas densifient leurs relations avec le pays d’origine, renouvelle la conception de la justice sociale qui semble s’orienter vers un modèle d’égalité des chances. Ce dernier précipite les revendications identitaires, liées aux discriminations, vers une égalité d’accès aux positions.
Dès lors, plutôt que critiquer la structure sociale des positions, on s’attache à rendre toutes les positions disponibles à tout un chacun. L’axiome de départ, selon lequel les talents et les mérites sont distribués aléatoirement entre des individus égaux à la naissance, postule une fiction statistique de répartition indéterminée socialement. Cela dit, la justification des inégalités, reposant sur la substitution d’un déterminisme social par un principe de responsabilité individuelle, nécessite que les effets de l’héritage et de l’éducation soient abolis.
C’est dans cette perspective de nivellement que prennent sens les mesures de réduction des discriminations afin de souscrire pleinement aux principes méritocratiques. Cette dynamique, assise par un contexte de raréfaction des positions au sommet de l’échelle sociale, est alimentée par de nouvelles formes de représentations de la société. Des groupes, moins définis par leurs positions sociales pénibles que par les obstacles à l’émancipation de celles-ci, émergent sur la scène sociale et politique.
La critique sociale se porte moins sur l’échelle inégale de répartition des revenus que sur l’inégal accès aux emplois les mieux rémunérés. L’important n’est pas que tous les individus aient une position décente mais que tous aient l’égale possibilité d’une ascension sociale.
La justice sociale, fondée sur la compétition généralisée des mérites et des talents, devient un choix librement consenti par les individus- redessinant ainsi le contrat social sur la prévalence des relations interindividuelles aux dépens des relations entre l’État et l’individu.
Dans ce sillage, l’école devient une loterie à somme nulle, chargée à chaque génération d’orienter et de sélectionner les élèves selon leur mérite. Pour s’en assurer en suppléant aux défauts d’éducation familiale, elle propose un tronc commun suffisamment long pour refaire son bagage, provoquant ainsi un allongement des études, et, des programmes spécifiques et prioritaires de remise à niveau – dont la création des ZEP est un exemple.
Le passage à l’école n’ayant malgré tout pas pu rejouer les contingences sociales comme à la loterie – préalable éthique à la réalisation de l’égalité des chances –, l’ordre social de classes éclate en plusieurs entités s’affrontant dans la reconnaissance des discriminations qui ralentissent leur ascension, et dont la manifestation la plus probante est la politique des quotas.
Or, évaluer la réussite de cette politique à l’aulne du ratio des individus discriminés ayant accès aux postes auparavant inaccessibles, ajustant la focale sur la promotion des élites, masque la surreprésentation de ces mêmes populations en bas de l’échelle sociale. Se féliciter de la promotion de quelques femmes au Parlement n’enchante pas le sort de celles qui besognent dans la grande distribution.
Cette forme de hiérarchisation des stigmates, couplée à la valorisation de celui qui œuvre par et pour lui-même, s’apparente à une forme de darwinisme social où les plus faibles sont enjoints de porter le fardeau de leur échec.
Toutefois, deux questions fondamentales pour l’évaluation de cette politique mériteraient d’être envisagées : en quoi la sanction du diplôme opérée par l’école devrait constituer l’étalon de mesure du mérite ? Est-il préférable de disposer des mêmes chances dans une compétition à l’issue incertaine plutôt qu’une place relativement sécurisée et digne ?
La réponse en faveur du modèle de l’égalité des places, en raison de moindres effets pervers, constitue, de l’aveu de l’auteur, un plaidoyer partisan qui vise le renouvellement intellectuel de la pensée de la gauche française. Elle s’oppose à une idéologie libérale de droite qui, sous couvert de liberté individuelle, prône la fiction d’une compétition juste et équitable qui repose sur le mérite de chacun.
Au-delà du coût psychique lié à la frustration des désirs inassouvis par les vaincus de la compétition, du coût social et politique lié à la désintégration des individus plongés dans un atomisme cinglant qui éloigne du sentiment de concitoyenneté – la certitude d’appartenir à une même communauté politique –, le coût environnemental lié au consumérisme sans entraves, le modèle de l’égalité des places est logiquement antérieur au modèle de l’égalité des chances.
En effet, ce sont dans les pays où les écarts entre les places sont les moins importants que l’on remarque une mobilité sociale accrue – équivalent statistique de l’égalité des chances. C’est en réduisant l’amplitude des inégalités qu’il devient plus aisé de les surmonter (les pays scandinaves sont exemplaires à cet égard). Ainsi, la défense d’une politique de redistribution et d’un contrôle étatique plus fort, est moins la résurgence de préoccupations conservatrices que le souci démocratique d’une société apaisée. C’est lorsque chaque sujet est assuré d’un minimum de dignité et de sécurité sociale que son autonomie peut se déployer dans des projets de vie.
D’une part parce que son autonomie et sa liberté ne sont pas entravées par un fatalisme sous-tendu par l’inéluctabilité de la reproduction sociale et d’autre part parce que son appartenance citoyenne n’est pas grevée par une assignation identitaire qui conditionne l’attribution de droits spécifiques.
La poursuite du principe d’égalité doit s’épauler de six mesures prioritaires. Réduire les inégalités de revenus. Renverser la perspective méritocratique de l’école qui, en offrant des études plus longues à ceux qui sont déjà les plus lotis – polytechnique et médecine par exemples –, sanctionne les inégalités sociales de départ. Indexer les retraites sur les risques professionnels et l’espérance de vie des travailleurs aux conditions pénibles et éprouvantes.
Offrir une meilleure qualité de vie à l’ensemble des sujets par l’octroi d’une meilleure répartition des biens collectifs. Peser fortement sur l’économie domestique pour établir une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Et enfin, cesser la logique conditionnelle d’attribution de droits sociaux à la revendication de droits culturels qui compromet les assises politiques du vivre ensemble. C’est en somme dans une société où chacun est libre de ne pas craindre de changer de places que la mobilité et l’autonomie sont les plus dynamiques.