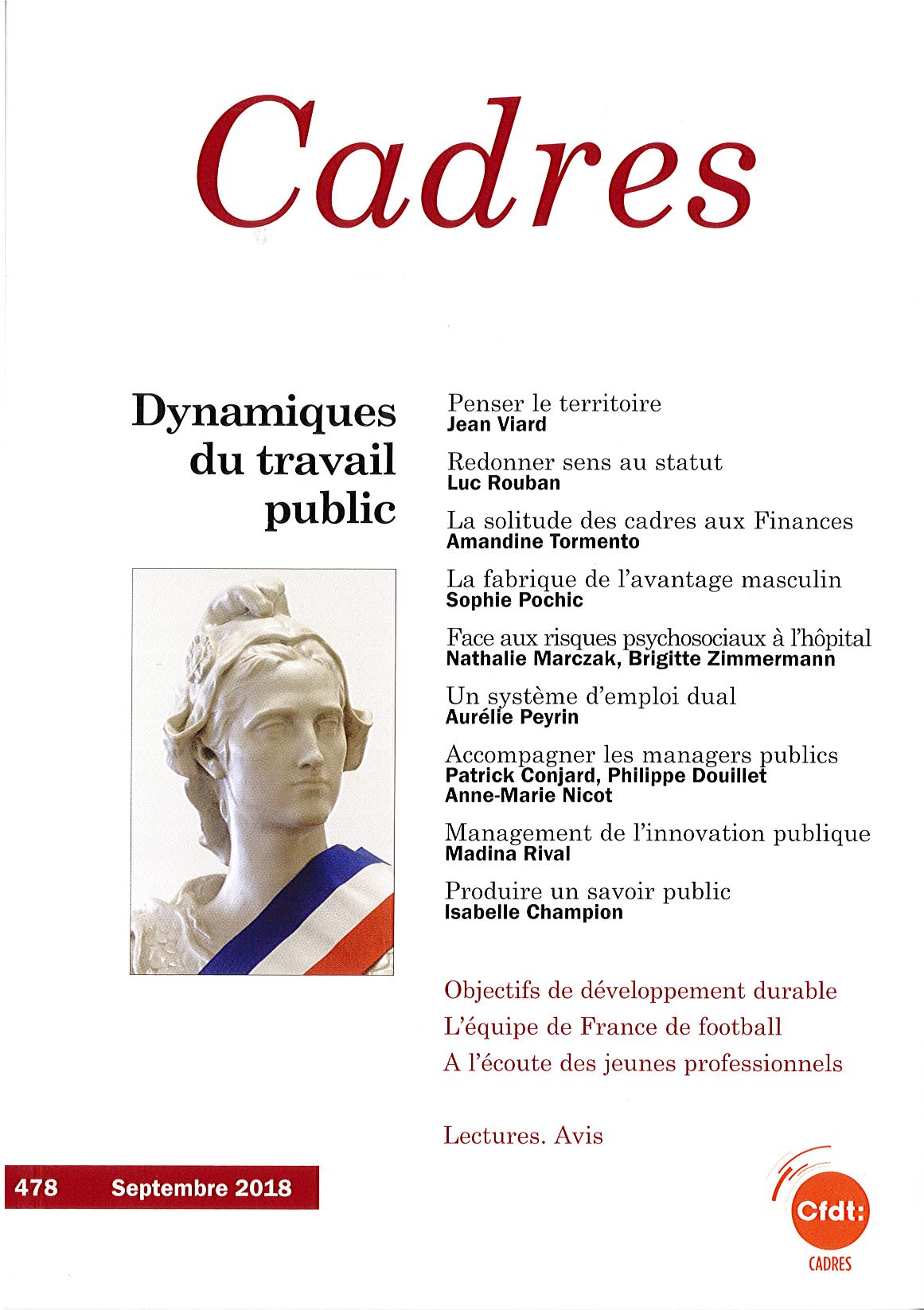Par où prendre la question du territoire aujourd’hui ?
Jean Viard. D’abord, il faut dire que nous sommes entrés dans une société d’individus mobiles où 60 % des bébés naissent hors mariage et où on parcourt en moyenne cinquante kilomètres par jour : ces deux chiffres disent que les anciennes organisations se sont défaites. La famille tient toujours un rôle central, mais c’est une famille tribu, mi-biologique, mi-amicale. Les classes sociales au sens qu’on leur donna après la révolution industrielle ne sont plus guère des réalités vécues ni surtout des réalités géographiques. Nous travaillons 67 000 heures dans des vies de 700 000 heures, les liens qui nous lient sont ceux du hors-travail – école, quartiers, hobbys, engagements, vacances, sport… – tout autant que ceux du travail.
Dans cette société-là, le territoire où nous vivons, celui que nous visitons, jouent un rôle essentiel pour créer des sentiments d’appartenance, de communauté, de protection, de solidarité. On a cru depuis deux siècles, à gauche, que les questions sociales dominaient les questions territoriales. Jaurès n’espérait-il pas que les solidarités de classe ralentiraient les conflits nationaux ? Mais cela ne fut jamais, et de moins en moins aujourd’hui dans cette société d’individus mobiles aux vies de plus en plus libres et discontinues. Alors le nationalisme à nouveau triomphe, au fur et à mesure que la révolution numérique bouscule nos sociétés. Les vieux cadres politiques nés de la Révolution industrielle explosent, les solidarités de travail reculent, le bonheur individuel progresse, mais le projet commun se perd. Dans un sondage récent, 60 % des Français disent être optimistes pour eux-mêmes, mais 67 % sont pessimistes pour la France. Il faut comprendre cette contradiction puissante entre notre bonheur privé grâce aux systèmes de paix et de protection que nous avons construits (école gratuite, Sécurité sociale, caisse de chômage, retraites, HLM…) et notre malheur public, les grandes peurs qui nous traversent et parfois tragiquement nous rassemblent, avec le Brexit, Trump, Salvini, le traitement des migrants…
La politique souvent agite ces peurs, faute de vision d’un futur commun positif et désirable. C’est dans ce contexte qu’il faut s’interroger sur les politiques qui peuvent nous rassembler et nous sécuriser, et ce, d’abord par le territoire qui est notre première matrice. Nous ne reviendrons pas au modèle des Trente Glorieuses qui réussit un temps à nous sécuriser avec ses quatre logiques – mariages, CDI, propriété du logement et droits sociaux peu à peu acquis. Nos vies sont devenues discontinues sur tous les plans, et c’est une liberté extraordinaire… quand les « virages » sont choisis et non subis. En matière sociale, l’enjeu, c’est « le sac à dos social » où les droits s’accumulent au fur et à mesure de nos parcours. Cela pourrait valoir pour les enfants, qui devraient à la naissance avoir droit à la garde conjointe ou alternée de leurs deux parents – sauf exceptionnelle décision de justice contraire. En matière d’appartenance à la communauté nationale, il faut remettre le travail sur l’ouvrage. C’est l’objet même de la note que j’ai donnée à la Fondation Jean-Jaurès.
Des comités de quartier à la fusion des régions, la complexité des niveaux territoriaux nous a fait perdre la notion de territoire. Y a-t-il un échelon privilégié ?
J.V. Nous vivons dans une démocratie inégalitaire. Dans une grande partie de nos 36 000 communes, il y a un élu par pâté de maisons, par famille large. Dans les grandes villes, c’est le contraire, avec un élu pour 5 000 à 10 000 personnes. Sur un même modèle, avec les mêmes règles, le même outil, on a une société qui n’est pas égale dans son organisation publique. Quand j’étais conseiller municipal de Marseille, nous nous réunissions à 102 élus, fiers d’être dans la lignée de celles et ceux qui réfléchissent à comment organiser cette ville historique depuis… trois mille ans. Mais ce pour représenter 800 000 habitants !
Cela étant, les Français sont attachés à la vie communale. La République est bâtie sur les communes et on devrait profiter de la construction des puissantes métropoles pour engager un double mouvement : favoriser le rapprochement des petites communes pour leur donner plus de poids face aux métropoles et, dans les métropoles, créer de nouvelles communes pour construire une vie communale de proximité réelle pour organiser la vie locale. L’échelon de base pourrait alors correspondre à la zone d’éducation d’un collège. Dans les grandes villes, le découpage actuel en secteurs ne suffit pas, car cela reste très formel (les 20 % de HLM, par exemple, ne sont pas par secteur). On pourrait même créer des communes puissantes dans les quartiers populaires des grandes cités, mais à l’intérieur des métropoles bien sûr. Un exemple : Le Mirail à Toulouse pourrait devenir une commune à part entière. Les 60 000 habitants auraient droit à un maire, à des employés municipaux, à un commissariat, à des pompiers… et ainsi exister en tant que communauté politique partie prenante dans la gestion de la métropole. Prenons les quartiers Nord de Marseille. Ils sont absents des radars de la métropole depuis trente ans : peu de services publics, peu de fonctionnaires résidents, pas même des services techniques qui feraient de ces quartiers des acteurs de la vie de la grande métropole. Faire participer les citoyens, c’est les rendre acteurs de la vie publique. Les habitants des quartiers Nord de Marseille sont-ils d’accord, par exemple, pour que ce soit chez eux que se construisent toujours les HLM au lieu de les répartir dans toute la métropole ? Une commune de l’Estaque avec 200000 habitants pourrait s’imposer au conseil métropolitain. Dans une société où les classes se défont, il faut construire une égalité par les territoires politiques.
Cette question nous traverse depuis le dix-neuvième siècle. Depuis Jules Ferry, on cherche à enraciner la République dans le territoire pour calmer une société urbaine instable post-1789 (1830, 1848, 1870…). C’est pour cela que les républicains ont bâti une République paysanne, appuyée sur 36 000 communes et 500 000 élus locaux, capable de stabiliser le pays face aux révoltes urbaines et ouvrières. Aujourd’hui, saura-t-on enraciner la République dans les quartiers comme on l’a fait dans les villages ? Concrètement, c’est « faire communauté ». Mon idéal, c’est de le faire à partir du collège. On se connaît parce que les enfants vont à l’école ensemble. Un collège, c’est une communauté humaine, donc une communauté politique. Puis on les agrège en communauté de communes ou en métropole. L’enjeu est de créer des communautés du quotidien – l’éducation des enfants en est un des critères centraux, alors que la France des villages a été bâtie autour des paroisses catholiques, ce qui pose un problème dans une société qui se revendique laïque.
Le bon échelon de la démocratie locale est celui où il y a du lien communautaire quotidien. C’est important dans une société de discontinuité comme la nôtre. Chacun de nous parcourt en moyenne des dizaines de kilomètres par jour. On est de plus en plus rarement le voisin de son collègue de travail. On a des amis du week-end, des vacances. Les colos se vident. Il y a peu de couples qui travaillent ensemble, même aujourd’hui dans l’agriculture. Alors dans cette société de mobilité et de discontinuité, il faut refaire communauté par le territoire parce qu’il est de moins en moins possible de faire société par l’emploi : la durée moyenne d’un CDI est de onze ans, la rotation professionnelle s’accélère et nous sommes devenus une société de biactifs. Or à quel endroit faire société si ce n’est le lieu où l’on vit ? Ce qui bouge le moins, c’est le logement. On déménage très peu quand on change de travail. Trois millions de Français quand même chaque année, mais surtout pour des évolutions familiales (études, séparation, retraite, décès). Le lieu premier de la communauté est donc le territoire de vie quotidienne, souvent choisi (pour ceux qui ont le choix) en fonction de la qualité des écoles et de la qualité de vie. Le territoire, c’est un phénomène objectif – le marché du travail, les courses, l’école, les loisirs, la culture… – et un lieu d’appartenance et de mémoire. Voyez l’attachement de chacun à son département, par exemple, qui crée des limites symboliques.
Comment passer de cette attention au fait social local à une pensée unifiée du territoire ?
J.V. Cette pensée du territoire local est essentielle à l’heure où les grands ensembles géopolitiques – États, unions d’États, anciens empires – sont questionnés, mis en concurrence. De formes nouvelles de nationalisme rentrent au sein de nos sociétés. Il y a deux nationalismes : celui de la frontière (exalté par les extrêmes et les populismes), et celui du sol, plus ouvert. La France va-t-elle être d’abord définie par des frontières, ou par son sol, sa qualité, sa durabilité, sa beauté, sa mémoire…? On pourrait favoriser un « souverainisme du sol » écologique et culturel. On garantirait un sol durable pour les générations futures, la protection juridique définitive des terres arables (cultivables, exploitables, y compris pour de l’énergie renouvelable) qui sont en diminution régulière de 1 450 hectares par semaine en France. On garantirait à chaque Français la connaissance de ce grand livre de la communauté qu’est le territoire de la patrie par un voyage en France de tous nos jeunes pendant quinze jours pour qu’ils apprennent « la France » charnellement. Une idée à intégrer dans le futur service civique universel. On a protégé le beau, le naturel, le culturel par des parcs régionaux et nationaux, il faut protéger maintenant dans une « pensée COP 21 » les terres arables (la moitié du pays) et faire communauté par le partage charnel de « notre » sol. Est français qui connaît la France… et ses valeurs.
Pensons trois pôles : les terres arables, le cœur des métropoles qui sont comme des mines de ressources et, entre les deux, les territoires populaires, périurbain et banlieues, où on habite et produit. Je cherche à valoriser cette « pensée de l’espace » : des terres protégées (sauf besoin d’intérêt général), dix métropoles (la vitalité urbaine est accélérée par le développement du numérique1) qui font à elles seules 50 à 60 % du PIB. Et entre les deux, le maillage des quartiers, des petites villes, des bourgs, des villages, en comprenant que ce sont les métropoles qui sont les moteurs de l’économie mais qu’ensuite il faut relier, redistribuer, diffuser. Les métropoles, ce sont les espaces où la pratique physique et la réalité numérique se rencontrent. La Toile est partout, mais certains sont en plus en hyper centre. Ils ont un double bonus.
Ce choix détermine une zone centrale, celle du périurbain et des banlieues, celle de la France résidentielle, de la France populaire à laquelle il faut garantir un accès à la métropole en lui donnant des formes politiques puissantes pour négocier, dans le cadre des Régions, avec les métropoles. Le contrat Région/métropole et le droit pour tous à la métropole doivent devenir le moteur des politiques régionales. Elles doivent répondre aux besoins des habitants hors métropoles en matière d’accès aux richesses qui se concentrent dans les métropoles dans les domaines de l’éducation, de la santé, des loisirs, de l’innovation. Et à l’inverse, l’habitant des métropoles recherche nature, grands espaces, produits agricoles de proximité, loisirs, villages, patrimoine… Le Pass Culture, par exemple, c’est bien, mais à condition d’y intégrer la charge transport.
Le migrant, aujourd’hui, est le symbole du sol qui nous manque. La peur du réfugié, c’est celle de perdre son propre sol. Enjeu faible en termes quantitatifs, mais qui est fort en symbolique. Aussi devons-nous garantir nos terres arables et notre territoire construit, culturel et mémoriel pour adoucir la peur de l’autre.
Vous appelez ainsi à « faire à nouveau France par le territoire » notamment par une politique des métropoles.
J.V. Au niveau national, le territoire France est soumis à des pressions diverses. La France de l’Est et du Nord, anciennement minière et industrielle, n’a pas de centre, pas de grandes métropoles. Strasbourg est une métropole de petite taille qui ne dirige pas sa grande région et Lille est une métropole émergente. Autres zones, celles vouées au retour à la nature, telles que le Massif central ou le cœur de la Bretagne, par exemple, qui sont des zones en retrait dans notre modèle de vie et de production – la Provence, l’Occitanie ont connu cela au dix-neuvième siècle – mais qu’il faut aider en protégeant les forêts, les rivières… Là, il nous faut inventer une manière de valoriser financièrement l’eau et l’air produits ! Ces territoires contribuent à la richesse commune en apportant ces biens communs fondamentaux ! L’État pourrait les doter en ce sens, et en faire des lieux de retraite et de ressourcement. Autres lieux, les dix métropoles, qui rayonnent sur quelque cent kilomètres autour d’elles : l’Île-de-France (dix millions d’habitants), Aix-Marseille (deux millions), Lyon (deux millions), l’axe Toulouse-Montpellier (un million), Bordeaux, qui est récemment entrée dans la cour, Nantes… Le TGV renforce le dynamisme de ces métropoles. Un exemple concret : avant le TGV Paris-Lyon, seul le directeur de l’agence BNP prenait l’avion et travaillait entre les deux villes. Avec les deux heures de train, c’est tous les responsables de bureau qui participent aux échanges : le TGV a banalisé la mobilité, descendue hiérarchiquement dans l’entreprise.
Ces métropoles doivent être ancrées dans une grande région. Je pense que le fiasco de Notre-Dame-des-Landes vient en partie du fait que l’aéroport n’aurait pas été au cœur d’une grande région Ouest, la Bretagne et les Pays-de-la-Loire ayant voulu rester séparées. On veut un grand aéroport ? On ferme celui d’Angers, on fait un RER Rennes/Nantes, etc. : on fait une politique de grande région en créant des transports rapides entre ces villes, dont Saint-Nazaire. Bref, on crée une dynamique de métropole à deux millions d’habitants. L’aéroport aurait été le cœur d’une métropole diffuse, irriguée par des actifs rendus tous à vingt minutes d’un hub international. Nantes a du mal à penser son Sud, à intégrer la dynamique de La Rochelle et à réintégrer la Bretagne. Pourtant, la transformation de la ville est magnifique.
Il nous faut une pensée des métropoles qui soit à l’échelle internationale. Se regarder à l’échelle mondiale. Pour moi, les capitaux chinois dans l’aéroport près de Toulouse, c’est la garantie de faire connaître la ville à l’autre bout du monde. Tout élu local devrait penser sur deux axes : les petites réalisations de la vie quotidienne et les liaisons lointaines stratégiques. Du quotidien et de la liaison. Du local et du global associés, du macro et du micro. Les fiertés internes et la vision stratégique. Marseille a une forte identité tout en cultivant des liaisons lointaines. Les ports se connaissent entre eux. Et l’essentiel du trafic économique se fait par la mer. Marseille s’oppose à Paris, mais s’ouvre à la route de la soie !
En démocratisant l’école, on a fait des établissements scolaires le cœur du lien social. La construction des réseaux des individus se tresse, encore une fois, autour du collège. La majorité des couples se fait dans ces sphères-là. Les lycées et les collèges sont des outils puissants de structuration du territoire. Il faut faire une politique familiale d’aménagement du territoire. Le cœur du lien dans la société, c’est la famille dans sa diversité – pas au sens institutionnel, car 60 % des naissances ont lieu hors mariage. On voit ses parents vingt ans de plus que la génération d’avant avait vu les siens car on vit vingt ans de plus. On est dans une famille-tribu : 70 % des gens partent en vacances en famille. Et la majorité de nos déplacements sont pour la famille. La famille est l’essentiel du marquage territorial. C’est pour cela que les logements sont au cœur de nos sociétés modernes. On loue, on achète, on établit un logement, et autour on rayonne. Le bonheur quotidien, c’est un petit jardin, qu’ont plus de 60 % des Français si on compte les résidences secondaires. Les cadres ont une mobilité plus puissante que les autres actifs.
La solidité de la société française, c’est aussi son ancrage dans une paysannerie même symbolique, celle des jardins et du territoire, et malgré un taux élevé de chômage, un taux d’emploi qui ne cesse d’augmenter. Fort chômage et élévation continue du nombre de personnes au travail. Près des deux tiers des emplois créés ces trente dernières années sont féminins. Nous vivons une révolution culturelle profonde : montée de l’individu, montée de l’autonomie des femmes, montée de la mobilité ; donc, le territoire, et le territoire familial, est un enjeu central. 40 % des emplois sont tenus par des gens qui s’occupent du corps des autres (éduquer, soigner, divertir), 30 % gèrent la logistique de la société, 10 % travaillent le sol, et donc seulement 20 % produisent et entretiennent des objets. Ce modèle-là, il faut le spatialiser. L’essentiel des emplois du corps, du sol et de la logistique, ce sont des emplois de la proximité des habitants. La médecine, l’éducation, la culture, l’agriculture, le commerce… sont proches de votre domicile. Il faut mettre ce monde nouveau en récit pour avoir moins peur des bouleversements et trouver les bons angles d’action et de lutte.
D’où l’intérêt d’articuler le privé et le public. Un élu local doit partir de la culture économique de son territoire. Dans le Sud où je vis, la culture, c’est l’accueil : retraites, touristes. À l’Ouest, la façade atlantique a réussi à s’approprier l’image d’authenticité, de tradition, de qualité de vie urbaine. Il s’agit aussi d’identifier les liens entre la bourgeoisie locale et le territoire. À Bordeaux, c’est une bourgeoisie de foncier. À Lyon, une bourgeoisie industrialisante. À Lille, une bourgeoisie du commerce. Comme à Marseille, qui est une ville de liens – le modèle de la petite entreprise familiale méditerranéenne – et non de production… Les Régions sont un plus par rapport au niveau national si s’y déploient des savoir-faire et des savoir-être qui se surajoutent au modèle national.
Quelle est la place de l’État dans votre approche territoriale ?
J.V. Il y a besoin, dans cette territorialisation, d’une verticalité. L’État est le pilote du visible dans la mondialisation. La décentralisation a fait croire que le local est un micro-État. Or, les Régions ont comme rôle de lier horizontalement chaque territoire, mais pas de se substituer à l’État. Elles doivent relier les métropoles et le hors-métropole et les terres arables. Chaque territoire doit être piloté à l’aune de ces trois entrées qui ont besoin de liens horizontaux. Et ce, dans le cadre de chaque culture régionale. L’État doit comprendre que ces diverses entités émettent une logique propre de liens et de développement. Il doit avoir une vision globale de toutes les forces locales des territoires dans leur singularité. Créer de la verticalité en s’appuyant sur les logiques culturelles et économiques régionales. Avec une approche spécifique pour l’Île-de-France. Là, je pense au projet de la Région Grand Paris que je soutiens, avec cette question de l’accès à la mer : un projet jusqu’au Havre ou par Marseille ? Est-ce qu’on fait le canal vers les ports du Nord ? Il n’y a pas de grande nation qui ne soit pas gouvernée par une grande zone maritime : New York, Shanghai, l’Allemagne rhénane, Londres… Les grands pays terriens sont très handicapés dans la mondialisation. Encore une fois, la plus grande part des flux entre pays est maritime. Le Grand Paris doit faire de l’Île-de-France le New York de l’Europe. Regardez la spécificité d’Eurodisney : c’est un territoire international à l’échelle européenne intégré à Paris au sens large. Ces réflexions-là, on ne les donne pas aux Français ! On devrait les faire rêver avec de grandes ambitions territoriales. Leur dire que Paris n’est plus seulement leur capitale, mais la global city européenne, que le cœur de l’Europe est ici, avec le New Paris, première zone mondiale quant au nombre de chercheurs. Que chaque région a sa dynamique, et que le rôle de l’État est de voir les différents développements, de compenser s’il le faut, les associer aussi.
L’État doit valoriser les liens horizontaux et avoir l’intelligence des dynamiques, des comparaisons. Et apporter des moyens adaptés. Pourquoi attribuer de l’argent public à Lyon alors que la métropole s’est créée trente ans avant les autres ? C’est une ville où il y a tout : industries, services, traditions, ancrage social (74 % des Lyonnais sont nés à Lyon), accès à la montagne et à la mer. Un territoire qui crée des richesses est un territoire qui réfléchit à tous ces axes. C’est à partir de la connaissance de la culture et de l’histoire locales qu’on peut tirer des politiques publiques. Comprendre le destin des territoires dans leur diversité. Certains doivent rester modestes : qualité de vie quotidienne, des écoles, de quelques singularités locales ou de la complémentarité entre villes moyennes qui ne réussiront pas toutes de la même manière. On peut même envisager une politique de régression en cas de baisse de la population : moins d’investissements, plus de qualité de vie. D’autres ont un destin mondial. Mais regarder les cultures, les usages, les flux de population. Aucun ne doit avoir le même modèle. L’État doit penser la diversité de la France. Cela facilitera l’intégration des nouveaux arrivants et la confiance des Francais dans le destin de leur nation.
1 : Cf. Pierre Veltz, La Société hyper-industrielle ; le nouveau capitalisme productif, Seuil, 2017.