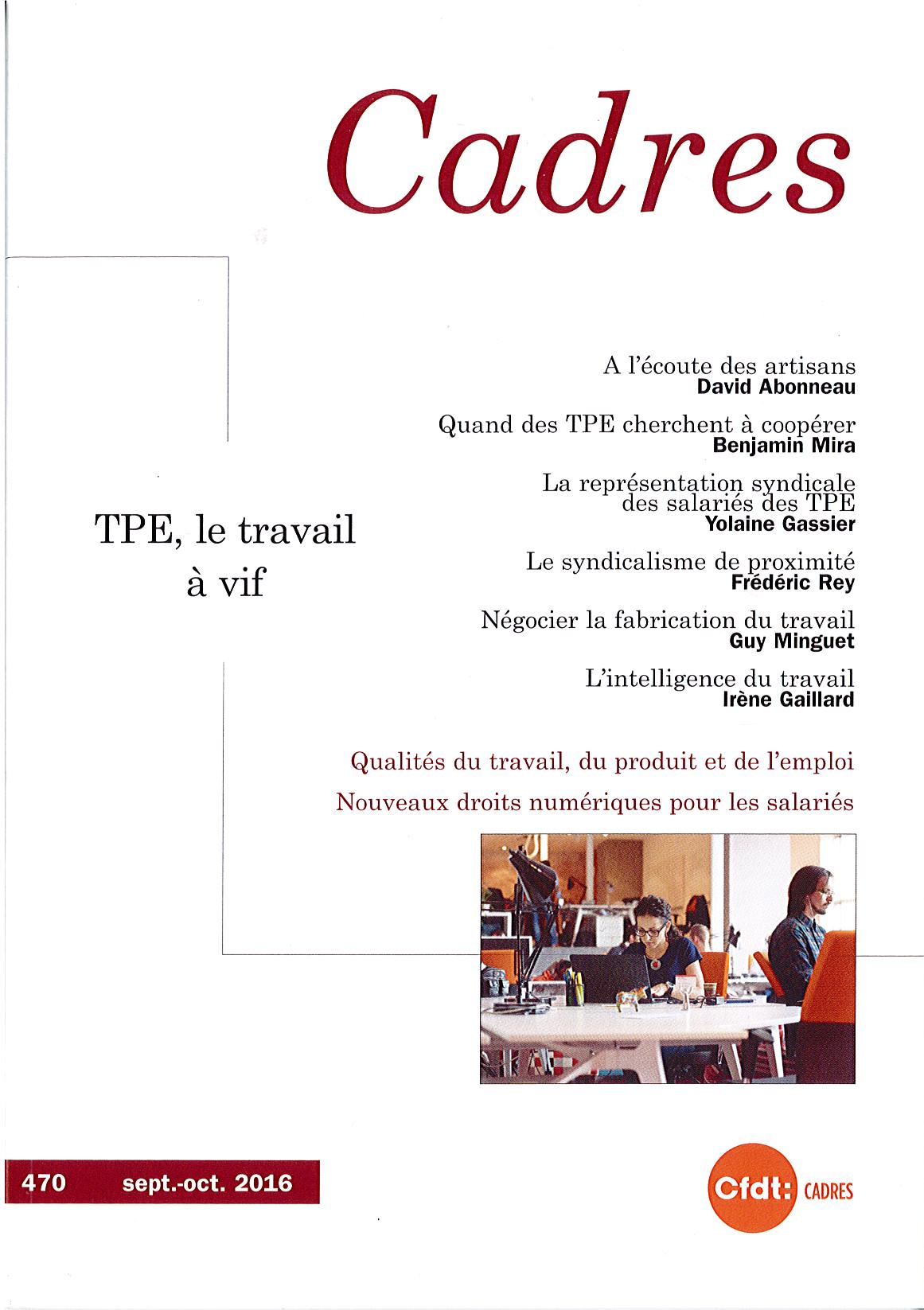Le Comité national de la CFDT Cadres est centré cette année sur les liens à établir, comme objectifs de l’action syndicale entre qualité de la production, qualité de l’emploi et du contrat de travail, qualité de l’organisation et du travail lui-même. Vouloir lier ces différentes formes de qualité soulève quelques défis pour le syndicalisme.
Le lien entre qualité de l’emploi et qualité de la production
- La qualité de la production ne suffit pas à garantir celle de l’emploi. Le syndicalisme s’est même longtemps battu pour séparer les deux : si la production n’est pas appréciée, l’employeur qui a la responsabilité des investissements, de l’organisation et des recrutements, doit en assumer les conséquences et maintenir les emplois. Le droit du travail reflète aussi une conception actant une certaine irresponsabilité des salariés à l’égard de la pérennité de leur emploi. Nous savons pourtant depuis au moins une quarantaine d’années que les employeurs multiplient les contrats atypiques pour s’exonérer de leurs obligations et que lorsque l’entreprise perd « ses » clients, ce sont « ses » salariés qui trinquent. D’où cette première interpellation : peut-on continuer à faire comme si l’employeur était seul à affronter le risque du marché et comment le syndicat peut-il s’en prémunir en se souciant de la qualité produite ?
- La qualité de l’emploi ne garantit pas non plus celle de la production. L’histoire sociale est hélas pleine de faillites de coopératives et associations qui, ayant pris leurs emplois pour finalité, ont tout perdu par oubli de l’avis des clients et usagers qu’elles devaient servir. D’où cette deuxième interpellation, plus difficile à accepter : la qualité d’un produit ou d’un service résulte in fine d’une appréciation extérieure aux producteurs.
- Pour certains, trop de qualité de l’emploi nuirait à l’emploi, il faudrait enlever les protections pour libérer les énergies créatrices sources de croissance. Peut-on plus mal poser le problème opposant vrais défenseurs de protections et pseudo-résignés ? Sur une autoroute les glissières protègent, mais si le tracé change elles gênent, la question n’est pas de les supprimer mais de les déplacer, de les mettre au bon endroit pour qu’elles soient protectrices et non obstacles. C’est la troisième interpellation plus complexe : pour définir des protections effectives, il faut tenir compte à la fois du paysage (le marché ou la politique publique), de la destination (la stratégie d’entreprise) et des conducteurs (les salariés « auto-moteurs »).
La qualité, source de fierté et de bien-être au travail
Pour éclairer ces défis, j’aimerais évoquer deux histoires qui m’ont marqué en interrogeant de simples opérateurs sur ce dont ils étaient fiers dans leur travail - cette notion de fierté dont j’ai toujours constaté qu’elle exprimait le mieux à la fois la valeur apportée par un individu et la satisfaction qu’il en retirait.
- Une histoire d’éponge de cuisine avec un opérateur en bout de ligne qui devait faire attention au fait que le tapis d’éponge ne gondole pas sous le massicot, sinon les éponges auraient des bords biais, et au fait que le film cellophane qui les entoure ne fasse pas de ride, sinon l’emballage serait froissé. En professionnel conscient, il veillait d’abord au premier point : si ça gondolait, il arrêtait tout pour re-régler sa machine, si ça ridait c’était moins grave, il corrigeait au fil de l’eau. Pourtant il apprit que « ses » éponges à emballage froissé avaient été renvoyées par les magasins : le défaut de l’enveloppe n’était donc pas secondaire comme il le pensait, sans doute indiquait-il une négligence qui augurait mal du produit lui-même. Il décida d’inverser sa pratique, désormais il arrêtait quand ça ridait et corrigeait en continu quand ça gondolait, après tout une éponge un peu de biais, ça allait aussi, en tout cas n’a-t-il pas eu de retours. Cela aurait pu lui être transmis par son chef, par une nouvelle consigne, qu’au nom de sa connaissance du produit et de sa fierté, il aurait trouvée absurde. Ce qui comptait pour lui et qu’il tenait à me raconter, c’est qu’il avait pu se rendre compte et décider lui-même de ce qu’il valait de faire.
- Une histoire de toile abrasive, où la montée en qualité de la gamme conduisait à multiplier les séries courtes de produits plus spécialisés. Quand on passait sur la même machine de l’encollage sur la toile de « petits grains » à des « gros grains », il n’y avait pas trop de problèmes, mais quand c’était l’inverse, un gros grain restant au milieu des petits, ça gâchait tout ! « Quand même, me racontait l’opérateur, un seul sur un million ça devait être acceptable », jusqu’au jour où, participant à un groupe qualité avec des techniciens et un ingénieur, il était allé enquêter auprès d’anciens clients. L’un, fabricant de coques de navires en plastique, leur avait montré d’un geste ample la rayure que provoquait un seul grain mal placé, qui obligeait à tout reprendre et qui du coup ne justifiait plus le surcoût d’une toile spécialisée. Cette histoire, il l’avait racontée aux autres de son équipe et de ce jour, plutôt que regarder avec ironie les ingénieurs se gratter la tête, ils étaient tous devenus chasseurs de gros grains participant à reconfigurer chaque pièce de la machine. C’était là sa fierté : montrer où ça clochait. Cette affaire, où sans lui se seraient empilés les consignes et les contrôles, était devenue la sienne.
Ces deux opérateurs avaient mis le client dans leur tête. Ils l’avaient au bout des doigts. Leur fierté était de se sentir agir en professionnels (le « pro » : celui qui agit pour, et auquel on peut se fier) et plus seulement en exécutants. Il vaut la peine d’ajouter que cette usine, 3M à Beauchamp, avait fait de la responsabilisation des opérateurs, et du changement de pratiques que cela engendrait pour les techniciens et ingénieurs, son atout dans un groupe multinational qui venait implanter là ses technologies les plus sophistiquées plutôt qu’en Allemagne, en Italie ou même aux États-Unis. C’était il y a dix ans, le module « abrasif » a fermé, ses opérateurs réputés réactifs ont retrouvé un emploi sans difficulté dans l’usine ou le bassin, preuve de la valeur de leur compétence acquise, leur meilleur passeport pour l’emploi.
Ces deux histoires mettent l’accent sur une direction importante des nouvelles formes d’organisation : compte moins l’illusion de pouvoir tout prescrire que les efforts pour outiller des coopérations dont le ciment est plus constitué par l’accord sur des objectifs que par des consignes censées assurer une coordination entre individus par ailleurs cloisonnés dans leur rôle. L’encadrement s’y découvre une autre responsabilité : celle de développer l’autonomie de ses subordonnés en sortant de l’injonction, de la défausse et de la culpabilisation.
Le client est dans l’entreprise
Les modes de performance actuels sont « orientés clients et usages », orientés vers le service rendu et la valeur d’usage et plus seulement « orienté produit » et la valeur d’échange. Le bas prix est moins déterminant pour constituer un marché que l’originalité et l’ampleur des utilisations possible d’un produit. Le client qui venait comme acheteur à la porte de l’entreprise, la pénètre comme si son ombre guidait la conception des produits et évaluait l’utilité de chaque activité. La notion de « surqualité » traduit bien cela, qui désigne non une qualité superflue - elle peut au contraire être jugée unanimement très utile - mais une qualité qui n’a pas d’acheteur prêt à en payer le prix, cela vaut aussi pour un service public dont les contribuables refusent la charge. Cette façon de revisiter toute production en considérant non plus le produit comme donné et le prix comme ajustement, mais le prix comme déterminé et le produit comme s’y ajustant, chamboule nos formes de gestion héritées de l’ère industrielle :
- Les maître-mots de l’organisation ne sont plus « calcul, programmation et consignes » mais « ajustements, défis et interactions » : est bien organisé non plus ce qui a été bien prévu -il y a toujours un manque - mais ce qui a permis à tous de faire face aux difficultés, chacun y mettant du sien. La hiérarchie se trouve mise en difficulté, il ne suffit plus de coordonner, il faut obtenir que chacun coopère ; il faut faire émerger un sens partagé qui ne peut être fixé d’autorité. Dans ce contexte, les discussions sur la qualité produite, sur les figures présumées de clients, sur leurs types d’attentes et d’exigences, sur les manières de faire et les moyens pertinents pour y répondre, deviennent un support essentiel d’ajustement des relations de travail. Ces discussions sur le travail permettent d’objectiver, hors des contraintes hiérarchiques vides de sens, les finalités qui donnent leur raison d’être aux coopérations. Ces discussions sont vives où on parle boulot et rares dans les sections syndicales plus tournées vers les conditions d’emploi. Pourtant les conflits qu’elles expriment, et la prise en compte des différences qu’elles permettent, sont sources d’innovation et de solutions plus complexes. Elles conditionnent la performance compétitive et au final en partie l’emploi,
- Il y a là l’opportunité d’un travail mobilisant plus pleinement les qualités des individus, et en même temps le risque d’une détresse plus grande s’ils sont laissés à eux-mêmes et n’en voient pas le retour. « C’est plus dur, mais c’est plus intéressant » ai-je souvent entendu dire dans mes enquêtes, surtout de la part des salariés les moins qualifiés. Ces modes d’organisation appellent pour être soutenables une évolution des relations professionnelles pour accompagner l’initiative et le développement professionnel de chacun. L’appel à être compétent et pas seulement qualifié se traduit par une diversification des pratiques et une individualisation des parcours avec laquelle le syndicalisme est encore mal à l’aise. Pourtant, s’emparer des clients, ou des usagers du service public, n’est-il pas une source d’intérêt au travail et d’autonomie par rapport à la hiérarchie et à l’employeur ? Cela contribue au bien-être individuel et aussi à faire exister l’entreprise comme collectivité professionnelle et pas seulement société d’actionnaires. Chacun en a besoin, pour se risquer plus individuellement.
- Ce repositionnement entre employeurs, clients-usagers et salariés, reconnaissant un rôle plus actif à ces derniers, engage aussi une évolution du droit du travail : preuves récentes en sont la « loi Qualité de vie au travail » et la « loi Travail » instaurant un compte personnel d’activité et accordant plus d’importance à l’entreprise comme lieu d’élaboration de compromis complexes. Progressivement - « progressistement » oserait-on écrire - s’instaure une conception plus complète de l’individu au travail, impliqué et pas seulement exécutant, respecté dans son bien-être physique et mental et pas seulement son intégrité corporelle, considéré comme capable d’autonomie et de développement et pas seulement d’obéissance. La notion même de subordination évolue : il ne s’agit plus seulement de fixer des bornes au pouvoir de prescription de l’employeur, petit à petit le droit dessine les conditions de coopérations équilibrées liant le développement des entreprises et celui des individus.
La triangulation des rapports employeur, clients-usagers et salariés
Deux constats dérangeants viennent bousculer notre vision du contrat salarial tel qu’il s’est construit dans l’ère industrielle.
- Dans des marchés plus fluides où l’innovation, où qu’elle se produise dans le monde, joue un rôle croissant, on ne peut plus compter sur le seul employeur pour assurer l’emploi, au mieux l’employabilité. Le contrat de travail n’offre plus de protection juridique qui vaudrait contrat d’emploi, la sécurisation des parcours professionnels implique de dépasser l’entreprise.
- L’entreprise de son côté ne s’en sort plus - et ne conserve plus ses emplois - si « ses » salariés n’y mettent pas du leur, s’ils ne font que ce qui leur est dit. On le disait pour les cadres, mais cela devient la norme pour tous les salariés, même ceux auxquels n’est reconnue qu’une faible qualification. La façon de faire de chacun, et pas seulement la bonne stratégie ou la bonne organisation, a un impact sur la santé commerciale de l’entreprise. C’est évident depuis toujours parlant du garçon coiffeur ou du mécano garagiste qui répare votre voiture, mais ça l’est tout autant, comme le remarque Jean-Paul Bouchet, pour l’employé d’une SS2I qui construit des ponts algorithmiques pour une autre entreprise.
Là où nous nous étions habitués à un contrat de travail mettant les capacités du salarié à disposition de l’employeur et où ce dernier garantissait l’emploi et assumait le risque du marché, nous sommes aujourd’hui dans une situation plus complexe : le salarié n’est pas quitte de son travail en se contentant du prescrit, il doit en outre en comprendre et intégrer les finalités ; l’employeur n’est pas quitte du contrat en respectant les conditions d’embauche, il doit en outre favoriser le développement de chacun.
Là où le client restait en quelque sorte caché derrière l’employeur, il est devenu présent pour le salarié. Il se produit une triangulation des relations et une dissociation entre le contrat de travail explicite (avec le seul employeur) et le contrat d’emploi (qui suppose la satisfaction des clients) qui l’accompagnait implicitement. Ce contrat d’emploi implicite n’est plus assuré aujourd’hui et a besoin d’être reconstruit car il est un élément essentiel de l’implication d’un salarié dans le développement de « son » entreprise en rendant crédible en retour l’espoir de son propre développement.
Renforcer le contrat de travail par un contrat ou une convention d’emploi
Le contrat de travail, explicité au moment de l’embauche, fixe les conditions dans lesquelles s’exerce le travail. Le contrat d’emploi, plus personnel et pour l’essentiel implicite, l’inscrit dans une continuité en reconnaissant que le salarié impliqué dans le développement de « son » entreprise, y acquiert des droits concernant son propre développement. Ce développement est aujourd’hui un nouvel objet de politiques RH et de dispositifs de travail, plus rarement de négociations, visant à obtenir l’implication de bonne foi des salariés dans l’activité de l’entreprise. C’est le résultat de la pression concurrentielle s’exerçant sur les employeurs qui ont besoin de cet engagement pour assurer leur réussite : s’ils peuvent coordonner des gens sans leur avis, ils ne peuvent les « coopérer » sans qu’ils y mettent du leur ! C’est une avancée, mais ces dispositifs restent inscrits dans un cadre hiérarchique alors que pour s’impliquer pleinement dans les finalités de « leur » travail et de « leur » entreprise les salariés ont besoin de trouver la distance personnelle et l’appui collectif qui leur permette de le faire sans devenir pour autant plus dépendant de leur employeur. C’est une condition de l’effectivité de leur contribution à la production comme de leur bien-être et tout simplement de leur santé.
C’est pourquoi il faut accompagner le contrat de travail de garanties collectives concernant l’implication du salarié dans le développement de « son » entreprise, ce que nous avons appelé ici contrat ou convention d’emploi, car cette implication favorise la pérennité de l’entreprise et de « ses » emplois. Risquons-nous en conclusion à indiquer quelques pistes.
- Celle de l’appui syndical tout d’abord, car il n’y a pas d’autonomie individuelle sans appui sur un collectif et sans se sentir défendu. Cela est indispensable pour se sentir légitime à prendre des risques, voire défendre un point de vue dont on sait a priori qu’il ne plaira pas forcément à sa hiérarchie. Le syndicat doit non seulement accompagner le salarié dans ses évolutions de carrière (c’est là le caractère principal d’un syndicalisme de service), mais aussi intervenir pour que les procédures de discussion au travail permettent une parole libre sur les insuffisances constatées comme sur les solutions à suggérer.
- Celle d’une revalorisation du travail concret, d’abord par des informations et des temps d’échanges sur les contenus du travail, les moyens et les manières de faire, permettant à chacun d’agir en connaissance de cause. Le salarié, pour avoir prise sur son activité et sur son avenir, doit savoir où on l’emmène, les finalités qu’il sert, ce qu’on attend de lui et de l’équipe dans laquelle il coopère. Il faut aussi un comportement de l’encadrement qui sorte de l’injonction : payer le salaire n’ouvre pas le droit de commander sans s’expliquer. Des coopérations confiantes impliquent de la réciprocité dans les évaluations et les moyens d’améliorer l’organisation et les comportements.
- Celle d’une reconnaissance de l’implication et des initiatives prises. Le sale travail est celui qui use l’individu sans lui ouvrir d’avenir. La torture au travail - on dit que le terme vient de tripalium, un instrument de torture - n’est pas tant l’effort fourni que l’incertitude sur ce qu’il produira et ce qui pourra être récolté. Il ne peut y avoir de motivation et de bien-être au travail sans perspective de développement et de progression professionnelle. Le salarié doit sentir qu’on compte sur lui et qu’on lui donne les moyens de faire, mais aussi qu’il est respecté pour ce qu’il apporte et attendu en vue de nouvelles opportunités d’apprentissage, d’acquisition d’expérience, de formation et de mobilité,
- Celle d’une claire séparation des aspects professionnels et privés. L’implication du salarié ne peut être un engagement total. L’individualisation des relations de travail n’entraîne pas leur psychologisation, au contraire l’individu pour exister dans son rôle doit sauvegarder la part qui lui est propre, sa personne et sa vie privée. L’émergence des individus dans nos sociétés modernes a impliqué que soit énoncée la séparation des ordres publics et privés pour qu’ils y trouvent leur place comme citoyens, de même l’individualisation au travail implique de reposer les limites de l’espace professionnel face à des formes de management proche de la manipulation psychique, même lorsqu’elles s’exercent au nom d’un souci de l’humain voire d’une illusoire volonté de soin. Cela implique aussi des règles de respect de la vie privée face à l’envahissement du travail connecté.
Le syndicalisme a été capable dans l’ère industrielle de rendre digne la subordination des salariés à l’entreprise en la détachant des formes de pouvoir personnel qui la rapprochaient d’une forme de soumission. Il a maintenant devant lui le défi de rendre digne la coopération au travail permettant à chacun de s’impliquer de son plein gré dans « son » travail. Cela n’appelle pas à moins de conflictualité, mais à en changer les formes : toute coopération est conflictuelle, mais le conflit peut être coopératif. Le fait que les employeurs soient plus dépendants aujourd’hui de la bonne volonté mise par leurs salariés constitue aussi, si elle peut s’exprimer collectivement, un élément de rapport de force.