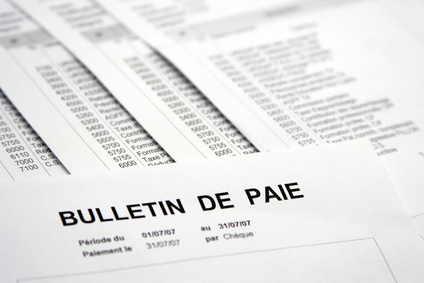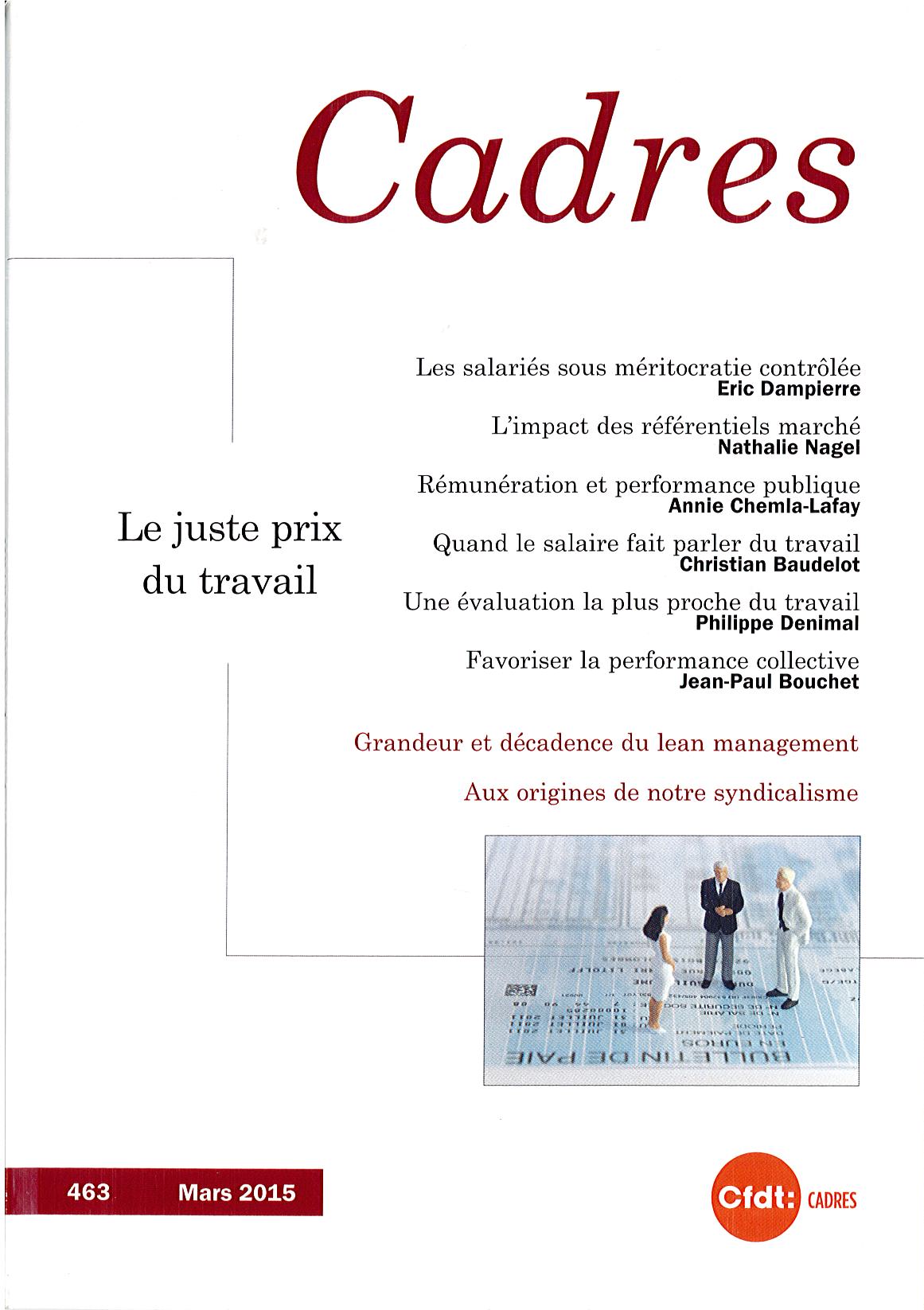L'enquête SalSa (« Les salaires vus par les salariés ») permet d’approcher les différents registres et critères auxquels se réfèrent spontanément les salariés pour apprécier leur salaire. Elle met à jour les relations que les différents salariés entretiennent avec leur salaire ainsi que le sens qu’ils attribuent à leur rémunération. On s’attache ici aux seules réponses aux questions ouvertes portant sur le « pourquoi êtes-vous plutôt satisfait de votre salaire ? ». L’ensemble des réponses est riche et divers.1 Plus que l’âge ou le genre, la catégorie sociale et le secteur d’activité - public ou privé - constituent les variables les plus clivantes. La façon dont les individus appréhendent leur rémunération et celle des autres est un élément essentiel pour comprendre les procédures de détermination et donc de négociation des salaires, mais aussi le sens que les individus attribuent à leur travail. Les motifs de satisfaction et d’insatisfaction invoqués par les salariés explicitent les critères d’évaluation qu’ils mobilisent. Nous avons été surpris par le fait que le terme de « justice » n’apparaît dans aucune des réponses exprimées. Plutôt que le recours à des catégories morales (le juste ou l’injuste), les salariés préfèrent des registres d’appréciation plus modestes, plus neutres tels que « correct », « raisonnable », « satisfaisant ». Ils se réfèrent ainsi à des critères beaucoup plus concrets. Les salariés jugent leur salaire par rapport à une dizaine de domaines de référence : le travail (fonction, tâches, horaires…), le coût de la vie (pouvoir d’achat), les propriétés personnelles (diplômes, compétences, expérience…), la carrière (ancienneté, évolution, mobilité…), les autres catégories de salariés (par exemple : les femmes se comparent aux hommes, les fonctionnaires se comparent au secteur privé…), les indicateurs institutionnels (grille, convention, Smic…) ainsi que la conjoncture extérieure (l’économie et le marché de l’emploi vus à travers les médias).
A ces domaines, qui sont objectifs, les salariés associent des critères subjectifs. Le salaire devrait ainsi permettre de boucler son budget et satisfaire des besoins, de récompenser l’effort d’avoir fait des études, de valoriser le produit du travail, de dédommager la pénibilité qu’il engendre et de progresser régulièrement. Les critères invoqués pour apprécier son salaire ne sont pas les mêmes dans le privé et le public. En dehors du sentiment d’appartenance ou du patriotisme d’institution, il y a d’abord le vocabulaire indigène de la fonction publique en matière de fixation des salaires (échelons, grades…) et d’emploi (poste, concours…). Il y a ensuite l’importance attribuée aux diplômes. Le fait d’évaluer le montant de son salaire par rapport à son diplôme est un trait propre aux salariés de la fonction publique, et plus particulièrement les cadres (notamment chez les enseignants). Enfin, les fonctionnaires se comparent fréquemment avec les salariés du secteur privé qui sont à la fois enviés et considérés comme malheureux en raison de l’instabilité de l’emploi. La distinction entre les deux secteurs est plus accentuée chez les cadres. On ne surinterprétera cependant pas ce constat, étant donné que les populations du public et du privé sont différentes. Il y a en effet plus de femmes, de cadres et de diplômés dans la fonction publique que dans le privé. Les salariés du privé, eux, ne se réfèrent quasiment jamais au public. D’ailleurs, le terme « privé » n’est employé que par les fonctionnaires.
Les cadres moyens et supérieurs de la fonction publique constituent un ensemble bien à part. Ils sont les seuls à relativiser l’importance du montant du salaire au nom de l’intérêt de leur travail. Ils parlent de missions intéressantes, de métier plaisant sur le plan intellectuel, d’activité gratifiante… Ces arguments sont bien sûr loin d’être exprimés par tous les fonctionnaires, mais il est moins présent parmi les salariés du privé. Dans le public, le niveau de salaire perçu est référé au nombre d’années d’études et au niveau du diplôme : « mon salaire est disproportionné par rapport à mon expérience et mon niveau d’études ». Si, comme les cadres du public, les cadres du privé se réfèrent spontanément à leurs responsabilités, ils partagent également de nombreux traits avec les ouvriers. Le travail fourni constitue pour eux un critère fondamental : « ma rémunération n’est pas en rapport avec les responsabilités, la charge d’activité et les compétences requises », « je travaille beaucoup mais je gagne bien ma vie »… Et ce sont surtout les cadres du privé qui considèrent l’évolution du salaire au cours de leur carrière comme un critère décisif : « je suis satisfaite de mon évolution dans l’entreprise mais pas de la progression de mon salaire ». La distinction entre les conceptions du salaire que font les salariés du privé et du public apparaît beaucoup plus tranchée au sommet de la hiérarchie sociale qu’à sa base. Qu’ils le jugent suffisant ou insuffisant, employés et ouvriers des deux secteurs partagent le sentiment que le montant du salaire s’apprécie et avant tout à partir du travail réalisé : « ce n’est pas bien payé pour le travail que je fais », « par rapport au privé, on est bien payé pour ce qu’on fait »… Au total, c’est surtout chez les cadres supérieurs que les points de référence diffèrent selon le secteur. Le thème des responsabilités est commun entre cadres du privé et du public. Mais d’un côté l’attention est fixée sur l’équivalence diplôme / salaire alors que de l’autre la référence est celle de l’investissement au travail, ouvrant sur le niveau de vie auquel permet d’accéder le salaire : « le même travail dans le privé est beaucoup mieux payé », « vu le nombre d’heures, je pourrais avoir un plus haut salaire et vu les responsabilités, je corresponds à ce qui se fait dans la profession ».
Quand ils ne sont pas satisfaits, cadres et non-cadres invoquent des motifs qui leur sont propres pour se plaindre de leur sort. Chez les cadres, la responsabilité, l’investissement dans le travail et l’insuffisance des évolutions de salaire au cours de la carrière sont les aspects le plus souvent invoqués. Tout autre est le registre de la plainte chez les employés et les ouvriers, du public ou du privé. La dimension du temps est primordiale. Alors que chez les cadres, l’échelle du temps de travail est celui des années (d’où la revendication de la progression du salaire sur une carrière), c’est un temps plus court, voire immédiat, qui est pris en compte chez les ouvriers et les employés. Leurs tâches sont visibles à court terme. Ils convoquent le temps long pour faire reconnaître l’ancienneté (« après vingt-cinq ans d’usine, je mérite d’être mieux payé »). Et le temps court pour parler de pénibilité (« pour un travail de nuit, ce n’est pas assez payé »). Au final, la distinction entre cadres et non-cadres se fait sur les critères suivants : responsabilité, capital humain et carrière pour les uns, coûts de la vie, pénibilité et temps de travail pour les autres. On se réfère, aux deux extrémités de la hiérarchie, à des valeurs et des critères différents pour évaluer son salaire. Chez les cadres, les éléments de valeur sont soit des propriétés personnelles des salariés (comme le diplôme), soit des charges mentales (responsabilités et stress). Chez les ouvriers, on a affaire à une version assez classique de l’exploitation : ma rémunération est insuffisante par rapport à la qualité et à la quantité du travail fourni et aux conditions de travail subies. L’échange est inégal. S’y ajoute, en évoquant le coût de la vie, la nécessité de prendre en compte les besoins pour déterminer ce que devrait être la rémunération. Pour les cadres, le salaire mesure la valeur de la personne tandis que chez les ouvriers, la valeur mesurée est celle du travail accompli.
Les critères de satisfaction varient également selon la catégorie professionnelle. Les cadres se réfèrent à des critères de marché, soit explicitement (« mon salaire correspond au prix du marché »), soit implicitement en invoquant le niveau de diplôme. Le salaire peut être accepté simplement parce qu’il est comparé à d’autres… Les cadres se distinguent également sur la perception du salaire qui permet non pas de faire face au coût de la vie mais d’accéder à un niveau de vie, même si cette notion est très subjective. On note sur ce registre l’usage du « je » et des jugements personnels qui suggèrent qu’un salaire, produit d’une négociation entre deux parties, est également celui d’un sujet et d’un acteur qui a su agir pour qu’il corresponde à ses aspirations propres : « mon salaire correspond à mes attentes et me permet de vivre correctement ». Chez les ouvriers et les employés, les motifs de satisfaction sont ceux d’un plaisir négatif : « je ne me plains pas », « il y a pire ». Enfin, l’enquête illustre le mécontentement global des fonctionnaires pour déplorer la dégradation de leur statut et leur revenu. A tous les étages de la hiérarchie, ils se déclarent nettement moins satisfaits que leurs homologues des entreprises.
Ainsi, qu’ils soient satisfaits ou insatisfaits de leur salaire, les différents groupes de salariés ne se réjouissent ni ne se plaignent des mêmes aspects de leur rémunération. Ils recourent à des expressions différentes pour exprimer leurs motifs de satisfaction ou d’insatisfaction. C’est d’abord au travail concret qu’ils effectuent que se réfèrent les ouvriers, à ses contraintes temporelles, à ses conditions de travail, à la fatigue du corps ainsi qu’au coût de la vie. La diversité des critères mobilisés indique que les conceptions du bon et du mauvais salaire se construisent dans l’action, en fonction du milieu professionnel, du type et des contraintes de travail, etc. Les cadres se réfèrent à d’autres paramètres qui relèvent d’une conception moins directement liée aux contraintes immédiates de leur travail. Le mot est remplacé par des expressions plus distinctives de l’activité telles que la responsabilité, les fonctions ou le poste. Le salaire est ici évalué à partir de références abstraites telles que la conjoncture ou le marché ainsi qu’aux qualités professionnelles. A l’inverse, les ouvriers ne se comparent pas entre eux ni à des généralités mais plutôt à des cas concrets. Ces différences transcendent celles de genre : hommes et femmes d’une même catégorie utilisent les mêmes mots pour estimer la valeur de leurs salaires respectifs et leur degré de satisfaction. On notera cependant que les femmes se déclarent en moyenne moins satisfaites que les hommes et privilégient la question des horaires et la conciliation entre tâches domestiques et emploi. Dans l’ensemble, les réponses s’accordent donc mal avec l’hypothèse selon laquelle les personnes auraient a priori une conception abstraite et générale de la justice salariale.
1 : L’enquête SalSa repose sur deux vagues, l’une réalisée par l’Insee pour le compte d’un consortium d’organismes de recherche (Centre Maurice-Halbwachs, Centre de recherche en économie et statistique, Ecole d’économie de Paris) auprès de plus de 3 100 salariés du privé fin 2008 début 2009 et l’autre par la Sofres pour le compte de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique et le Cepremap auprès de plus de 3 000 salariés de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat. Celle-ci est issue d’un projet élaboré dans le cadre du séminaire « salaires et justice » de l’ENS et par un groupe de chercheurs de plusieurs disciplines : C. Baudelot (ENS), D. Cartron (CNRS), J. Gautié (Université Paris 1), M. Gollac (Insee), O. (CNRS) et C. Senik (Université Paris 4).