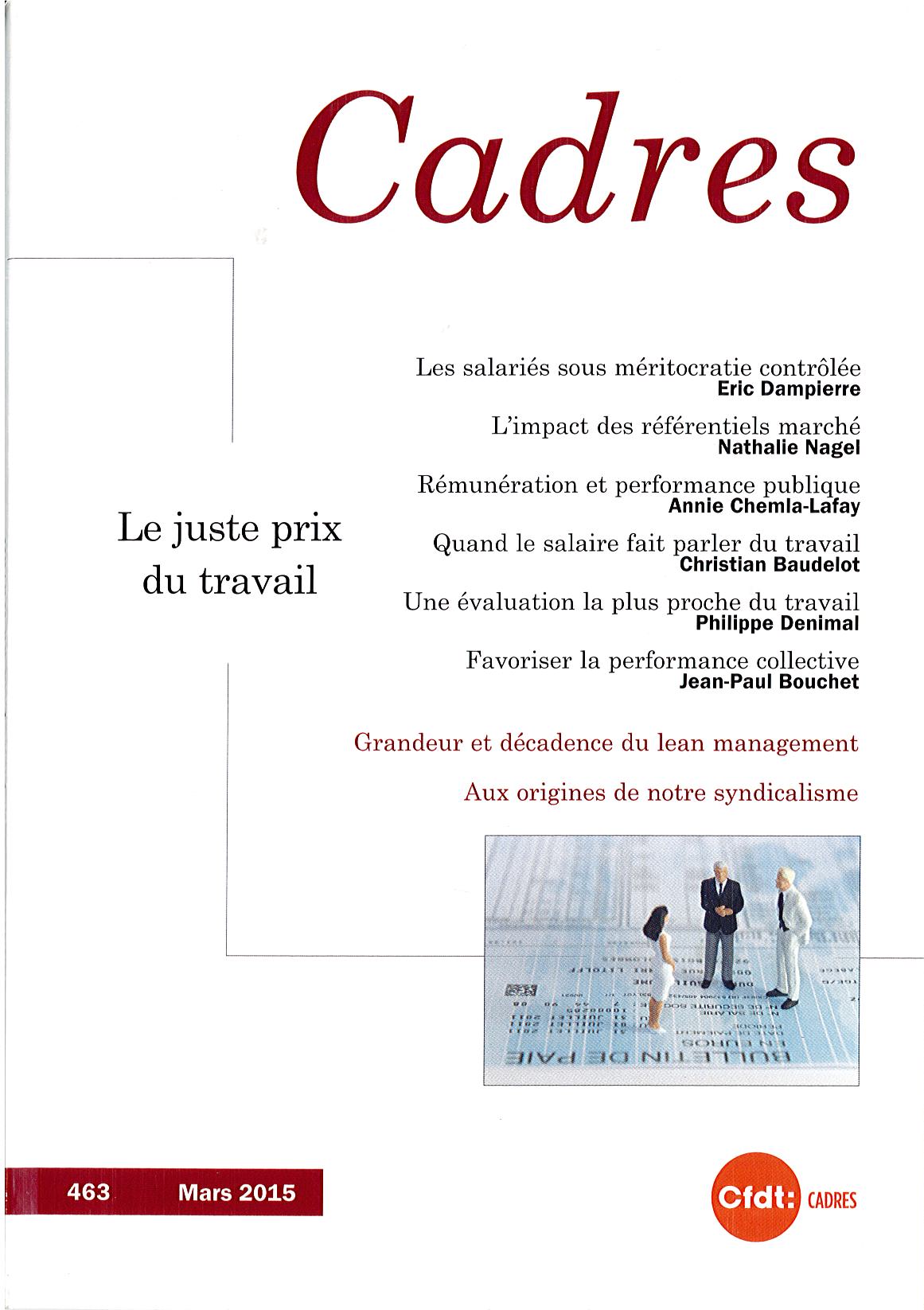Les entreprises sont diverses et leurs différences peuvent structurer les écarts de pratiques en matière de rémunérations. Certaines PME de type « familial » (il ne s’agit pas uniquement des entreprises détenues par une personne ou une famille mais également des propriétés de groupes) ont conservé un modèle, des modes de gestion et des relations sociales qui les rendent très proches des PME traditionnelles. Nous avons pu le constater, par exemple, dans une forge du Creusot. Ces sociétés s’en tiennent généralement à la convention collective et ne développent pas de politique de rémunération. Elles raisonnent en masse salariale ramenée à tel ou tel indicateur. Ce qui ne les empêchera pas, naturellement, d’accorder des augmentations et/ou des primes individuelles à la discrétion du président-directeur général propriétaire ou du directeur de l’entreprise. Dans certaines de ces PME, les cadres, comme les autres salariés, bénéficient encore d’augmentations générales. La PME filiale d’un grand groupe - ou filiale successivement de plusieurs multinationales - est celle à laquelle nous avons le plus affaire. Elle adopte les pratiques de la maison-mère, que nous verrons plus loin. La politique salariale n’y est pas différente de celle d’entités beaucoup plus importantes, dusse-t-elle parfois apparaître inadaptée. Dans d’autres cas, surtout lorsque ces entreprises dépendent de groupes anglo-saxons, un bricolage « maison » est effectué pour tenter à la fois de satisfaire les injonctions du corporate, soucieux d’harmoniser les pratiques du groupe dans le monde et de respecter la réglementation nationale, les obligations conventionnelles mais aussi les cultures locales. La nature des activités peut apparaître un autre facteur explicatif pour le sujet qui nous intéresse. A la différence des entreprises inscrites dans l’économie industrielle, les start-up, les sociétés de services en ingénierie informatique ou les cabinets de consultants combinent souvent une structure hiérarchique plus légère avec une très forte implication des salariés. Cela peut se traduire par une nécessité de fidéliser… ou pas, avec une part de variable parfois nettement significative notamment sous forme de titres de la société (avec une promesse de revenu différé potentiel). C’est dans ces structures que se rencontre le modèle up or out : on progresse rapidement ou on s’en va, plus ou moins spontanément.
S’il y a PME et PME, il y a également cadres et cadres, quels que soient d’ailleurs la taille et le type de la société... Les métiers qu’ils exercent, mais aussi leur histoire au sein de l’entreprise, font qu’ils sont plus ou moins sensibles (ou réticents) à la variabilité et à l’individualisation des rémunérations (deux grandes tendances de politiques de rémunération des cadres étendues progressivement aux autres catégories de salariés). Pour les cadres commerciaux, la rémunération variable fait souvent partie intégrante de l’identité professionnelle, sous réserve bien sûr qu’elle soit fondée sur des critères quantitatifs clairs et partagés au sein de l’entreprise. Cela peut avoir des implications sur la façon dont leurs rémunérations sont présentées dans les négociations salariales. Nous sommes ainsi intervenus dans une PME de la téléphonie, filiale de multinationale, dans laquelle les cadres commerciaux ont droit à des bonus sur la base d’objectifs pouvant évoluer d’une année à l’autre et les autres cadres à aucune forme de prime variable. L’intégration du bonus à la rémunération des commerciaux y semble si évidente que les négociateurs salariés ont demandé eux-mêmes à la direction de produire des grilles indiquant les évolutions salariales par catégorie dans lesquelles ce n’est pas le revenu effectivement perçu par les commerciaux qui est indiqué mais celui qu’ils toucheraient s’ils atteignaient 100 % du bonus. Ces salaires théoriques - un individu pouvant toucher moins ou plus des 100 % - sont comparés aux salaires réels et à ceux des catégories non concernées par le variable. Le salaire variable des cadres techniques repose aussi sur des critères quantitatifs, mais ils sont souvent conjugués avec des critères qualitatifs objectivables. On retrouve les critères qualitatifs pour les cadres fonctionnels qui peuvent prendre la forme d’évaluation d’une activité en mode projet. Enfin, mais c’est loin d’être une spécificité des PME, nous constatons qu’aucune part du variable des cadres hiérarchiques ne repose sur l’efficacité sociale de leur management : capacité à permettre des parcours professionnels, maintien du niveau d’employabilité, égalité professionnelle, etc.
De manière générale, le système de rémunérations variables et les critères restent souvent opaques, compliqués, voire contestables. Les cadres en ont-ils toujours été informés comme le préconise la jurisprudence ? Et les représentants des salariés : sont-ils toujours informés et ont-ils négocié ces systèmes de rémunération ou donné leur avis dans le cadre de la mise en place d’un nouveau système de rémunération pouvant avoir des conséquences sur les conditions de travail et la santé des salariés ? Face à la diversité des situations, les élus et les délégués syndicaux sont parfois amenés à faire des arbitrages entre les valeurs qu’ils portent et les attentes des salariés cadres. Ils peuvent être tentés de négocier les niveaux d’individualisation des augmentations et du variable, mais il nous paraît prudent de négocier avant tout le cadre collectif de l’individualisation. Pour illustrer les risques d’une négociation de l’individualisation proprement dite, citons une équipe de négociateurs dans une PME qui a validé - à l’issue d’une négociation annuelle - une augmentation individuelle de 2 % selon des « performances » des salariés, l’accord prévoyant à l’avance une répartition en pourcentage des salariés dans les différents niveaux de « performance » (excellent, bon, moyen, insuffisant). A l’époque, une jurisprudence avait déjà déclaré illicite cette méthode de quotas. En effet, la jurisprudence constitue un appui pour les organisations syndicales lorsqu’elles veulent mettre en place un cadre collectif pour négocier l’individualisation. Elle stipule que les conditions d’éligibilité, de déclenchement et les modes de calcul des rémunérations variables et des augmentations ou primes individuelles soient clairs et connus de tous. Les négociateurs peuvent prévoir des garde-fous afin que des salariés ne soient pas systématiquement et durablement exclus du bénéfice de ces rémunérations. Cela peut prendre la forme d’un engagement à ce que les cadres n’ayant pas eu d’augmentation depuis trois ans en bénéficient automatiquement la quatrième année. Enfin, nous préconisons de négocier des modalités d’information du comité d’entreprise et des négociateurs syndicaux sur les pratiques effectives d’attribution des mesures individuelles : d’une part avec des indicateurs spécifiques (sélectivité, dispersion, régularité), d’autre part des indicateurs qui permettent de mesurer l’impact de ces mesures individuelles au-delà de la classique segmentation par catégorie socioprofessionnelle (par âge et ancienneté, par métier, par sexe, selon que les salariés occupent des postes exposés à des risques sur l’emploi ou non, etc.).
Sur les quinze dernières années, nous avons relevé des évolutions structurelles qui concernent autant les PME que des entreprises de grande taille. La notion de « performance » a sensiblement évolué. Initialement limitée au travail « bien fait », elle est complétée par une appréciation de la maîtrise des compétences. Des connaissances techniques, l’appréciation a évolué vers les « compétences » comportementales, une notion très discutable. Aujourd’hui, dans beaucoup d’entreprises, les cadres sont également évalués en fonction de leur adhésion aux « valeurs » de l’entreprise, véritable porte ouverte à toutes les subjectivités. Cela conduit à une confusion croissante entre le travail attendu et la manière de travailler. Enfin, désormais, il est question de recruter, gérer et rémunérer les « talents ». Une seconde évolution est observée en matière d’évaluation des performances. Celle-ci est de plus en plus souvent ciblée sur l’atteinte d’objectifs annuels et de moins en moins sur les objectifs permanents (tels que la tenue du poste par exemple). Chaque année, les compteurs de la performance sont ainsi remis à zéro. Et l’atteinte d’objectifs n’est pas toujours synonyme de performance : un cadre peut faire d’énormes efforts sans être récompensé, a fortiori en période de croissance faible (et réciproquement). Les entreprises modifient toujours leurs grilles d’évaluation et d’objectifs alors que la performance ne cesse d’augmenter. Quand il n’y a plus d’augmentations générales pour les cadres, comme c’est le cas dans l’essentiel des PME dans lesquelles nous intervenons, l’immense majorité d’entre eux bénéficient d’augmentations individuelles et/ou de primes ou de bonus. L’individualisation ne se joue donc pas tant dans le bénéfice, ou non, d’une mesure individuelle mais dans son montant. Cette faible sélectivité des attributions conduit à un renversement de logique que les directions assument rarement : lorsque la quasi-totalité des cadres bénéficient d’une mesure individuelle, on passe purement et simplement d’une logique de reconnaissance de la « performance » à celle d’une sanction de la « non performance » qui se concrétise par une baisse du pouvoir d’achat pour ceux qui n’en bénéficient pas. Cette « non performance » d’un cadre devient pour lui un marqueur interne dont il est rare qu’il puisse se débarrasser. Chez un fabricant de semi-conducteurs est inscrit en toutes lettres dans une règle de bonus : « pas de bonus pour les no fit1 et pour les salariés faisant l’objet d’une mesure de licenciement pour motif personnel ». On comprend que la différence entre ces deux catégories n’est que temporaire… Lorsque l’on discute rémunérations, et à plus forte raison quand il s’agit de celles des cadres, les directions font fréquemment référence au marché : ce benchmark n’est jamais montré aux élus ou aux négociateurs. Les salaires des cadres sont observés plus ou moins sérieusement par les directions. Nous rencontrons toute la gamme de qualité, de l’enquête d’un cabinet spécialisé – à laquelle peut participer la PME filiale de groupe – jusqu’au numéro annuel d’un magazine, marronnier sur le salaire des cadres, quand il ne s’agit pas d’échanges informels entre responsables… Enfin, sont apparues les matrices de révisions salariales. Elles posent comme principe que la performance et le positionnement du salaire par rapport au marché sont des structurants d’égale importance dans l’augmentation, quand la performance ne bénéficie pas d’une meilleure pondération. Dans l’une de nos missions, nous avions calculé que pour un salarié fortement sous-positionné, il lui fallait presque dix ans de performances exceptionnelles pour se retrouver au niveau du marché !
Par ailleurs, la multiplication des classifications « maison », surtout dans les PME filiales de groupe, brouille les cartes. Le positionnement des salariés dans ces grilles conduit rapidement à l’abandon de toute référence à la convention collective, sinon le seul respect des minima salariaux que cette dernière prévoit. Ces classifications sont généralement fondées sur trois critères traditionnels : connaissances et compétences, initiative et autonomie, impact contributif (mais il nous arrive de découvrir, dans certaines entreprises, des critères plus exotiques). Nous avons constaté, dans une entreprise de la métallurgie, qu’un salaire de base peut être du simple au double pour un même coefficient conventionnel. Cela ne crée pas de dommage tant que le cadre reste dans l’entreprise. En revanche, en cas de mobilité (candidature dans une autre entreprise, inscription à Pôle Emploi…), il peut faire valoir d’une part un niveau « maison » qui n’a aucune valeur et aucun sens à l’extérieur, d’autre part un niveau de classification lié à la convention collective qui ne correspond plus à son niveau de qualification effectif. Si en plus ses revenus ont progressé sans que sa classification n’ait évolué, il se retrouve avec des prétentions salariales démesurées par rapport au niveau de classification conventionnelle qu’il peut mettre en avant. Enfin, de plus en plus souvent, des entreprises présentent leur classification organisée en broadbanding, c’est-à-dire un faible nombre de larges bandes de classification et de salaires qui permet une très grande marge de manœuvre pour la direction dans la différenciation des niveaux de salaires dans une même bande.
Le salaire des cadres et son évolution subissent ainsi dans les PME comme dans les grandes entreprises l’effet d’une doctrine dominante faite d’une référence à un marché des rémunérations qui n’est jamais montré, d’un challenge renouvelé chaque année sur la base d’objectifs à court terme, d’une individualisation dont les règles ne sont pas toujours claires ni connues et du principe selon lequel les cadres sont exclus des dispositifs généraux ou collectifs. Une telle évolution n’est pas sans impact sur les conditions et la santé au travail, mais également sur la cohésion du collectif de travail et donc sur l’entreprise. Il est temps de questionner les modèles de rémunération.
1 : To fit : s’adapter, être conforme.