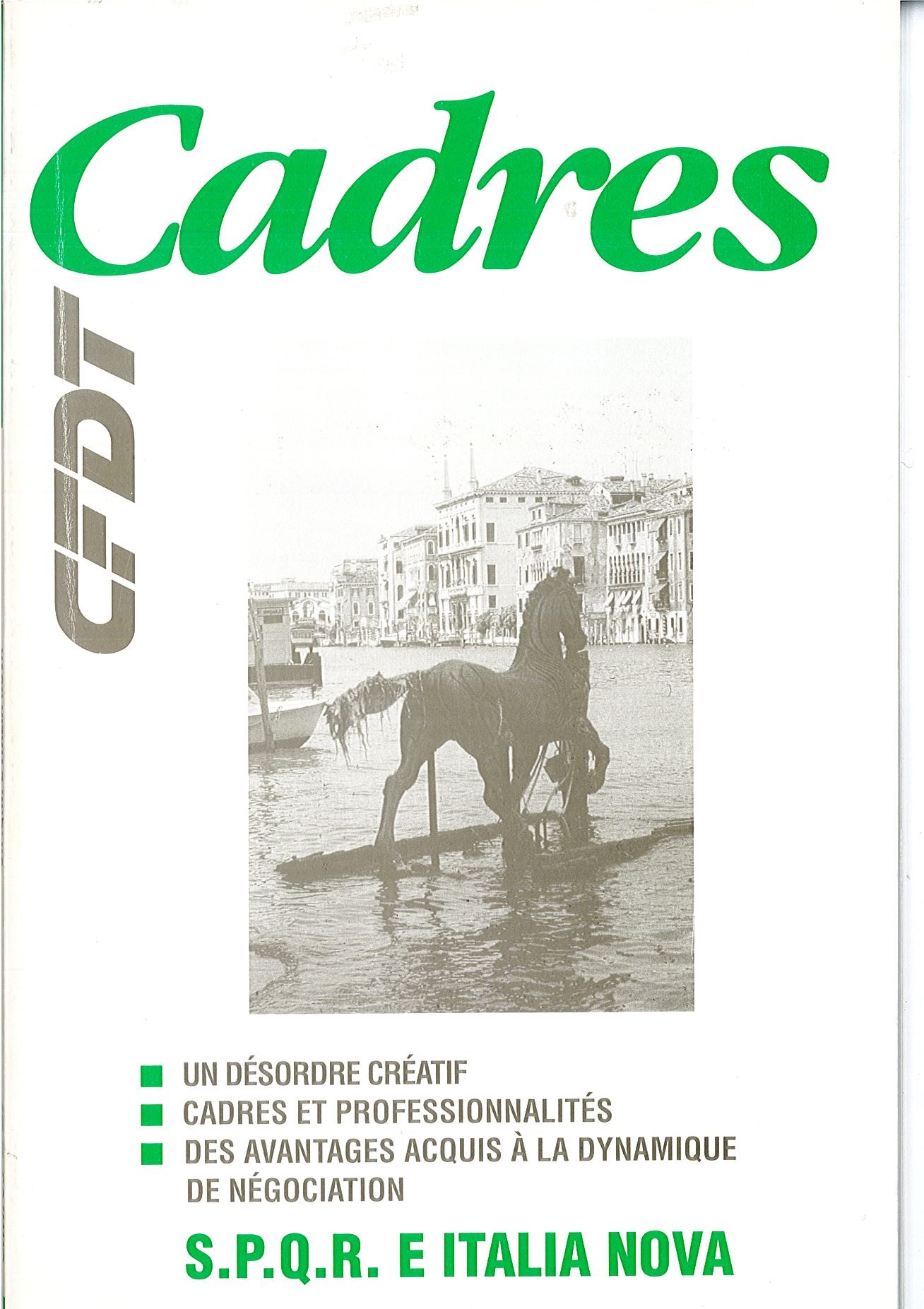Le système de retraite italien était le plus généreux des pays industrialisés. Une de ses caractéristiques majeures était la “pension d’ancienneté” : dans le secteur privé, le salarié pouvait prendre sa retraite au bout de trente-cinq ans de travail, quel que soit son âge, en touchant une pension équivalant à 80% du salaire annuel des cinq années les mieux payées. Les fonctionnaires pouvaient prendre leur retraite très tôt : après dix-neuf ans et demi de travail pour les hommes et les femmes célibataires, après quatorze ans et demi pour les femmes mariées, ce qu’on appelle les “pensions baby”. On en arrivait ainsi à ce que non seulement les retraites représentent une part croissante du PNB mais encore que le nombre des pensionnés dépasse celui des actifs. De plus, une “indemnité de fin de traitement” (trattamento di fine rapporto ou TFR) était touchée en cas de retraite, de licenciement ou de démission.
Les observateurs s’accordaient à penser qu’une réforme de fond était indispensable mais l’Etat, s’il était financièrement désireux de stopper la dérive budgétaire, n’était pas politiquement prêt à s’attaquer aux avantages acquis, même intenables, qu’il avait lui-même mis en place au fil des ans.
Une première réforme, partielle, eu lieu en 1992 sous le gouvernement Amato, consacrant une élévation progressive de l’âge de départ et basant le calcul du montant sur une plus longue période de référence. Un nouveau projet de réforme proposé en 1994 par le gouvernement Berlusconi, provoquait une manifestation d’un million de personnes et était abandonné. Après la formation du gouvernement Dini, les négociations reprenaient sur la base d’une proposition syndicale unitaire CGIL-CICL-UIL, le patronat se tenant à l’écart de la négociation.
L’accord entre les confédérations et le gouvernement a été signé le 8 mai 1995 puis les