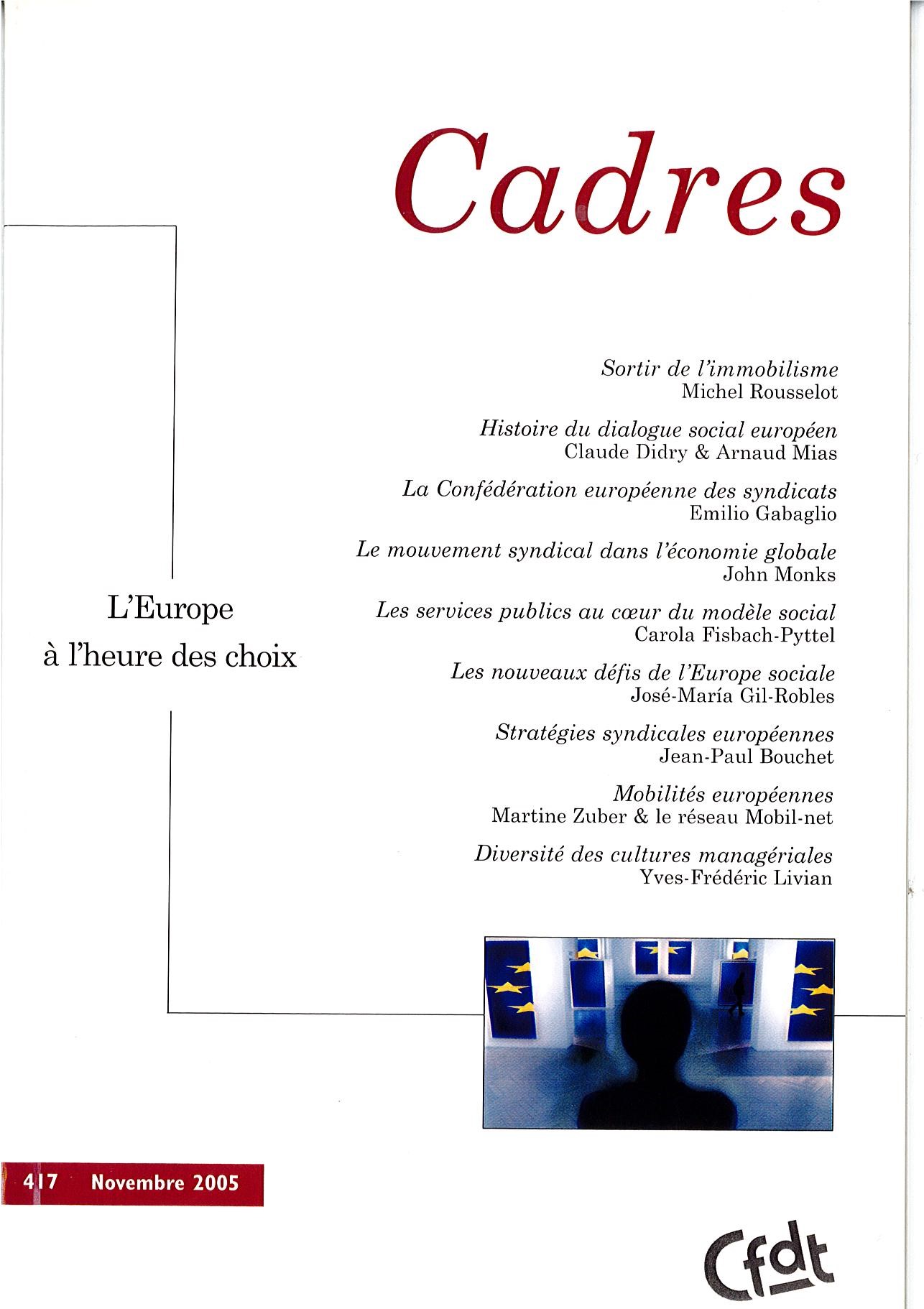Le romantisme social est l’objet principal du dernier roman de Gérard Mordillat, Les vivants et les morts (Calmann-Lévy, 2005. 658 pages, 20,95 euros). Le décor est une usine de fibre plastique, la Kos, qui fait travailler et vivre la quasi-totalité d’une petite ville située dans l’est de la France. Les personnages sont nombreux et les histoires se croisent autour du destin de l’usine, dont la fermeture est perçue comme inéluctable dès le début du récit.
Un western social
Un bon suspens est néanmoins entretenu sur le dénouement de la tragédie et le déploiement des acteurs : les ouvriers, les cadres, le DRH, la presse, les syndicats, le préfet, le maire, les CRS, la représentante du ministère du Travail… Il faut reconnaître que personne ne manque à l’appel. On peut se satisfaire d’une lecture légère de cette saga sociale comme d’un bon bouquin de plage ou de gare, avec la bonne conscience en plus car les héros sont les ouvriers et les ouvrières qui veulent sauver leur usine contre des patrons ripoux qui ont revendu le brevet industriel à des capitalistes américains (forcément), lesquels ont abandonné l’usine sans souscrire à leurs obligations sociales.
Mais pour des syndicalistes réformistes, cette lecture est difficile tant la caricature est poussée loin et tant le parti pris est « cégétiste de base ». Ainsi, les enjeux économiques, la désindustrialisation, la globalisation, le rôle des pouvoirs publics et le jeu des acteurs sociaux restent reclus dans une vision binaire, les vivants contre les morts, les gentils contre les méchants, les patrons contre les ouvriers, l’économie contre le social. Les héros sont à la CGT, les administratifs à FO et les cadres et les collabos sont à la CFDT, dont le délégué syndical signe absolument tout ce qui est présenté par la direction et revendique la préfére