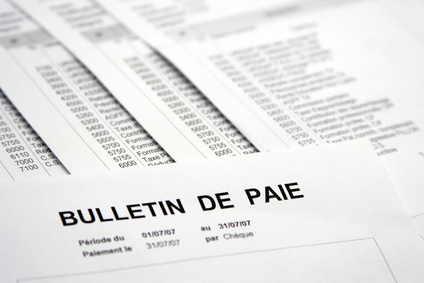S’il fut un temps où politique de l’emploi et syndicalisme de la feuille de paie semblaient s’opposer, les économistes nous rappellent que le principal moteur de la croissance est aujourd’hui la consommation. En d’autres termes, augmenter les salaires ne se fait pas forcément au détriment de la création d’emploi. Bien au contraire : dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat, les consommateurs se détournent des services, créateurs d’emploi, au bénéfice de biens de première nécessité beaucoup moins stimulants pour l’économie. Le rattrapage salarial est aussi une question de bon sens économique.
Mais, nous dira-t-on, y a-t-il du grain à moudre ? La question des marges de manœuvre se pose sans doute avec plus d’acuité dans le public, où les impératifs de rigueur budgétaire ne laissent guère de marge à la négociation. Mais les arbitrages gouvernementaux en faveur des baisses d’impôts se sont avérés peu judicieux en matière économique ; nul doute qu’au lieu de favoriser l’épargne des plus favorisés en baissant leurs impôts, une redistribution en faveur des agents aurait redonné un peu d’air à l’économie. Soyons libéraux, en la matière : l’économie ne se porte jamais mieux que quand l’argent circule, en l’occurrence quand il est redistribué à ceux qui s’empresseront de le dépenser et ainsi de le faire circuler. Il ne s’agit pas d’un choix entre les riches et les pauvres, mais d’une volonté de faire tourner la machine à plein régime ou au contraire au ralenti. Il semble bien en la matière que les choix économiques opérés depuis trois ans penchent plutôt en faveur de la seconde solution.
Dans le privé, la pression du chômage de masse et l’atmosphère alourdie par l’imaginaire des délocalisations ont amené les salariés à accepter de subir une politique de modération salariale qui dure depuis maintenant vingt-cinq ans. Or, si certains secteurs sont effectivement touchés de plein fouet par la concurrence internationale, le coût du travail n’est ailleurs qu’une variable parmi d’autres. On nous donnait récemment l’exemple d’un centre d’appel international situé à Paris, employant une centaine de personnes, où les téléopérateurs sont payés au Smic et vivent sous la menace d’une fermeture – sans même parler des conditions de souplesse extraordinaire qui caractérisent la gestion des ressources humaines. A Madagascar ou au Sénégal, leur répète-t-on, leurs homologues coûteraient moins cher, et la direction réfléchit à une éventuelle délocalisation. Mais quelle n’a pas été la surprise de l’une des salariées, lorsque s’étant délocalisée à titre personnel à Amsterdam, elle a trouvé un emploi dans le même type de structure, opérant sur les mêmes marchés, avec les mêmes clients… et où elle gagne exactement deux fois plus qu’à Paris !
Il ne s’agit pas de dénoncer un complot du grand capital contre le salariat français, mais de poser quelques questions, et de récupérer les marges de manœuvre que le fatalisme ambiant a tendance à faire disparaître. Soyons précis : en 2004, l’industrie française a gagné 6% de productivité, l’ensemble de l’économie 2,5%. Ce n’est pas la CFDT qui le dit, c’est l’Insee. Ce chiffre record, dans un contexte où la France est depuis plusieurs années en tête dans la course mondiale à la productivité, laisse rêveur. Il n’est pas tombé du ciel : il est le résultat des efforts des salariés, et il tient aussi à ce que les économistes appellent, d’un terme savoureux mais désespérant, une « faible combativité salariale ».
Faut-il rappeler aussi les profits record des grands groupes français en 2004 ? Si l’on prend les 35 premières grandes entreprises du CAC 40, elles ont dégagé des profits de 59 milliards d’euros, qui se sont accompagnés de distributions de généreux dividendes pour les actionnaires : + 63,6% chez Schneider, + 62% chez Arcelor, + 37,9% chez BNP-Paribas… Les comptes de la nation 2004, qui sont sortis en mai, nous enseignent que les dividendes nets distribués par les sociétés non financières ont progressé sur l’année de 13,6%. Enfin, les polémiques récentes sur le salaire des grands patrons complètent un tableau où les inégalités s’accroissent et où le salariat est de plus en plus mal servi.
L’encadrement est à cet égard dans une situation complexe : ni d’un côté ni de l’autre de cette nouvelle ligne de partage, il est traversé par des inégalités qui se jouent en termes de salaire, mais aussi, dans le privé comme dans le public, de rapport à l’avenir.
Il est temps que la tendance se retourne : c’est une question de santé économique, mais c’est aussi une question d’équité. Les intérêts des salariés sont en cause, mais aussi leur sentiment d’appartenir à un monde juste, ou au contraire injuste. La balance penche en ce moment du côté de l’injustice.