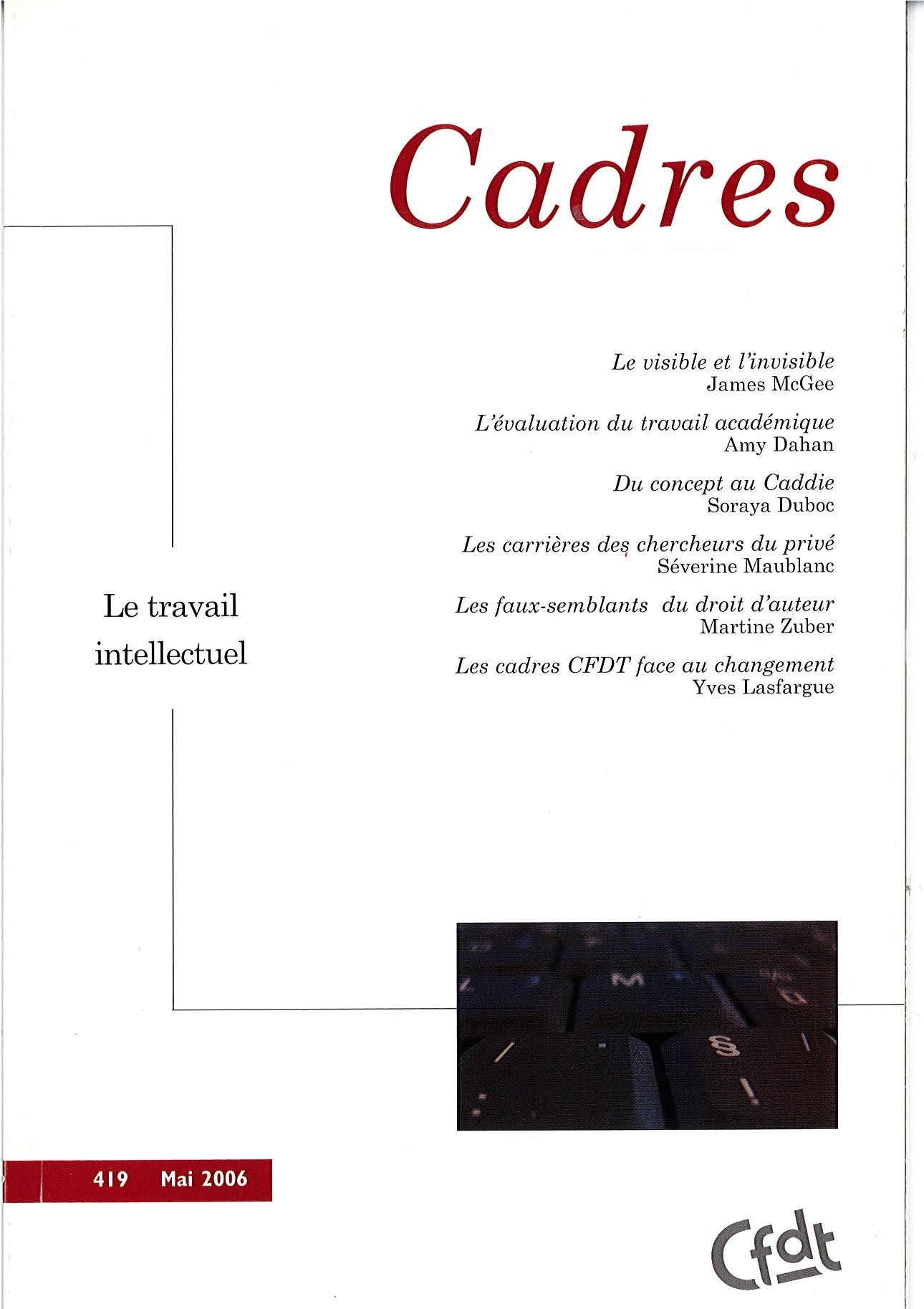Quel fut, en effet, le déclencheur décisif du mouvement ? La brutalité de la méthode ? Probablement. La fermeture de l’horizon professionnel ? Sûrement. Mais la cause réellement déterminante en fut, sans conteste, la dispense de motivation de la rupture du contrat de travail. Voilà l’initiative qui a créé dans la jeunesse un élan de révolte, manifestation d’un profond sentiment d’injustice. Il s’explique par le fait que les jeunes ont intégré, mieux encore que leurs aînés (cf. le CNE), dans leurs catégories les exigences les plus élémentaires de l’État de droit associé à l’idée de réduction de l’arbitraire. Or, précisément, la faculté de rupture discrétionnaire reconnue au profit des employeurs allait exactement à l’encontre d’une règle primordiale de justice : l’explication, l’argumentation, la justification. Il est remarquable d’observer que la première question que pose l’enfant est celle du « pourquoi ? » et tout particulièrement lorsqu’il est l’objet d’une sanction. S’y révèle un besoin primordial non seulement d’intelligence de la mesure prise à son encontre mais aussi de possibilité de défense par explicitation du sens de ses actes. « Tu me reproches cela, mais je vais te donner mes raisons » et, disait Paul Ricœur dans Le Juste, mes « meilleurs arguments ».
Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de l’État de droit, on retrouve en première ligne les droits de la défense dont le préalable est le droit à l’information sur les raisons d’une mesure préjudiciable. Dans la période la plus récente, soit à peu près depuis les années 1970, ce droit s’est élargi en tous domaines en droit à la motivation : motivation du licenciement en 1973, motivation des actes administratifs en 1979… Et, à l’heure actuelle, il n’est plus guère de domaine de l’activité sociétale qui échappe à cette exigence la plus élémentaire. Même les mesures disciplinaires dans les prisons ont fini par entrer dans le champ de la légalité républicaine.
C’est parce que cette exigence fut bafouée que la jeunesse s’est enflammée avec une telle vivacité. On peut lui savoir gré d’avoir refusé une forme d’arbitraire dont l’effet de contagion pouvait conduire à une déstabilisation générale du droit du travail. Et d’ailleurs, bien des employeurs ne s’y sont pas trompés qui n’ont accueilli l’initiative du CPE qu’avec beaucoup de réserves, et ce pour deux raisons. D’abord, du fait de son caractère iconoclaste si mal accordé à l’esprit du droit et susceptibles de donner lieu à d’interminables contentieux. Ensuite, du fait d’une rupture d’égalité entre les « vertueux » attachés à des pratiques civilisées et les « sans-lois », il en existe encore !, prêts à s’engouffrer dans la brèche. Curieuse législation, à dire vrai, qui fait fond sur la vertu alors qu’il est du propre du droit de toujours prévoir le pire ! Et spécialement dans un domaine aussi exposé que celui-là.
Dans le fond, ce qui fut contesté par cette réaction des plus salubres, ce ne fut ni la précarité en tant que telle – les jeunes savent comme tout le monde qu’elle peut être une phase dans un long parcours – ni la flexibilité, mot diabolisé à tort en ce qu’elle constitue souvent un facteur de stabilité, mais bien l’hyper-précarité, ce que l’on pourrait appeler la solubilité du contrat de travail ramenant à la surface un imaginaire féodal de la corvée, du travail sans parole et sans droits.
Et puis, ajoutons que la réaction des jeunes fut non moins morale par son refus du double langage, de la duplicité ou de ce qui fut perçu comme tel, et consistant à nommer contre l’évidence contrat à durée indéterminée un contrat avec siège éjectable au cours des deux premières années, à prétendre servir leurs intérêts en les dépouillant des garanties les plus élémentaires, à ouvrir la voie à la « concertation » une fois la décision prise à la hussarde…
Bref, une révolte morale surgie d’une forte demande de justice, de vérité et de loyauté.