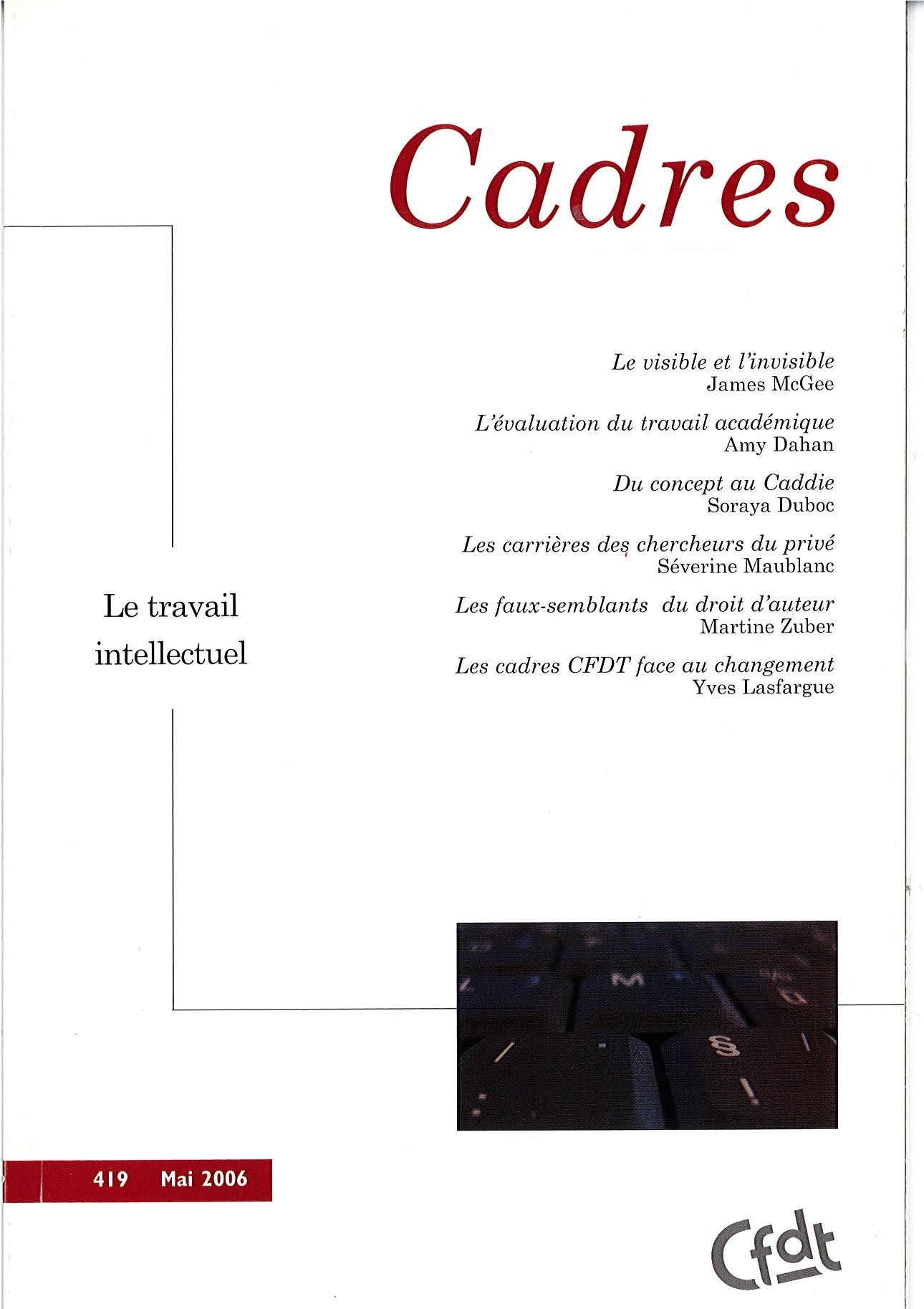A écouter les mots d’ordres et les débats des assemblées générales, le CPE est apparu comme le symbole de la précarité, plus exactement comme son inscription dans une loi destinée aux jeunes auxquels il serait dit que, dorénavant, le temps du CDI est indéfiniment reporté dans le calendrier de la vie. Le licenciement sans motif en rajoute au sentiment d’injustice puisqu’il apparaît comme une sorte de déni des droits élémentaires d’un contrat que l’on peut rompre sans explication. Mais toutes ces critiques ne suffisent pas à expliquer le rejet d’une mesure qui ne visait pas prioritairement les étudiants et qui cherchait d’abord à répondre aux jeunes « émeutiers » des banlieues.
En fait, la mobilisation des étudiants s’inscrit, avec une force particulière, dans toute la série des oppositions aux diverses réformes qui ont concerné le système d’enseignement et les conditions d’accès à l’emploi depuis plus de 20 ans. Les lycéens se sont opposés à la réforme Fillon comme à la réforme Allègre quelques années plus tôt, à la réforme LMD, comme au CIP. Tout se passe comme si les jeunes refusaient que l’on change les règles d’un jeu qui ne leur est pas particulièrement favorable, comme si toute tentative de changement n’était qu’une ruse du système et des pouvoirs visant à dégrader leur situation. Sauf à penser que les jeunes seraient naturellement conservateurs et craintifs, on peut supposer que cette réaction procède d’une longue évolution sociale qui leur a été particulièrement défavorable.
Si, depuis une quarantaine d’années, la situation des jeunes s’est améliorée en termes d’autonomie culturelle et d’élévation du niveau de formation, elle s’est fortement dégradée en termes économiques et sociaux. Pour ce qui est des revenus, la situation des jeunes s’est détériorée en regard de celle des plus âgés comme le manifeste le creusement des écarts entre les salaires de débuts de carrière et ceux des fins de carrière. Les jeunes étant des « outsiders », ils se sont heurtés à une longue politique de défense des « insiders », de ceux qui sont déjà installés et qui ont pu protéger leurs statuts en déportant les risques et les incertitudes sur les nouveaux venus : les jeunes, les femmes, les étrangers, les moins qualifiés... Ils paient le prix d’une longue politique sociale qui, refusant la flexibilité du travail, l’a, en réalité, concentrée sur la part la plus fragile de la population. Ainsi les jeunes peuvent-ils être fondés à croire qu’ils sont, comme les femmes et les migrants, la cible toute désignée de la précarité. Et toute mesure qui les vise de manière spécifique est négativement perçue.
Même si les syndicats ne sont pas consciemment responsables de cette situation, il reste que leur concentration sur les services publics et les grandes entreprises n’a pas été en mesure de freiner une tendance à la dualisation du marché du travail. Non seulement les jeunes apparaissent comme une classe d’âge un peu dangereuse quand elle est celle des banlieues, mais elle est aussi un groupe sur lequel se concentrent la plupart des difficultés. Dès lors, quand on touche à leur situation, les jeunes ont quelques bonnes raisons de s’inquiéter puisqu’ils peuvent avoir le sentiment que la société française n’a pas véritablement d’avenir à leur offrir quand ils n’ont pas la chance d’appartenir à l’élite des bonnes formations. Rappelons que les salariés, y compris ceux du secteur public, s’accommodent aisément d’un volant de vacataires, de stagiaires et d’instables comme ce fut le cas des aides éducateurs sous la précédente majorité.
Mais si les étudiants s’inquiètent, c’est aussi parce qu’ils sont au cœur d’un désajustement croissant entre le système de formation et la structure de l’emploi. Alors que jusqu’aux années soixante-dix, les étudiants accédaient à des emplois correspondant aux attentes fixées par les diplômes et que, dans une certaine mesure l’université rattrapait son retard, la massification scolaire a déstabilisé le lien entre formation en emploi. Dans les formations sélectives comme celles des grandes écoles, des IUT et des mastères professionnels, les étudiants obtiennent à peu près les emplois qu’ils espèrent. Mais pour les étudiants des universités de masse, dont beaucoup ne franchissent pas le seuil des premières années, la valeur d’utilité des diplômes s’est dégradée. De nombreux étudiants n’accèderont pas au niveau d’emploi que l’école leur laissait espérer et par lequel elle justifiait l’allongement des études. Par exemple, 64 % des candidats aux concours de recrutements sont surqualifiés par rapport au niveau formel des concours et des emplois, pendant que les titulaires d’un diplôme général de premier cycle ne s’en tirent guère mieux qu’un simple bachelier. Par ailleurs, près d’un étudiant sur deux occupe un emploi sans rapport à sa formation. Nous avons trop longtemps tiré argument du fait que, de manière générale, les diplômes protégeaient du chômage, pour ne pas voir en quoi les liens de la formation et de l’emploi s’étaient distendus aux dépens des étudiants les plus faibles et de ceux dont les origines sont les plus modestes.
Au bout du compte, les mouvements étudiants sont beaucoup moins portés par la critique de la société que par la crainte de ne pas y trouver de place. Comme les lycéens, ils trouvent dans leurs mobilisations l’occasion de manifester leur inquiétude et la joie d’agir ensemble dans une sorte de front du refus qui fait reculer les gouvernements mais qui n’a guère la possibilité de provoquer les changements dont ils pourraient bénéficier. Tout se passe comme s’ils posaient des questions auxquelles le système politique et social ne pouvait ou ne voulait pas répondre.
La dernière lutte a peut-être changé la donne. Jamais le jeu politique n’est apparu aussi éloigné des demandes sociales : psychodrame gouvernemental dans la majorité, silence de la gauche d’ailleurs bien perçu par l’opinion publique. Pourtant, cette fois les syndicats ont rejoint une mobilisation qui les a replacés dans le jeu, ce qui leur donne aussi une responsabilité explicite à l’égard des étudiants et qu’ils ne pourront pas ignorer en prolongeant un jeu de négociation qui fait des jeunes une variable d’ajustement du marché du travail.
De même, le monde universitaire ne pourra pas rester crispé sur des représentations qui se bornent à attribuer les difficultés des étudiants au seul marché du travail. Au sortir de cette mobilisation, les acteurs sociaux sont très en avant des acteurs politiques et l’on veut espérer qu’ils seront en mesure de rompre avec une représentation de leurs intérêts et de leurs problèmes dont, jusque-là, les jeunes ont fait les frais. Si flexibilité du travail il doit y avoir, comment faire pour qu’elle ne précarise par les individus et leurs parcours et pour qu’elle ne soit pas simplement concentrée sur les plus faibles ?