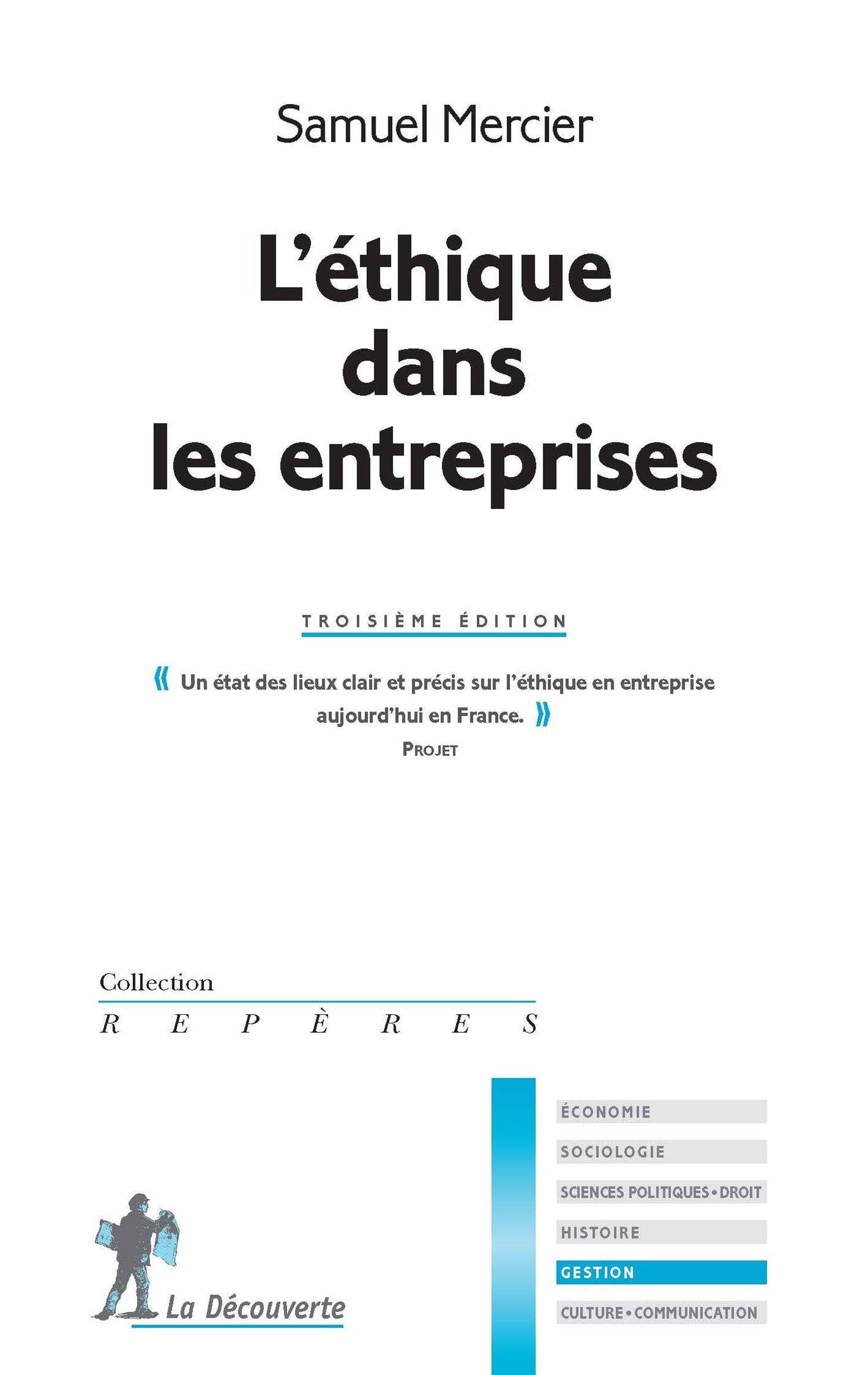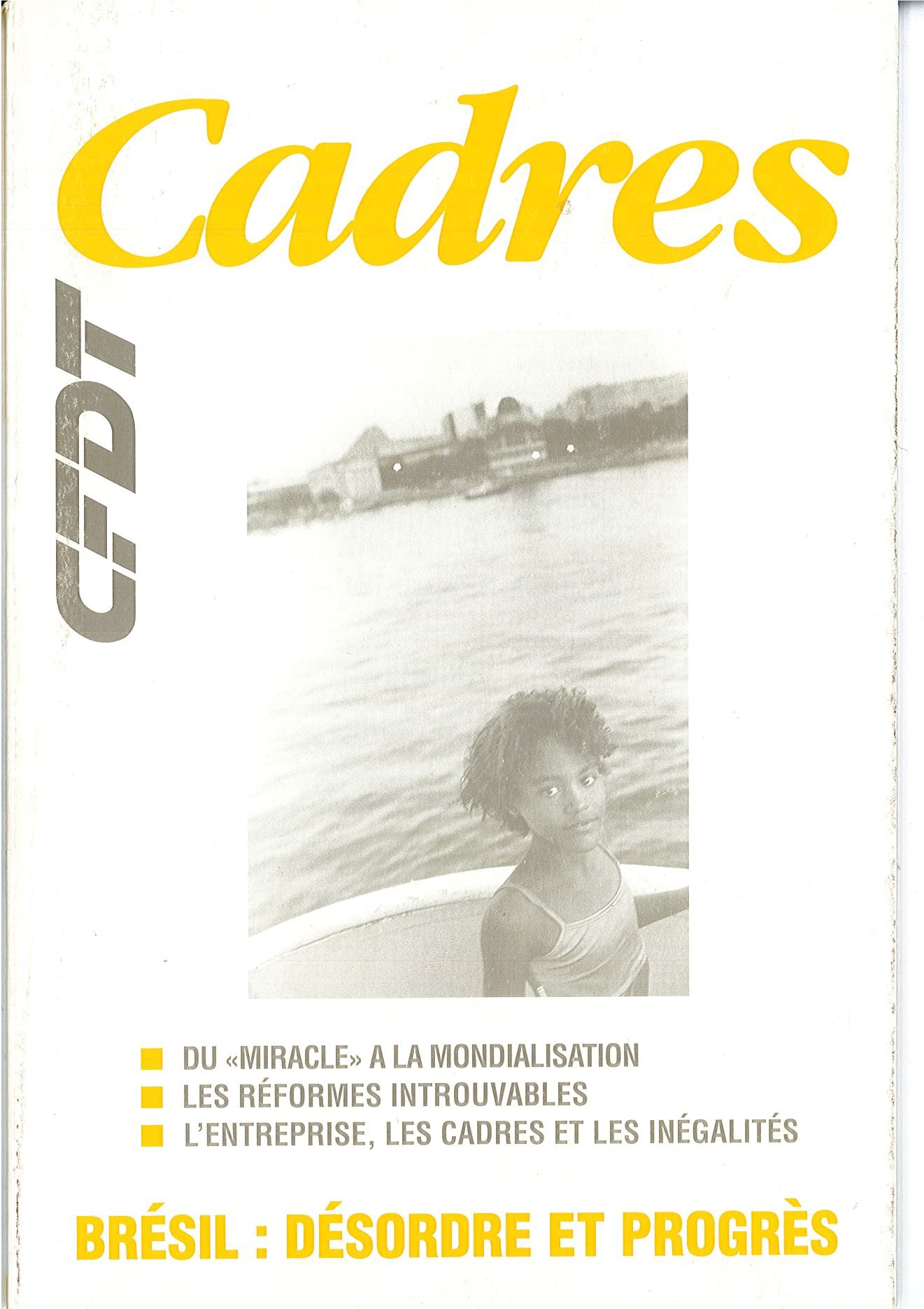« Le capitalisme a changé de base, les sociétés les plus développées qui en sont issues ne sont plus fondées sur la civilisation industrielle, même si les normes industrialistes continuent à dominer ». C’est en se basant sur cette « révolution » que Jean Lojkine, docteur en philosophie et chercheur en sociologie au CNRS, s’interroge sur « la nouvelle carte des possibles » et raconte « les aventures de la gestion ».
La révolution des nouvelles technologies de l’information peut conduire à des changements qui ne sont pas prédéterminés, nous dit (fort justement) l’auteur. L’acteur que sont les « classes dominées » doit adopter un point de vue large sur les mutations en cours et à venir. « L’histoire du mouvement ouvrier contient, même si cela a été plus ou moins occulté, l’histoire d’un apprentissage progressif du calcul gestionnaire par certains militants syndicaux, désireux de « connaître l’entreprise » ses bilans comptables, ses méthodes de gestion, pour pouvoir justifier les revendications salariales ». L’auteur nous paraît parfois quelque peu réducteur quand il ne voit dans le désir de connaissance de l’entreprise que le besoin de justifier des demandes de hausses de salaire ou de s’opposer à un plan de licenciements. Des syndicalistes, nous semble-t-il, peuvent s’intéresser à la gestion ou pour avoir une intervention économique dans l'entreprise, pour des raisons plus sociétales (respect de l’environnement humain et naturel, pérennité du bassin d’emploi, etc.).
Les investissements de productivité entraînent des surcoûts, le concept de productivité apparente du travail n’est franchement pas adapté aux activités de services, le contrôle de gestion ne s’intéresse pas à la phase de conception qui représente aujourd’hui la plus grande partie des coûts dans les secteurs de pointe. L’auteur note qu’un débat commence à s’ouvrir « entre les fabricants des « règles » de gestion et entre les cadres dirigeants qui les mettent en œuvre pratiquement » révélant « des fissures, des tensions, des débats entre gestionnaires, y compris autour du sacro-saint critère de rentabilité, cette « règle du jeu » intouchable jusqu’ici. ».
Dans la troisième partie, « les aventuriers de la gestion », l’auteur cherche à tirer la leçon des expériences passées. S’il cite la Verrerie ouvrière d’Albi et les coopératives ouvrières du XIXème siècle, il ignore totalement le mouvement des SCOP aujourd’hui, ce qui est une lacune car, si ce dernier ne représente qu’une trentaine de milliers de salariés, il pose des questions qui sont largement les mêmes que celles de l’auteur. Allusif plus qu’analyste de certains conflits célèbres (Lip, Rateau), l’auteur souligne ensuite « les paradoxes du management participatif » et s’interroge sur l’hétérodoxie de l’organisation matricielle. « Mais peut-on se contenter de constater l’échec du management participatif ? L’échec est peut-être beaucoup plus celui du mouvement syndical traditionnel, incapable de retourner à son profit des expériences de responsabilisation des salariés qui auraient pu être autant de tremplins pour une transformation radicale des rapports de pouvoir et des normes de gestion dans l’entreprise » .
Opposé aux « discours consensuels du management participatif » comme aux « discours protestataires des sociologues critiques », il semble trouver le mouvement syndical traditionnel bien timide dans ses tentatives de prise en compte des concepts de la gestion et appelle de ses vœux des « acteurs d’un troisième type », qu’il s’agisse d’experts « distincts aussi bien des experts patronaux que des experts directement issus du milieu syndical » qui sont « des intellectuels, des chercheurs en rupture avec leur milieu d’origine (...) mais aussi avec la culture ouvrière traditionnelle » ou de syndicalistes « qui cherchent à dépasser aussi bien la protestation purement négative que le simple accompagnement social ».