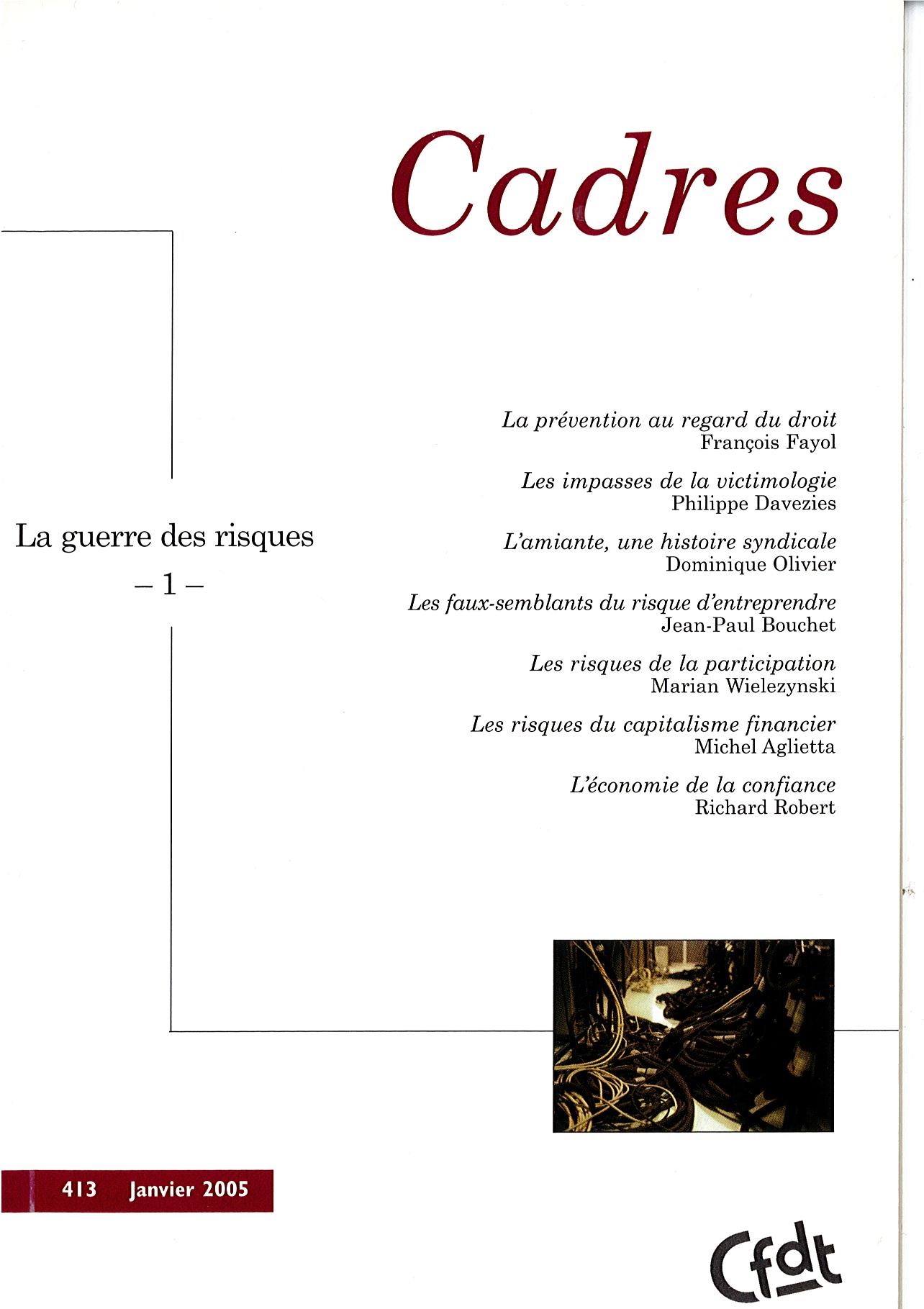Dans un monde dont l’insécurité est devenue la formule clé, celui qui clame haut et fort qu’il court des risques est assuré de prendre l’avantage, car il devient beaucoup plus difficile de lui demander quoi que ce soit. Mais ce risque d’entreprendre, rendu tangible par les faillites retentissantes qui défraient la chronique de temps à autre, ne cache-t-il pas une réinvention discrète de la sécurité ? Il faut alors s’interroger sur les faux-semblants du discours sur le risque.
Qu’est-ce qu’un entrepreneur ? C’est quelqu’un qui met son capital en jeu, dans le but de le faire fructifier, et qui assume le risque de le perdre.
L’entreprise comme risque
Les formes primitives de l’économie capitaliste moderne s’inventent dans la marine marchande des dix-septième et dix-huitième siècles, et notamment dans le commerce des épices, où les chances de gain étaient grandes, mais où les navires pouvaient se perdre. A une époque où la propriété est essentiellement terrienne, c’est-à-dire immobile et peu productive, le commerce par mer offre l’occasion de rendements significatifs, contrebalancés par la possibilité de la ruine.
Se met alors en place un système de distribution des risques à deux étages. Entre l’armateur et le marin, d’abord, le premier prenant tous les risques financiers mais se réservant l’essentiel des bénéfices en cas de succès de l’opération. Entre les différents armateurs, ensuite : en imaginant qu’un navire ait une chance sur deux de faire naufrage ou d’être attaqué par des pirates, mais qu’une opération réussie permette un triplement de la mise, celui qui affrète un seul navire court un risque assez grand ; il est vrai que s’il réussit, il triple sa mise. Celui qui en affrète trois stabilise ses chances, mais il court un risque plus grand que celui qui a les moyens d’en affréter vingt. Ce dernier, soit qu’il les fasse naviguer de conserve et réduise ainsi les possibilités d’attaques par les pirates, soit qu’il joue simplement sur les statistiques, qui lui promettent dix naufrages mais dix cargaisons sauvées, peut raisonnablement espérer de voir une mise de départ augmentée de 50% à l’arrivée. Par rapport à celui qui n’a affrété qu’un seul bateau, il a moins de chances de tripler sa mise, mais il court aussi beaucoup moins de risques de la voir totalement disparaître.
Quant aux marins, ils risquent leur vie, mais le capitalisme de la Renaissance et des Temps modernes ne prête guère attention à ce détail : à l’instar des mercenaires qui se battent sur les champs de bataille, ils toucheront leurs gages, et rien de plus. Les officiers, eux, ont droit à un pourcentage sur la cargaison.
Ce business model des origines n’est pas très éloigné de la loterie, et les développements successifs de l’économie moderne ont concouru à stabiliser les risques. L’hypothèse de la banqueroute s’est progressivement substituée à celle du naufrage, et celle du dépôt de bilan à celle de la faillite complète. Les entrepreneurs d’aujourd’hui jouent rarement à quitte ou double. Certes, le taux de défaillance des nouvelles entreprises est encore très élevé, mais il tient pour une très large part aux ressources financières et surtout professionnelles insuffisantes d’hommes d’affaires débutants, incapables d’évaluer la solidité d’un marché ou de recapitaliser leur entreprise le jour où elle en a besoin. Plus largement, il existe une forme de risque endogène, pour une entreprise qui ne travaille qu’avec un ou deux clients, qui fait tout son chiffre d’affaires sur un seul produit, ou encore qui utilise une matière première au cours volatile, comme c’est le cas de certains métaux. Mais une bonne gestion permet généralement d’éviter ce genre de danger. Les sciences et techniques de gestion, enseignées aujourd’hui dans toutes les écoles de commerce et nombre de formations supérieures, contribuent ainsi à stabiliser les risques ou à les réduire, en fixant des méthodes, en donnant des repères, en modélisant les erreurs classiques (sous-capitalisation, marketing défaillant, sous-estimation des charges, etc.). On peut évidemment regretter que nombre de petits entrepreneurs se lancent sans en maîtriser ne serait-ce que les rudiments, mais il n’en reste pas moins que, sur le plan théorique tout au moins, la gestion des entreprises est une technique éprouvée.
Les investisseurs, eux aussi, ont appris à rationaliser les risques. Même ceux que l’on appelle capitalrisqueurs travaillent avec des modèles statistiques très fins : tout en se montrant prudents dans leurs critères de sélection des projets, ils peuvent se permettre de perdre de l’argent dans les quatre cinquièmes, voire les neuf dixièmes des affaires où ils ont investi, le cinquième ou le dixième restant suffisant à rééquilibrer les comptes. La quantité d’argent investie est à cet égard une forme de garantie, dans la mesure où elle permet d’augmenter le nombre des projets et donc de se rapprocher mécaniquement d’une moyenne statistique. Ainsi les placements « offensifs » que proposent les banques sont rarement perdants, grâce à l’énormité des sommes mises en jeu.
Le salariat sécurisé ?
De la même façon que l’entreprise a développé des méthodes pour sécuriser le risque d’entreprendre, la situation du salariat s’est améliorée. Une partie des risques qui lui étaient associés a été reconnue et, jusqu’à un certain point, maîtrisée. Aux marins qui jouaient à quitte ou double avec leur vie se sont substitués des salariés qui engagent leur temps, leurs compétences, leur force de travail, en échange d’une rémunération et de conditions de travail (c’est-à-dire d’un niveau de risque) le plus souvent garanties contractuellement. Des normes sociales contraignantes viennent encadrer ces garanties : conventions collectives et autres accords de branche, mais aussi des lois, à commencer par celle du 9 avril 1898 sur les accidents de travail. Centrée au départ sur la réparation des accidents, elle a amené les entreprises à s’assurer, et ainsi à mettre en place, pour réduire le montant de leurs primes, une politique de prévention qui est l’une des grandes avancées sociales du vingtième siècle. Des structures comme le CHSCT sont plus tard devenues des acteurs majeurs de la prévention des risques, en association avec différents partenaires au premier rang desquels on compte la médecine du travail et le corps de l’inspection du travail1.
La sécurisation ne s’arrête pas là : les sociétés européennes de l’après-guerre, autour du modèle de l’Etat-providence, se sont constituées en sociétés-providence assurant aux salariés une sécurité allant bien au-delà de la seule garantie de rémunération. A cette garantie fondamentale s’ajoutent (selon les contrats) une garantie d’emploi et (pour tous) un ensemble de dispositifs assurantiels garantissant théoriquement une protection contre les grands risques de l’existence : assurance-chômage, assurance-maladie, assurance-vieillesse. Le contrat de travail reste la base du système, même si certains dispositifs ont été étendus à l’ensemble de la population (comme la couverture maladie universelle). Certains contrats, ceux des cadres en particulier, ajoutent au socle de base d’autres garanties, la plus répandue étant la retraite complémentaire.
Pour définir la condition du salariat européen moderne, telle qu’elle s’est définie pendant les Trente Glorieuses, on pourrait dire qu’un contrat de société a été passé entre les entrepreneurs et les travailleurs, ceux-ci bénéficiant des fruits de la croissance sous la forme de pouvoir d’achat mais aussi et surtout d’une sécurité croissante et de meilleures conditions de travail. Quant aux entrepreneurs, ils consentaient à abandonner une part de leurs gains en échange de paix sociale, et plus subtilement en vertu du modèle économique fordiste qui fait de la consommation de masse le principal moteur de la croissance économique. Dans un tel modèle, des salaires relativement élevés et garantis participent à la création et à la stabilisation d’une demande forte. Sécurisation pour tous : telle serait en somme la logique économique du fordisme, conçu comme un cercle vertueux associant une baisse générale du niveau de risque et une répartition plus harmonieuse des gains. Les cadres sont la catégorie exemplaire de ce modèle socio-économique.
Certains économistes considèrent que le point d’aboutissement de cette forme de partenariat se trouverait dans le développement, ces dernières décennies, des diverses formes d’intéressement, qui amène une partie des salariés (commerciaux, cadres) à prendre à leur compte une partie du risque, en échange d’une part de rémunération proportionnelle aux résultats de l’entreprise. La figure traditionnelle du salarié croiserait ainsi celle de l’entrepreneur : à cet égard, on peut noter que les formules comme celle du salarié « entrepreneur de sa carrière » ne sont pas neutres, et participent d’un déplacement de la frontière traditionnelle entre les deux figures principales du monde du travail. Statistiquement, il ressort de la plupart des enquêtes que les cadres ne s’en trouvent pas trop mal ; on peut cependant s’interroger sur la relation entre l’investissement réel ou la prise de risques, d’une part, et les gains effectifs d’autre part.
L’intéressement, donné comme une invitation au partage des gains, doit en réalité être compris pour ce qu’il est : une redistribution des risques. Car le gain financier, quelquefois substantiel, ne saurait cacher les pertes de garanties pour les salariés. Pour un cadre trentenaire satisfait de « booster » ses revenus grâce à son ardeur au travail, combien de quadragénaires placardisés pour avoir « oublié » de se former ou plus simplement parce qu’ils coûtent trop cher ? Combien de quinquagénaires achevant leur carrière entre le syndrome du burn out et l’épée de Damoclès du chômage ? Combien de retraites amputées de la part des primes qui gonflaient artificiellement le salaire annuel et masquaient ainsi sa modestie ?
Externalisations du risque
Sans vouloir faire du salarié une victime, il faut se rendre compte qu’il est pris dans un mouvement apparemment irrésistible, qui voit les entreprises externaliser les risques. Les mécanismes de la sous-traitance en sont une bonne illustration, et les travaux de Marie-Laure Morin sur les contrats de travail font apparaître nettement que le report de risques ne se fait pas seulement dans les relations des entreprises les unes avec les autres, mais aussi dans la redéfinition des relations de travail2. La montée en puissance des contrats à durée déterminée amène ainsi nombre de travailleurs à prendre à leur charge ce que l’on nomme le risque d’emploi ; et quand les institutions de l’Etat-providence, qui reposent économiquement sur les salaires, viennent les aider à tenir d’un CDD à l’autre, on peut considérer qu’il y a une perversion du système de l’assurance-chômage. Celle-ci a été conçue comme une garantie contre un risque exceptionnel, et si son rôle régulateur est reconnu, elle ne saurait servir d’adjuvant continuel au refus des entreprises de garantir le risque d’emploi. Le cas des intermittents du spectacle illustre à merveille la dérive d’un tel système, en faisant reposer la couverture du risque d’emploi sur les épaules du seul salariat - soit les salariés concernés, soit, par l’intermédiaire de l’Unedic, l’ensemble des salariés du secteur privé. Dans un cas comme dans l’autre, ce sont les entreprises qui se défaussent.
Les 44 propositions du Medef qui ont suivi, en mars 2004, la publication du rapport de Virville, montrent assez bien l’esprit qui anime une partie du patronat aujourd’hui. Les structures classiques du salariat et en particulier le CDI, par les protections qu’elles offrent aux salariés, seraient devenues si contraignantes pour les entreprises que celles-ci prendraient dorénavant un risque en embauchant de cette façon. L’externalisation et le recours général à des statuts moins protecteurs seraient alors parmi les solutions permettant aux entrepreneurs de retrouver un peu de marge. A vrai dire, une comparaison entre le secteur public ou parapublic et le secteur privé va plutôt dans le sens des arguments du Medef : l’Etat, qui n’est tout de même pas un représentant du grand capital, joue lui aussi la carte de l’externalisation et du contournement des statuts. Il faudra avoir un jour le courage de s’interroger sur une profonde rénovation du droit du travail, et sur les effets de seuil qui interdisent à nombre de salariés, notamment parmi les plus jeunes, l’accès au CDI.
On ne peut cependant pas souscrire aux propos des entrepreneurs sur les risques « excessifs » qui les « contraignent » à externaliser et à contourner les statuts. Certes, la mondialisation des échanges et la volatilité des actifs financiers soumettent l’ensemble de l’économie française (et par contrecoup le budget de l’Etat, et donc les fonctionnaires) à des pressions nouvelles, à une concurrence plus vive, à des retournements de tendance, à des nouvelles règles du jeu, en somme, qui font de la maîtrise des risques un exercice plus difficile. La réduction du périmètre des frais fixes apparaît dans ces conditions comme un exercice de gestion presque obligé, pour un entrepreneur ayant le souci de la survie de sa structure. Mais il me semble que cette insécurité nouvelle des entrepreneurs, qui les obligerait à refuser d’assumer certains risques, est aussi en grande partie une figure de rhétorique, un jeu de langage destiné à leur laisser les mains libres. Il faut considérer en effet que dans les relations des entreprises avec leur environnement, certaines parties prenantes font l’objet d’une sécurisation qui semble aller de pair avec l’insécurisation de la relation avec les salariés. Deux phénomènes, en particulier, doivent être mis en évidence.
Le premier consiste à sécuriser la relation avec les clients. On parle volontiers de fidélisation, mais il faut se rendre compte que certaines relations clients font de la notion marketing de « clientèle captive » un euphémisme. Les clients des opérateurs téléphoniques le savent sans toujours avoir les mots pour le dire : ils participent à la construction d’une économie de rente, où leur contribution au chiffre d’affaires des entreprises prend de plus en plus l’aspect d’une contribution mensuelle. L’industrie automobile elle aussi a compris les avantages de ces forfaits, caractéristiques d’une économie de service. L’achat de biens, d’une voiture par exemple, tend ainsi à se transformer en location de services (utilisation de la voiture, entretien éventuel, etc.). A la clé, pour l’entreprise, un étalement des recettes qui est aussi une sécurisation du chiffre d’affaires. On peut se demander, ici, si la notion de marché est encore pertinente pour décrire l’économie moderne, marquée par les monopoles ou quasi monopoles (Microsoft) et la fidélisation intensive. C’est l’idée même de choix qui se trouve remise en question. Le client, cet acteur autonome libre de ces décisions évoluant dans un univers de concurrence, tend à se transformer en abonné.
Second phénomène, la sécurisation de la relation avec les investisseurs. Ceux-ci, on ne le sait que trop, sont volages et exigeants, notamment lorsqu’ils sont de simples épargnants agissant par l’intermédiaire de mandataires et autres gestionnaires d’actifs, spécialistes de la mobilité et de la liquidité des marchés financiers. Les entreprises, les plus grosses en tout cas, ont trouvé la parade en leur offrant des taux de rendements d’une régularité extraordinaire. Là encore, la relation avec une partie prenante a été sécurisée, voire blindée. Est-il besoin d’ajouter que cette stabilité des taux de rendement, elle se construit bien souvent sur la compression de la masse salariale ? Quand la valeur des actions augmente de 12% par an quel que soit le contexte, et que les salaires n’augmentent quant à eux que de 1 à 2%, on est en droit de se poser des questions. Sur ce point, je me permets de renvoyer le lecteur à l’article de Michel Aglietta, dans la suite de ce dossier.
La distribution des risques entre investisseurs et salariés, dans l’économie actuelle, semble ainsi fonctionner d’une façon très différente de celle qui caractérisait l’économie fordiste, et au rebours complet de celle qui définissait le premier capitalisme. Au capital, la sécurité ; au salariat, une forme d’insécurisation rampante qui pèse sur les comptes des assurances sociales, creuse des fossés entre les statuts, et qui se traduit pour tous par l’érosion des garanties acquises au fil des décennies. La mondialisation, justification de cette régression, a bon dos : l’insécurité des uns permet la sécurité des autres. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de nier la légitimité des entrepreneurs à faire valoir leur propre insécurité. Il s’agit de mettre en évidence celle des salariés, afin de trouver un compromis plus équilibré. Il s’agit de sortir des images de l’insécurité économique brandies par un certain patronat pour envisager la réalité des risques aujourd’hui, leur géographie sociale, les zones protégées et les zones sinistrées. Il s’agit de considérer avec attention les équilibres et les déséquilibres qui permettent à des niches de sécurité de se constituer sur fond d’insécurisation générale. A l’intérieur des entreprises, c’est une question de gouvernance et d’équilibre entre les parties prenantes. A l’échelle de la société, c’est sans doute un nouveau contrat social qui est en jeu, un contrat qui corrige ce déséquilibre des risques. Le grand défi de la société industrielle, qui connaissait le plein emploi, était la répartition des gains. Le défi de notre société, qui est aussi le facteur d’inégalité le plus sournois, c’est la répartition des risques. Il y a ici un nouveau front du combat syndical.