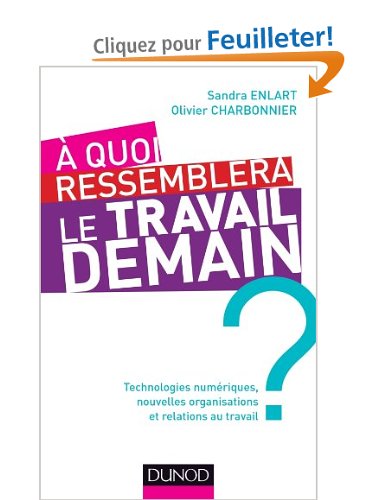Un livre stimulant, qui laisse toutefois le lecteur un peu perplexe. Sandra Enlart et Olivier Charbonnier partent d’un constat : l’information nous envahit, les smartphones « traversent les murs », les réseaux sociaux infiltrent les organisations, les e-métiers se multiplient (sans pour autant remplacer les métiers traditionnels), bref internet transforme le travail. Ce constat est difficilement contestable, de même que la première moitié du livre qui retrace les évolutions à l’œuvre dans les entreprises depuis vingt ans : organisations matricielles, management par projet, abandon du pouvoir centralisé, hymne au terrain, réhabilitation du manager de proximité, exaltation de la figure du dirigeant visionnaire, etc.
Plus originale est la seconde partie, qui s’intéresse aux caractéristiques de cette « e-activité », aux métamorphoses du travail qu’elle engendre, aux compétences qu’elle mobilise et aux secrets de la « e-performance ». Lorsque l’organisation du travail se fait en réseau et à distance, celui-ci change de nature. Première conséquence : la frontière entre vie professionnelle et vie privée se fait plus poreuse et cette porosité touche les espaces aussi bien que les temps de travail. On construit son activité à partir de soi et de son propre réseau et non d’une organisation externe qui impose ses règles. On ne vient plus au travail par obligation, mais parce que c’est un moyen nécessaire pour produire. Le déplacement étant coûteux, il faut même de sérieuses raisons de s’y rendre, d’où une concurrence entre des lieux de travail alternatifs, d’où aussi l’aménagement d’espaces éphémères. Mais les individus doivent trouver aussi des espaces qui les aident à passer d’un projet à l’autre, à préparer une décision, à retrouver une créativité émoussée par une mission particulièrement difficile. Les auteurs évoquent quelques pistes en ce sens, empruntées sans surprise à la Californie.
Deuxième trait : le retour de « l’économie de l’attention », déjà théorisée au moment de la bulle internet du tournant des années 2000 et des fantasmes de « nouvelle économie ». Il faudra de plus en plus capter et maintenir l’attention, se distinguer, singulariser sa production, le tout avec une exigence de totale transparence, car chacun doit pouvoir être vu à l’œuvre. Enfin troisième nouveauté, dont les logiciels open source sont emblématiques : le brouillage des frontières entre les positions de client, d’investisseur, de producteur. Le bénéficiaire d’un système est aussi son contributeur, le client est aussi producteur de savoir.
Quelles seront les compétences nécessaires dans ce nouvel environnement ? L’intelligence sociale et relationnelle, bien sûr, la souplesse et la faculté d’adaptation, la capacité à se mouvoir dans un environnement multiculturel. Mais les auteurs vont plus loin : on demandera de moins en moins d’engagement personnel, mais une qualité de contact immédiat et agréable ; il faudra laisser sa timidité au vestiaire (pas de temps à perdre avec ça), bannir toute agressivité mais s’interdire aussi toute séduction excessive. Du fun, mais pas de passion : « le savoir-être en réseau, c’est savoir gérer la distance relationnelle qui rend efficace une production collective ». A chacun d’être à la hauteur ; les psys ont de beaux jours devant eux... Les auteurs reconnaissent toutefois qu’une « autre valeur professionnelle montante sera sans doute la capacité à travailler de ses mains, que ce soit pour construire, pour réparer, pour installer, pour soigner, pour toucher, pour valoriser les sens, pour aider à conserver un bien-être psychique et corporel… »
Dans cette nouvelle relation au travail, il faudra donc à la fois « s’auto-motiver, s’auto-mettre en scène et s’auto-ménager ». Et la capacité à donner du sens sera cruciale, ce que ne pourront pas faire les machines, fussent-elles « smart ». Ce sera plus que jamais l’œuvre des managers. Le management transversal et de réseau deviendra une évidence et le manager tirera sa légitimité de la multitude des coopérations qu’il pourra insuffler et animer. Mais cette légitimité sera éphémère, elle devra être sans cesse renégociée.
Prudents, les auteurs préviennent que ces nouveaux modes de travail ne seront en aucun cas exclusifs des modes actuels, ni peut-être même hégémoniques. Il y aura coexistence de formes de production très diverses. Mais, affirment les auteurs, « on peut se demander si, demain, on parlera encore de travail au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Ce qui est sûr, c’est que le rapport individuel au monde professionnel ne ressemblera plus, pour une partie d’entre nous, à ce que nous vivons aujourd’hui. Et certains se diront qu’il ne faut plus travailler, mais innover, créer avec d’autres, être en réseau, proposer des idées, concevoir et réaliser des objets, vendre des productions originales, piloter des projets aux acteurs multiples, acheter mille et une choses, bref… vivre. »
Certes, mais tout cela laisse un peu le lecteur sur sa faim, car de nombreuses questions restent en suspens. Quelle sera la nature de la relation d’emploi ? Va-t-on voir s’imposer le modèle, déjà décrit il y a quinze ou vingt ans, de l’individu entrepreneur de lui-même (« moi s.a. ») et de l’entreprise-projet, dont la production du film « Titanic » fut emblématique. Comment se formeront les compétences ? Les projets entrepreneuriaux trouveront-ils sur le marché toutes les compétences dont ils auront besoin ? L’intégration de compétences individuelles dans un projet collectif pourra-t-elle se faire autrement que par un processus lent, demandant une relation dans la durée entre l’entreprise et le salarié ? Et quels contours auront les parcours professionnels ? Le marché du travail demain sera-t-il composé d’un petit nombre de professionnels, dotés de compétences très recherchées, capables de se louer pour quelques mois aux entreprises les plus offrantes, et d’une masse de travailleurs précaires aussi faciles à embaucher qu’à licencier ? Et comment seront évaluées et rémunérées les personnes au travail ? Le marché réglera-t-il l’ensemble des relations entre offreurs et demandeurs de travail, malgré l’asymétrie d’information et les coûts de transaction qu’elle engendre ?
Bref, tout cela conduit à une question : est-ce la fin de l’entreprise et du salariat ? Comme l’écrit Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit et éminent spécialiste des technologies numériques, l’esclavage aura duré 8000 ans, le servage 800 ans : le salariat risque de ne durer que 200 ans. Les paris sont ouverts.
On sort du livre avec l’envie de se plonger dans « Condition de l’homme moderne », où Hannah Arendt expose la distinction entre travail, œuvre et action. Mais la lecture en est plus difficile.