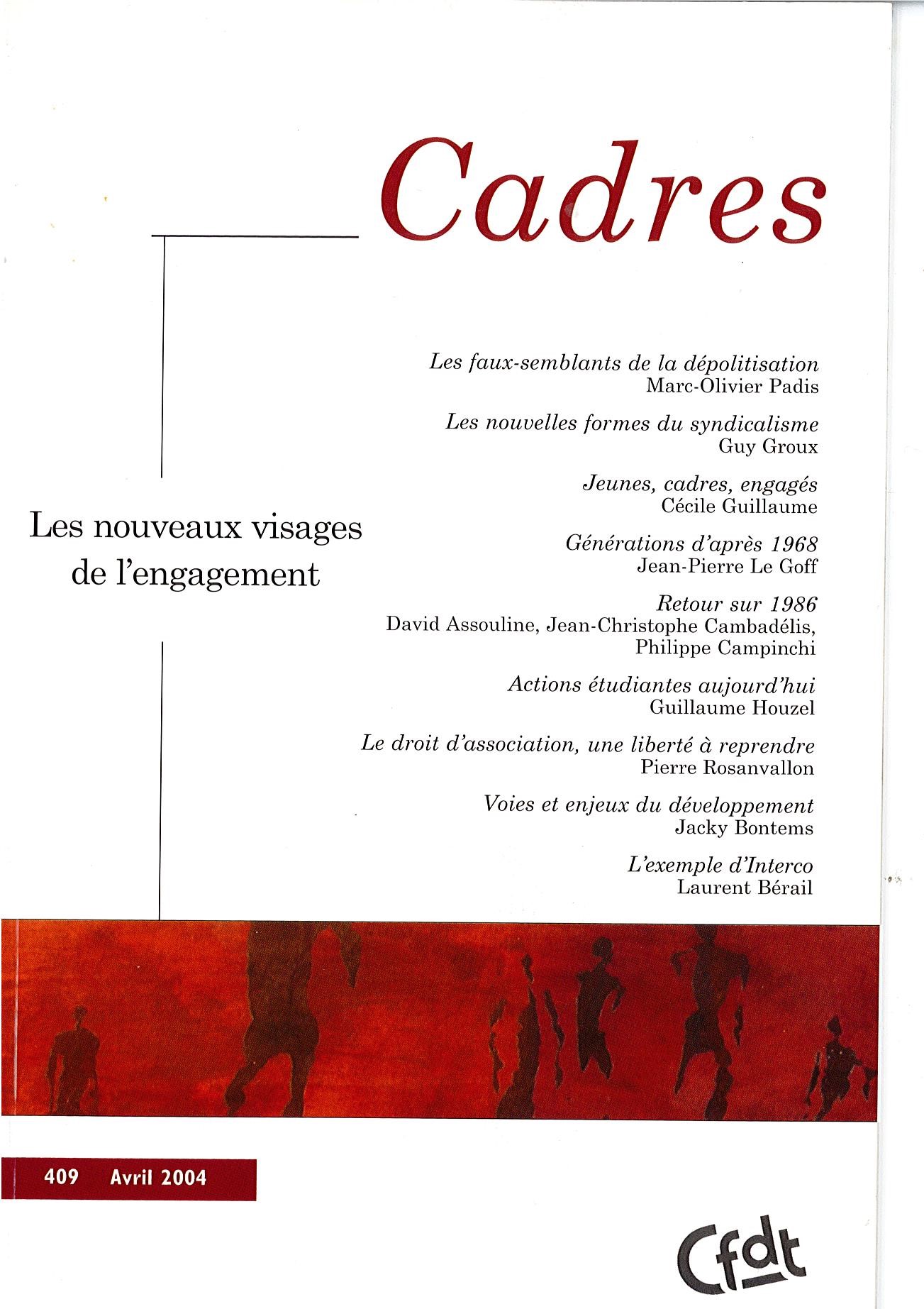On le voit bien sur le strict terrain des principes juridiques. Si le statut des associations simples est très ouvert et très libéral, il n’en va plus de même pour celles qui veulent prétendre à la reconnaissance d’utilité publique (reconnaissance indispensable pour élargir la capacité juridique d’une association et lui donner en particulier la possibilité de recevoir des dons et des legs). Le contrôle de l’Etat est alors très contraignant, tant au niveau de la rédaction des statuts que du mode de désignation des administrateurs. La règle des fondations est encore plus restrictive. Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays étrangers, les fondations sont nécessairement en France des établissements d’utilité publique, étroitement contrôlés par l’administration. Seule la gestion par un conseil peut donner l’illusion qu’il s’agit d’un organisme privé. Tout se passe en fait comme si la coupure entre le privé et le public continuait à traverser le système associatif, alors même que ce dernier aurait dû avoir pour fonction de définir un espace social de nature intermédiaire. La question se pose de façon d’autant plus pressante que l’on assiste actuellement au déclin des associations à vocation globale (partis, syndicats, organismes de consommateurs). L’expansion associative ne s’opère que dans le champ d’activités ponctuelles (sports, culture, entraide), et c’est l’idée même d’association qui se trouve ainsi réduite.
Pour comprendre cette question, il faut revenir aux fondements du droit politique moderne en France. La culture politique née de la Révolution a en effet radicalisé les termes du problème de la distance entre le système politique et la société. « Il n’y a plus de corporations dans l’Etat ; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publi