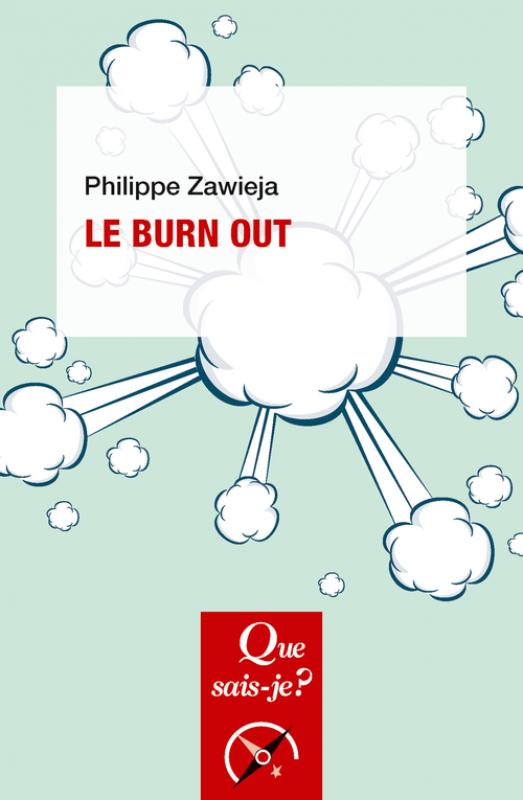En France, le flex office est encore marginal : pour la société immobilière Deskeo, 16 % des entreprises l’ont adopté. Et selon les résultats de l’enquête menée en août 2022 par la Fondation Jean-Jaurès, la France se placerait parmi les pays les moins convertis au flex office : le bureau individuel reste le principal lieu du travail pour les salariés français (43 %), devant le bureau partagé (37 %), l’open space ne concernant lui que 19 % des salariés français et le flex office seulement 6 % d’entre eux.
Mais la crise de la Covid-19 est passée par là et le recours au télétravail (sur lequel s’appuie l’organisation du flex office) s’est imposé. Les entreprises seraient ainsi de plus en plus nombreuses à envisager cette solution : près de 60 % des entreprises selon certains promoteurs de ce type d’organisation des espaces de travail. Et pour cause… À les croire, en France un poste de travail serait en général inoccupé près de 60 % du temps. Or, en 2020, un bureau individuel coûtait encore, en moyenne, 10 250 €/an.
Pour mieux convaincre les employeurs (et, surtout, leur permettre de convaincre voire de séduire leurs salariés), cette belle perspective de profitabilité est accompagnée de tout un discours qui n’hésite pas à promouvoir des concepts creux et à inverser l’ordre des valeurs. Ainsi, vous ne parlerez pas d’économie (a fortiori si le projet ne s’accompagne pas d’une revalorisation salariale enfin possible grâce à ces nouvelles marges de manœuvre financières) mais de « rationalisation ». De même vous ne direz pas que le flex office c’est la fin des postes attribués, mais la fin des postes « imposés ». Mieux : grâce au flex office, le management devient « hybride » (quelle avancée…) et chacun s’installe dans ces nouveaux espaces de travail « sans préoccupations hiérarchiques ou corporatistes » (et les salariés de nager dans un grand bain fraternel). Cerise sur le gâteau : grâce au clean desk (nom politiquement correct de la politique de la table rase), puisque chacun débarrasse entièrement « son » poste de travail après usage, on a les yeux uniquement tournés vers l’avenir et chaque jour est un nouveau départ, plein de promesses. Opter pour le flex desk, desk sharing, free seating, hot desking – autant de mots pour persuader que ne plus avoir sa place au travail, c’est s’inscrire dans une dynamique de progrès vertueux (forcément vertueux puisque c’est dit dans la langue du business), c’est, en fin de compte, laisser souffler « un vent de liberté et de plus d’équité » sur le collectif de travail. N’en jetez plus ! Et adoptez tous la devise « liberté, égalité, flex office ! »
Les promoteurs semblent pourtant avoir conscience de certaines contraintes, rapidement évoquées : stress, perte de repère, repli sur soi, dépersonnalisation des espaces, tensions relationnelles dans les espaces partagés, voire (certains le reconnaissent) risque de perte de productivité. Mais elles sont vite balayées par un conseil avisé : il suffit de bien accompagner les collaborateurs (les concerter, c’est-à-dire surtout les préparer au changement sur lequel ils n’auront en réalité pratiquement aucune influence) et d’opter pour une organisation du travail « respectueuse de leurs besoins » (or, c’est précisément le problème…). Bref, un peu de vernis et le tour est joué.
Dans l’ombre du flex office
Plusieurs études et nombre d’expertises, notamment réalisées au sein de notre cabinet Ametist Conseil, montrent pourtant que, dès que l’on gratte ce vernis, les impacts des projets de passage au flex office sur les conditions de travail et sur la santé (physique, mentale et sociale) sont nombreux et souvent délétères. Cela explique pourquoi un tiers seulement des entreprises ayant franchi le pas tirent une expérience positive de leur choix. Quant aux salariés, ce n’est pas par ignorance que 89 % déclarent préférer travailler sur un poste attribué (selon une enquête Actineo réalisée en 2021). Au contraire, comme le montre l’étude « Mon bureau post-confinement III » (ESSEC Workplace Management 2021), 73 % des salariés qui travaillaient en flex office avant la crise ne souhaitaient pas retrouver ces conditions de travail après la crise sanitaire.
C’est qu’en effet, outre la mutualisation des postes de travail, le flex office repose sur plusieurs principes qui nécessitent souvent de revoir profondément sa manière de travailler. Évoluant désormais dans un environnement de travail organisé en fonction des activités (espaces collectifs et alternatifs, espaces de concentration, de brainstorming, de convivialité, etc.), le passage au flex office nécessite de nouveaux principes de fonctionnement pour partie assumés (pas de place attitrée, clean desk, logique de brassage, etc.) et d’autres qui ne se révèlent qu’à l’usage.
Un premier écueil tient au fait que le nombre de postes prévus ne repose pas toujours (tant s’en faut) sur une observation fine des pratiques d’occupation, et les moyennes obtenues peuvent masquer des écarts à ces moyennes qui risqueront de poser problème. A fortiori lorsque les ratios visés sont de plus en plus bas : des ratios entre 0,5 et 0,7 poste par salarié ne sont plus rares ; certains descendent même plus jusqu’à 0,3, démultipliant les risques d’engorgement et de suroccupation. À cet égard, l’invitation à favoriser le travail d’équipe avec moins de place pour se réunir et/ou pour retrouver un poste de travail individuel une fois le temps collectif terminé relève de l’injonction contradictoire. Dans les faits, les réunions d’équipe se font de plus en plus selon des schémas hybrides (une partie de l’équipe est présente, une autre est en visioconférence) voire complètement à distance (avec toutes les difficultés que cela peut poser entre les défauts de connexion, les usages différents de la caméra, les conditions d’isolement possibles chez soi d’un salarié à l’autre, etc.). Qui plus est, cette logique de réduction des ratios accentue les phénomènes de « lutte des places » quand on vient au bureau : il faut arriver avant les autres pour pouvoir bénéficier des meilleurs emplacements. On observe en outre régulièrement des conflits de réservations de places ou de salles, des phénomènes d’accaparement des espaces ou des places et autres joyeusetés. Le nombre de places limité oblige enfin à des décisions supplémentaires dans la journée du salarié : « Où vais-je m’asseoir ce matin ? Et maintenant ? À côté de qui ? Comment vais-je pouvoir assurer ma visio depuis cette place ? », etc., autant de décisions qui ont un coût, surtout lorsque les relations professionnelles ne sont pas bonnes.
Ensuite, la politique du bureau propre oblige à se promener au cours de la journée dans les différents espaces avec toutes ses affaires. Et tend, de ce fait, à accélérer une logique de dématérialisation (moins de papier) dont non seulement rien ne prouve qu’elle soit plus favorable à l’environnement (les effets de la numérisation accrue ne cessent d’être dénoncés[1]) mais, qui plus est, oblige à se conformer à des méthodes de travail qui ne conviennent pas à tous et qui accentuent les effets de fatigue visuelle.
Si la plupart des projets ne relèvent pas du full flex office mais d’un flex office aménagé, prévoyant des zones par service/département, la cohabitation des métiers reste un sujet. Au sein d’une même équipe, et parfois d’un même métier, les besoins de confidentialité et/ou de concentration sont difficilement compatibles avec des espaces ouverts, passants et bruyants. Il en découle régulièrement des phénomènes de repli sur soi (travailler avec un casque), de report de certaines tâches sur les jours de télétravail (et donc un accroissement de la charge en télétravail et un besoin supplémentaire de planification de son travail) ou encore de « privatisation » d’espaces collectifs (salles de réunion) ou de détournement d’espaces alternatifs (travailler à la cafétéria ou dans les salles de détente).
Le principe de l’activity-based working, qui postule que les salariés gagnent à disposer de lieux spécifiques pour réaliser leurs différentes tâches, est également souvent mis à mal par l’observation : dans les faits, le poste de travail reste au centre de l’activité. Et, à cet égard, le bureau fermé (individuel ou collectif) permet bien mieux de réaliser la quasi-totalité des tâches que nécessite l’activité. Plus encore, alors qu’en bureau collectif, et même en open space classique, le voisinage est maîtrisé (on sait comment, où et quand trouver celui qu’on cherche), le flex office brouille ces repères et, plutôt que de favoriser des échanges directs, incite à se contacter par mail ou par messagerie. Imaginer que le salarié trouvera profit à passer son temps à adapter son lieu de travail à l’activité, c’est donc faire peu de cas de la réalité : si l’ergonomie, en distinguant le travail prescrit du travail réel, a bien montré que l’activité réelle d’une personne est toujours singulière et ne peut être limitée à la vision théorique qu’en ont en général les concepteurs ou les organisateurs, c’est que le salarié est régulièrement confronté à des variations (de son propre état comme de celle de la situation de production) qu’il est très difficile d’anticiper, obliger à changer de place voire d’adresse selon les besoins, c’est poser une contrainte cognitive supplémentaire d’adaptation constante et chronophage.
Le management d’équipe, enfin, est lui aussi rendu plus complexe : il peut découler de cette nouvelle configuration un besoin d’informations/de suivi de plus en plus « régulier » pour ne pas dire « serré » chez les managers, créant le sentiment d’une surveillance accrue chez les collaborateurs (plus d’échanges sur l’avancée du travail, plus d’objectifs pour mieux visualiser comment le travail est réalisé, plus de reporting, etc.). Et pour le collaborateur, le manager n’est plus à une place précise ; et lorsqu’on l’a trouvé, le lieu n’est pas toujours propice à aller lui dire ce qu’on avait à lui dire. Il faut alors organiser l’échange, réserver une salle… bref, flex ne rime pas avec fluide.
Pour nous, le constat est sans appel : nombre d’expertises réalisées sur le sujet nous montrent que la mise en place du flex office n’apporte rien de positif en termes organisationnels. C’est même l’inverse : tel qu’il est très majoritairement envisagé et mis en place, le flex office dégrade les conditions de travail, car il transfère des coûts organisationnels vers les salariés (obligeant à s’organiser pour se mettre au travail), altère l’autonomie (les bénéfices d’un collectif fixe et de l’appropriation de l’espace sont balayés), gêne le collectif, et sa prise en charge financière est loin d’être systématiquement à la hauteur. Finalement le flex office « tend » le travail (au sens du modèle épidémiologique de Karasek) en conjuguant une réduction des marges de manœuvre (moins de places, plus de contraintes organisationnelles) et l’augmentation de l’exigence de travail (organisation logistique supplémentaire et adaptation permanente).
Symboliquement ce n’est guère mieux, la mise en place du flex office accentuant encore le défaut de reconnaissance dont se plaignent déjà très souvent les salariés : n’ayant plus de place réservée le salarié devient un « sans bureau fixe ». Non seulement il n’a plus sa place, mais il doit de surcroît effacer toute trace de son passage. Tout se passe comme si on tolérait sa présence, guère plus. Inutile dans ces conditions d’évoquer un management bienveillant : c’est mettre une fois encore les managers en situation d’injonctions contradictoires.
De plus, à l’inverse de l’effet recherché, le bureau partagé finit par être inaccueillant : comme il interdit toute personnalisation, toute appropriation, il rime avec dépersonnalisation et même, disent nombre de salariés rencontrés, avec déshumanisation. Ce point peut paraître anecdotique (avoir une plante ou des photos sur son espace de travail, est-ce nécessaire ?). Pourtant, de nombreux travaux soulignent l’importance de pouvoir s’approprier certains espaces : la possibilité de personnaliser son lieu de travail améliore à la fois le bien-être et les performances dans certaines tâches. Chez l’être humain, la territorialisation de l’environnement permet en effet de répondre aux besoins de sécurité, d’action et d’identification. À l’inverse, l’absence totale d’intimité influence sensiblement la performance de manière négative. Il n’est plus à prouver que le bien-être des salariés conditionne la réalisation d’un travail de qualité. Or, le respect d’une forme d’intimité contribue en grande partie à ce bien-être. En ce sens, les aménagements d’espaces de travail qui empêchent les salariés d’être en confiance représentent un risque, à la fois pour la santé (développement de troubles d’anxiété et de stress), mais aussi pour l’activité à travers la baisse de la performance.
Prévenir
Tout cela n’est pas sans conséquence. Nos expertises ont systématiquement montré que les usages du flex office impactent la santé mentale des salariés (stress, démotivation, etc.) et détériorent la santé sociale (difficulté d’intégration des nouvelles recrues, isolement et/ou tensions au sein des équipes, développement de la défiance entre managers et collaborateurs, etc.). Ces résultats sont parfaitement confirmés par ceux de l’étude que la Fondation Pierre Deniker présentait en 2018 au Conseil économique, social et environnemental (Cese) faisant apparaître que si, déjà, « plus d’un actif sur cinq [22 %] présente une détresse orientant vers un trouble mental », ce chiffre monte à 33 % lorsque les actifs travaillent en flex office.
Les projets de déploiement du flex office nécessitent donc d’être pris au sérieux, et notamment par les représentants du personnel en CSE, qui doivent consultés sur le sujet. Ces derniers, dans le cadre de leur rôle de prévention, s’attacheront avant tout à vérifier :
- la méthode de calcul et les niveaux de ratios sur lesquels reposent la mise en place du flex office ;
- dans quelle mesure et selon quelle méthode les salariés ont été consultés pour que le projet réponde à leurs besoins ;
- d’une manière générale, si le projet s’appuie sur une analyse réelle et sérieuse des besoins des salariés et, donc, tient suffisamment compte de l’activité telle qu’elle se réalise vraiment ;
- la politique de télétravail qui l’accompagne (sans oublier la politique de remboursement des frais occasionnés par le télétravail) ;
- la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp), sur la base de l’étude d’impact sur les conditions de travail et la santé des salariés que l’employeur doit fournir avec le projet.
À cet égard, le Code du travail prévoit, d’ailleurs, la possibilité que les élus au CSE se fassent accompagner par un expert.
[1]- Voir, par exemple, Guillaume Pitron, L’enfer numérique. Voyage au bout d’un like, Les Liens qui Libèrent, 2021, 352 p.