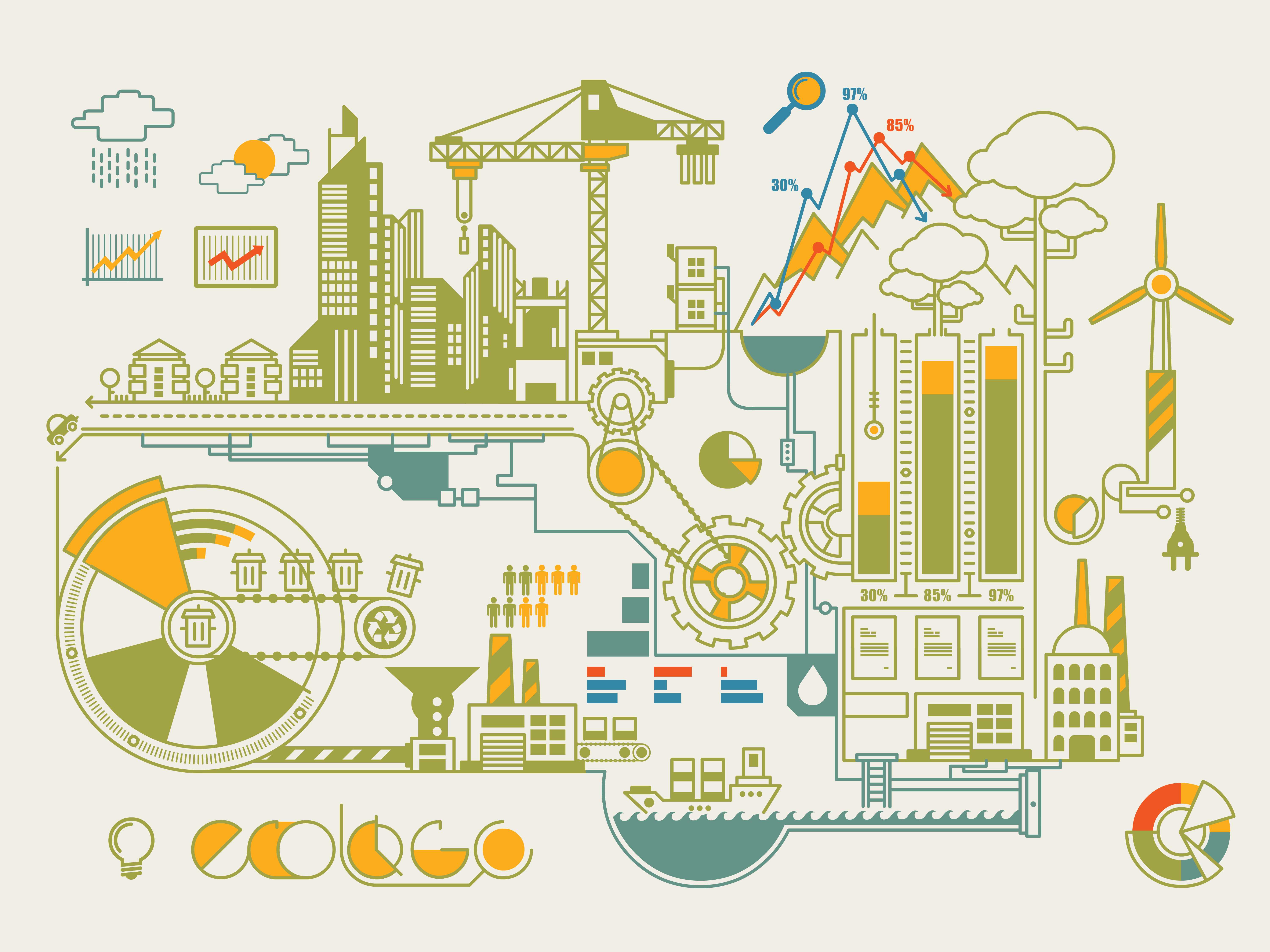Les services se caractérisent par des productions largement immatérielles, non mesurables et non dénombrables. Elles exigent des organisations du travail qui permettent de susciter un engagement subjectif des travailleurs dans des relations, au profit de prestations à exécutions successives en concomitance et colocalisation, exigeant la simultanéité de la conception et de la réalisation. Clients et fournisseurs échangent un consentement à la dépense contre un engagement au service. Ces activités demandent une connaissance des contraintes des uns et des objectifs des autres, une valorisation de l’expertise du travail au contact, une coopération dans la coproduction des services, une co-évaluation des effets utiles pour les bénéficiaires et des conditions de travail pour les œuvrants. La performance est alors fonction d’une capacité de développement de la pertinence située[1] et des ressources en compétences...
Les services ont besoin d’un management « serviciel »
Toutes ces caractéristiques valent pour les Services aux Environnements de Travail. Ils constituent aujourd’hui une filière de première importance[2], mais avec une spécificité ; cette filière a été constituée sur un demi-siècle, non par des innovations technologiques, mais par externalisation. Des prestataires spécialisés sont en charge, pour les entreprises et administrations, de leurs services de propreté, sécurité, accueil, restauration, maintenance des espaces de travail, des immeubles et des équipements techniques.
Ces activités sont désormais (et en tendance) majoritairement confiées par contrats à des prestataires spécialisés et structurés métier par métier. Ils emploient de l’ordre de 1,1 millions de salariés, non sans difficultés de recrutement. Les œuvrants des services travaillent ainsi côte à côte, « à demeure » mais chez les autres. Ils ne sont plus intégrés, ni en collectifs de services, ni aux collectifs de travail auxquels ils contribuent. Des contrats commerciaux à durées déterminées installent une précarité voulue par les clients. Les rapports de sous-traitance (et de sous-sous-traitance) hiérarchisent les métiers. Ils ne sont plus gérés et rémunérés sur les mêmes conventions. Les achats sont systématiquement mis en regard d’un calcul de coûts constitués très majoritairement des salaires. Les services sont mobilisés le plus souvent séparément, métier par métier, alors qu’ils ne font valeur qu’une fois intégrés, pour les mêmes bénéficiaires sur les mêmes espaces.
Au contraire, obtenir des services externalisés performants, au-delà de l’achat de moyens, exige de reconstituer des organisations, des collectifs et une capacité à donner du sens au travail pour engager subjectivement des personnes, mais sans le recours à la subordination directe. Déjà mal valorisés, le sens et la pertinence de ces services sont invisibilisés.
Ce que l’intégration par l’embauche et des formes de solidarités par la proximité et la durée ne peuvent plus faire, des appareils prescriptifs, des clauses contractuelles, des process, des reportings et des KPIs…, bref, toute une bureaucratie inadaptée aux services prétend y pallier, avec nombre d’effets délétères.
Une doxa industrialiste appliquée aux achats de services
C’est le résultat d’un mouvement pluri séculaire de bureaucratisation qu’accélèrent encore les outils numériques, effet de cette dérive libérale que décrit David Graeber[3]. S’agissant particulièrement des services, c’est aussi la conséquence d’un déficit doctrinal majeur. Pour les activités industrielles, Taylor, Fayol et Ford nous ont dotés d’une compréhension et de méthodes pour penser l’organisation du travail et développer la productivité, y compris par l’automatisation. Elles ne sont pas pertinentes pour les services.
Héritée des échanges de biens tangibles, la doxa dominante des achats[4] pense les services comme des quasi-biens, banalisés, stables et standardisés, ce qu’ils ne sont pas. Elle postule que le client est capable de prescrire, de décrire, de définir et de juger de ce dont il a besoin. Pour les services, c’est une fiction. Au contraire de la pertinence d’engagements réciproques sur des contrats d’intérêts communs, elle postule que les objectifs des uns (payer le moins cher possible) sont contradictoires de ceux des autres (maximiser la marge), d’où une défiance construite et théorisée. Cela construit la défiance mutuelle. Elle s’adosse à un déséquilibre des rapports de force entre des clients qui sont sûrs d’attribuer un marché, pendant que les prestataires mis en concurrence ne sont pas certains de le remporter. C’est une position d’acteur. Cette doxa postule qu’il existe un marché des services de ce type. C’est faux. Elle prend pour acquis que la mise en concurrence périodique par appel d’offre est plus vertueuse (la peur) que des relations (de confiance) fondées sur la durée et l’interconnaissance. C’est une théorie parmi d’autres. Elle prône que les contrôles et clauses de pénalités sont nécessaires à une garantie d’obtention des engagements des prestataires. Elle naturalise la défiance. Faute de capacité à refonder régulièrement des accords sur le travail bien fait, les échanges sont encadrés de KPIs, des pénalités et valorisés par les coûts. Ce sont des prothèses décalées et inefficaces.
Pile je gagne, face tu perds !
Des contrats d’intérêts communs libellés en moyens seraient possibles et pertinents [5]. Ils sont réputés « rustiques », pas assez contraignants et suspects de laisser la porte ouverte au risque du marchandage. De fait, ils sont surtout difficiles à dimensionner pour des représentants des clients (prescripteurs, acheteurs, contrôleurs et commerciaux, consultants des uns et des autres) trop éloignés des réalités variables et évolutives. Les pratiques actuelles privilégient donc très majoritairement les contrats libellés en obligation de résultats.
On sait bien pourtant que la portée opérationnelle des descriptions d’activités servicielles à exécution successive ne dépasse pas une aide au chiffrage des coûts sur des fréquences moyennes ou des niveaux standards. Les engagements en résultats, toujours sujets à controverses, sont en pratique doublés d’exigences en moyens. On peut chiffrer des coûts d’hôtesses, pas la valeur de leur accueil. On peut fixer des fréquences de nettoyage sans définir la propreté utile et raisonnable. On peut exiger un temps d’intervention maximal pour remettre en fonction un équipement en panne, cela ne dit la pertinence des coûts associés. Les engagements de résultats sont en réalité doublés d’engagement de moyens. Quand ce n’est pas explicite, c’est attendu dans l’esprit. Ainsi, les indicateurs imposés, les pratiques de contrôle et les menaces de pénalités définissent de fait des obligations de moyens. Facialement, le client est gagnant. Il délègue au prestataire sa co-responsabilité sur les résultats, alors qu’il décide seul du prix qu’il est prêt à payer.
Cette posture « Pile je gagne, face tu perds », est rendue possible du fait de rapports de force déséquilibrés. Ces services sont « à forte intensité de main d’œuvre » et faiblement capitalistiques. Tant que la pénurie de main d’œuvre ne modifiera pas la donne, le client trouvera toujours un prestataire « moins cher ». Le client est sûr d’attribuer le marché, les prestataires sont dans le risque commercial. La concurrence y est d’autant plus forte que les prestations proposées sont difficiles à différencier par avance car elles sont à « exécution successive ». Au moment de la signature, rien n’est en place. Parler de « marché » relève ainsi de l’abus de langage. Il y a bien des échanges, il y a bien de la concurrence, mais il n’y pas de marché. Il n’y a pas deux immeubles ni deux bénéficiaires identiques, il n’y a pas de production strictement reproductible et comparable, réalisée dans des conditions strictement équivalentes. L’effet utile n’est pas proportionnel à l’effort. Chaque bénéficiaire co produit, plus ou moins. La manière de « rendre le service » est aussi importante que le service lui-même. Marchés, standards, fréquentiels, coûts moyens sont des fictions. Elles sont parfois utiles à certains, elles masquent les déséquilibres et des impasses, mais elles ont des conséquences nuisibles sur le travail et les relations.
Des prestataires sont contraints d’accepter les termes de contrats qu’ils savent ne pas pouvoir honorer. Ils joueront autour de la lettre, sur les imprécisions et les incomplétudes, sur les variabilités, sur la non mesurabilité des résultats…. Ils essaieront de « se refaire », dans la vie du contrat en plaçant des « travaux supplémentaires » sur devis, à marges plus favorables. Personne n’est vraiment dupe. Les opérationnels sur les sites l’expriment parfois d’une boutade : « Quand les commerciaux et les acheteurs signent là-haut, en central, , ils sablent le champagne, mais après, c’est nous qui trinquons ! ». La défiance n’est pas seulement postulée, elle est alimentée. Elle suscite et justifie ensuite des systèmes de contrôles et de reporting, de pénalités et de KPIs, d’autant plus développés que c’est par le contrat, et non la subordination, qu’il faut garantir la contrainte d’organisation et les objectifs de résultats.
L’invention des indicateurs pastèques
C’est dans les services aux environnements de travail que nous avons rencontré cette métaphore. Un indicateur pastèque, c’est un indicateur calculé et présenté sous la couleur verte, celle qui est attendue, quelle que soit la « couleur » du résultat réel. C’est un cas d’école pour sociologue praticien. Par construction, les KPIs sont conçus pour être chiffrés et en même temps, ils sont incapables de rendre compte des réalités des productions servicielles. Mais puisque les acteurs doivent « reporter » et composer avec les pouvoirs gestionnaires, ils développent des jeux d’acteurs autour de ces « actants ».
Pour pouvoir parfois simplement travailler, les acteurs de terrain « traitent » la contrainte bureaucratique. Ils la neutralisent et la transforment, si possible, en protection. Plus il y a de KPIs pour « contrôler » et garantir la conformité, plus les opérationnels des deux côtés (souvent en complicité) composent avec la règle. Dans les Services aux Environnements de travail, l’écart de pertinence est tel, entre ce que les KPI « mesurent » et la valeur produite dans le réel, que les acteurs sont incités à tricher. Ils le font pour retrouver leur autonomie : quand les tableaux sont verts, « on » les laisse travailler. Ils le font surtout pour respecter l’esprit et le réel, la finalité même de leur travail, mais qui échappent aux métriques. L’intelligence est mobilisée, les acteurs innovent, ils transforment la gestion « par » les indicateurs en une gestion « des » indicateurs !
Le problème n’est pas dans les indicateurs. Des indicateurs sont utiles quand ils indiquent. Ils le font mal souvent pour les services, de manière lacunaire toujours, sans être suffisamment pondérés par le contexte ou les circonstances. S’ils ne sont pas trop couteux à documenter, ils sont utiles quand ils sont un support à discussion, quand ils sont pris pour ce qu’ils sont ; des outils de dialogues aidant à comprendre. Le problème n’est pas dans les indicateurs, mais dans leurs usages. Quand ils sont accrochés par contrats à des bonus ou malus, à des exigences de conformité, quand ils nourrissent la crédibilité de menaces de pénalité… ils n’indiquent plus. Ils jugent, ils alimentent des « sentences » et des décisions. Dès qu’un indicateur en rouge est entendu comme un jugement négatif sur le travail fait ou les personnes, comme une exigence de plan de redressement (des moyens et des coûts), dès lors qu’il alimente un risque de pénalité, ils n’indiquent plus. Les KPIs (actants instrumentaux) participent mécaniquement de la décision, voire, « on » les laissent décider sur la foi de leur métrique. Non seulement ils invisibilisent le réel du travail, mais ils justifient des décisions prises à la place des acteurs. On comprend alors qu’il soit tentant pour ces derniers de les verdir avant qu’ils ne sortent en « reporting » officiel.
Ces KPIs ainsi pensés et utilisés sont pathologiques. Ils correspondent aux exigences de gestion/suivi des contrats, comme aux besoins de gestionnaires dont la valeur ajoutée doit être interrogée, éloignés des œuvrants des services comme des bénéficiaires réels. Ils instrumentent des responsabilités exercées dans la méconnaissance des conditions réelles de la mise en œuvre des services. Ce faisant, ils alimentent cette défiance qui justifie les contrôles et les crédibilisent les menaces de sanctions, au final très rarement appliquées. Le verdissement des indicateurs est une réponse intelligente et thérapeutique à des demandes de systèmes improductifs et pathologiques. Il permet au moins de dégager l’espace nécessaire pour faire son travail, malgré tout, sans avoir à contester l’inutilité des systèmes bureaucratiques et des fonctions associées.
Conclusion
Des relations de services ne s’achètent pas comme des fournitures. La performance des services ne sera jamais suffisamment constituée, ni par des contrats formels, ni par une exigence de conformité à des prescrits lacunaires dont les KPIs sont de surcroît des représentants d’autant moins pertinents qu’ils peuvent toujours être opportunément « verdis ». On ne gère pas la qualité relationnelle et la pertinence du travail serviciel à l’aide de contrats formels et de métriques simples. Dans les services aux environnements de travail, l’application des concepts industrialistes produit des accords formels, souvent détaillés et volumineux, mais dont on sait qu’ils ne seront pas mis en œuvre. Ils menacent de pénalités très rarement appliquées et pourtant parfois provisionnées. Ils exigent des résultats qui sont toujours sujets à discussion en regard de leur pertinence.
On ne décrit et on ne prescrit pas des prestations à exécution successive comme des biens tangibles ou des prestations à exécution instantanée. Défiance et méconnaissance du réel débouchent ainsi sur une demande pathologique de contrôle et de reporting. Externaliser des services, c’est « marchandiser » des relations[6]. On attend des personnes qu’elles soient engagées et solidaires, mais en organisant une précarité et distanciation sociale à leur détriment.
Comment engager, obtenir une qualité de relation, une pertinence située des activités, tout en régulant l’initiative de travailleurs que l’on s’interdit de subordonner ? Réunir les conditions du « travailler ensemble » avec des œuvrants non directement subordonnés exige la construction de compromis par la refondation périodique d’accords sur le travail bien fait. Cela impose un débat sur la valeur des productions servicielles qu’aucune mécanique de marché ni aucune métrique ne peuvent régler, cela d’autant plus que les rapports de force sont structurellement déséquilibrés. Cela demande de reconstruire les conditions d’une proximité et de devenirs en commun, malgré les différences. Cela demande une doctrine servicielle et non la simple transposition des acquis de l’industrie.
[1]- Voir Xavier Baron., « Repenser l’évaluation, des services ; de la qualité à la pertinence située », Work Place Magazine, n° 276, juin juillet 2018, pp 55-57. [2]- Source Etude CRDIA, SYPEMI, IDET publiée en mars 2022. [3]- David Graeber, Bureaucratie, Editions Les Liens qui Libèrent, 2015. [4]- Parfois encore aggravée par les règles d’achat public encadrant l’usage des fonds publics et l’exclusion de toute forme de préférence voire de corruption. [5]- Jean-Yves Kerbouc’h, Xavier Baron, « La sous-traitance de services support aux entreprises », La Semaine Juridique, Entreprises et Affaires n° 26, 1er juillet 2021, pp 43-53. [6]- La théorie de la firme de Ronald Coase rappelle que les externalisations réintroduisent des coûts de transaction.