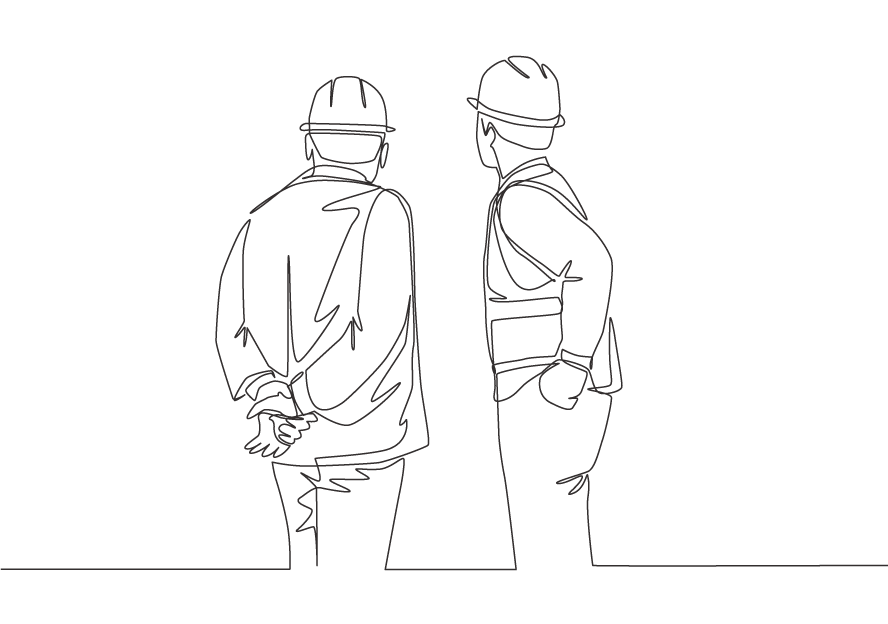D’un point de vue philosophique, la vulnérabilité est considérée comme un des constituants fondamentaux de la condition humaine ; elle renvoie à une précarité, une absolue dépendance initiale, comme marque même de l’humanité, ce qui lui donne une dimension universelle. Cela ne veut pas dire pour autant que les personnes vivent la maladie ou la mort de la même façon, ni qu’il y a une égalité entre les hommes pour supporter au mieux celles-ci. La vulnérabilité est un appel à la sollicitude, concept bien connu des professionnels du soin ; il s’agit de la possibilité d’être affecté, d’être ému, d’être accessible au plaisir, à la douleur, au temps, à l’incomplétude du psychisme, soulignant à la fois notre besoin de l’autre et notre ouverture à l’autre. L’éthique de la sollicitude a été théorisée en France notamment par les philosophes Paul Ricœur et Emmanuel Levinas. Dans le champ de la politique du développement humain, la vulnérabilité représente un paradigme qui défend l’idée que la puissance d’être d’un individu augmente d’autant plus que celle des autres hommes s’accroît. Elle est fondée sur la notion d’interdépendance. Pourquoi alors employer le mot vulnérabilité au pluriel ? Sans doute parce que le champ de la vulnérabilité se décline dans la diversité des catégories : vulnérabilité liée au handicap, à la condition sociale et culturelle, à l’âge, à l’état de santé mais également au monde du travail.
A la faveur des sciences sociales, les vulnérabilités liées au travail sont désormais bien repérées. Celles liées à l’activité des professionnels du soin et de l’accompagnement ont pour leur part, été longtemps peu perceptibles. Le soin suppose une relation éthique, en espérant qu’elle le soit, qui vise le bien d’autrui. Or, la dimension du soin se heurte aujourd’hui à la vision entrepreneuriale de l’hôpital et de ses contraintes budgétaires qui forcent les organisations soignantes à réduire de plus en plus le temps consacré par patient. L’histoire des soins nous enseigne que si la compétence soignante basée sur un souci d’autrui n’a pas beaucoup évolué depuis trois siècles, « l’expertise soignante », quant à elle, a suivi une logique d’amélioration et de rationalité des moyens (en termes préventifs, thérapeutiques etc.).
Du même coup, en se professionnalisant, le soin a été rattrapé par les sciences de la gestion. Depuis les années 80, celles-ci inventent et structurent le monde du soin de la même façon que le monde du travail au détriment de la logique du métier. Désormais l’activité soignante doit être coordonnée rationnellement, codifiée dans des tableurs, pour être optimisée suivant des objectifs quantifiés. Ce contexte qui répond à une logique comptable, agit sur le travail du soin alors qu’il n’est pas au cœur de sa culture ni propre à son milieu. L’injonction à laquelle les acteurs du soin seraient soumis ne serait pas tant de soigner bien que de soigner vite.
Dans ce contexte, les professionnels paramédicaux qui ont souhaité, au fil du développement de leur carrière, de s’engager dans l’encadrement d’une équipe ou d’un service de soins[1] sont soumis, bon gré mal gré, à une distanciation progressive de leur métier d’origine. Au cœur d’une organisation hospitalière en profonde mutation, leurs pratiques managériales s’en trouvent fortement impactées au quotidien. Les cadres de santé sont souvent coincés dans un conflit de valeurs qui les fragilise : symptômes de l’épuisement émotionnel, quantité de travail, pression du temps, obligation de devoir réaliser un travail morcelé, manque de reconnaissance. Ils dénoncent la nécessité de devoir occuper des rôles incompatibles entre eux entre des objectifs de rentabilité et la qualité des soins.
Dans son « Education médicale vue par un philosophe », Michel Serres avance l’idée que le médecin pourrait bien avoir deux têtes : l’une d’intelligence scientifique soucieuse de compétence, focalisée sur un problème technique à résoudre[2] et l’autre, préoccupée de sollicitude et de responsabilité, attentive à la finalité de la médecine, au contexte de son travail, à la situation singulière du patient : « l’une reste dans la science, l’autre plonge dans le paysage ». Ces deux orientations de la pensée ont leur ordre et leur rigueur propres, et pour que cette dualité devienne source non de tension, de déchirement, mais de justification, il faut se garder notamment de ne vouloir dévisager le cadre soignant que dans le miroir du management.
De fait, soin et management sont deux perspectives téléologiques opposées.
D’un côté, les valeurs professionnelles liées aux soins naissent à travers une morale, une éthique, les rapports aux patients, mais aussi une législation qui régit les professions du soin. Les valeurs partagées sont à la fois liées à un attachement fort à l’institution comme à la fonction soignante. Tournées vers la prise en soin du patient avec le respect, l’écoute, la disponibilité, et toute la dimension relationnelle qui en découle, les cadres de santé sont à l’interface entre l’équipe et l’institution et deviennent ainsi porteurs de valeurs, aussi bien pour l’équipe que pour l’institution. D’un autre côté, un contexte économique de plus en plus contraignant s’impose à eux. La notion « d’économie » renvoie à une notion de productivité et se heurte ainsi aux principes de considération dans le temps consacré à la prise en soins des patients. En effet, un questionnement émerge entre la qualité des soins, en termes d’efficience avec les moyens disponibles et nécessaires, et le souci de pouvoir garder du sens au travail réalisé.
Le défi éthique et politique pour les cadres de santé réside sans doute dans le fait de ne pas succomber à la passion des moyens, ni au chant des sirènes des économistes qui tentent de nous convaincre que l’ensemble de nos actions seraient en permanence le fruit d’un calcul pour maximiser nos propres intérêts, dans la concurrence avec les autres. La santé reste une sphère sociale qui ne peut se réduire au calcul. Le désenchantement grandissant qui s’installe chez les soignants nous invite aujourd’hui à détourner les outils de gestion et de management pour repenser les capacités d’émancipation. Le manager n’est-il pas convié à prendre soin de ceux dont il a la charge ? Cette question nous invite à réfléchir sur le sens donné au travail, en l’occurrence, sur le sens donné au soin et à remettre en cause une approche purement gestionnaire du management.
Le management quant à lui, évoque encore des techniques d’exploitation et de manipulation des personnels, comme une tentative de réduction de l’être humain à la seule dimension de moyen, tel que le laisse d’ailleurs entendre la notion de « ressources humaines ». Certes, il s’agit là d’une vision réductrice du management, mais qui reste présente dans nos esprits et qui est probablement nourrie par l’approche taylorienne qui va par exemple jusqu’à définir la durée d’une toilette pour un patient, générant frustration et culpabilité chez les soignants. Le management a pour objet de faire travailler autrui afin d’obtenir les meilleurs résultats attendus dans le cadre de liens interpersonnels pensés au service d’une organisation, d’une institution. L’ensemble de pratiques qu’il recouvre ont pour but de faire le meilleur usage des ressources dont dispose l’institution, et en visant les meilleurs résultats pour le plus grand nombre, ces pratiques inscrivent le management dans une perspective utilitariste.
Comment alors est-il possible de parer à ces vulnérabilités et développer des actions managériales bénéfiques qui ne produisent pas automatiquement du bénéfice ? Comment les cadres de santé peuvent-ils incarner de véritables personnes ressources qui vont aider leur équipe à s’adapter aux changements et à développer les compétences en favorisant la coopération et l’intelligence collective ? Partons du fait que les relations humaines dans le monde du travail ne peuvent se réduire à des relations qui seraient uniquement contractuelles entre des personnes totalement autonomes. Le monde du travail est un monde d’interdépendance qui ne vise pas uniquement le profit. Ce qui relie le monde du travail à celui du soin repose en partie sur la prise en considération des relations d’interdépendance et la possibilité de créer des espaces de coopération, de collaboration entre les individus. Si l’organisation des soins a besoin de reposer sur des interactions stabilisées qui s’inscrivent dans des formes de régularité, de continuité, la coordination des soins et leur management, deviennent les moyens au service de la coopération sociale entre soignants mais aussi entre soignants et soignés.
En prenant soin des relations de soin, en les accompagnant et en les soutenant, les cadres peuvent dépasser ainsi la situation paradoxale dans laquelle ils peuvent se penser. Si l’éthique spécifique de l’entreprise, en l’occurrence ici l’hôpital, correspond à un projet dont l’activité répond à une utilité sociale à l’intérieur d’une communauté humaine portant des responsabilités vis-à-vis de ses parties prenantes, alors, sur quels fondements philosophiques, et avec quelles convictions les cadres soignants peuvent-ils soutenir et justifier leur l’action sans trahir leur éthique soignante ?
Une première ressource se trouve dans l’apport des éthiques du care[3] qui consistent à se sentir responsable de soi et des autres. Les cadres de santé sont certainement les managers les mieux placés pour tenter de faire en sorte que la gouvernance hospitalière intègre le care à un niveau managérial. Ainsi, l’attention à l’autre passe par une phase individuelle, une attention particulière par rapport aux compétences, mais aussi au niveau de l’équipe par le biais de l’intégration. Une place importante est soulignée pour prendre le temps d’échanger et pouvoir communiquer en donnant du sens. Les valeurs évoquées pour ce faire sont l’estime, la reconnaissance, la valorisation et le respect réciproque.
Le care, autrement dit l’éthique de la sollicitude vis-à-vis d’êtres en état de souffrance et de vulnérabilité, est devenue une exigence incontournable qui crée le sens du métier de cadre soignant tout en permettant d’organiser au mieux la distribution des rôles au sein d’une équipe. Ici, l’éthique qui peut être mise en pratique n’est pas seulement une valeur ajoutée au métier de soignant, mais elle devient un style de management. Dans cette perspective, le manager qui adopte une telle disposition éthique se met en situation de percevoir la vulnérabilité de ceux qui l’accompagnent avec sollicitude et parallèlement, il se sent en droit de demander de l’aide lorsqu’il se sent en difficulté. Il peut ainsi travailler à maintenir, consolider ou restaurer les liens qui sont la condition de toute forme de vie sociale (confiance, sollicitude, empathie, respect de l’autre et de soi-même).
Ainsi, lorsque le manager exerce son autorité sur celui qu’il accompagne, il peut l’aider à devenir l’auteur de ce qu’il entreprend, faisant en sorte que la personne se sente utile et parvienne ainsi à donner du sens à la tâche qu’elle accomplit. En cela, le cadre contribue à l’augmentation de sa puissance d’agir.
Une seconde ressource s’inscrit dans la théorie du don.
Sollicité essentiellement dans le cadre des recherches de la sociologie du travail et des théories sur la reconnaissance, le paradigme du don élaboré par Marcel Mauss, est mobilisé aujourd’hui pour étudier la nature des rapports sociaux entre les acteurs au sein d’une organisation[4]. Il permet de nuancer les a priori qui voudraient voir uniquement dans le monde de l’entreprise un lieu de domination et d’instrumentalisation des salariés où coexistent des comportements égoïstes qui ne favoriseraient que la concurrence entre collègues. Selon Norbert Alter, les entreprises et donc l’hôpital, forment autant de lieux de socialisation, terrain fécond et privilégié pour réinitialiser le paradigme des échanges sociaux, où donner est un des moyens de participer simplement, quotidiennement, à la communauté de travail. Dans une approche critique du libéralisme économique, Alter nous invite à rechercher les conditions qui fabriquent du collectif, de la coopération ainsi que la solidarité entre pairs dans une organisation de travail.
Alors que « l’application de la rationalité étroitement économique aux affaires ne permet pas toujours de définir des comportements efficaces »[5], l’efficacité des comportements professionnels et entrepreneuriaux est soumise à la capacité de savoir donner et même parfois de faire de « véritables cadeaux » (par exemple, la loi du 9 mai 2014 autorise un salarié à renoncer anonymement et sans contrepartie, à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant la charge d’un enfant gravement malade). Ainsi, la réussite d’une entreprise va dépendre de la façon dont elle pourra mobiliser la triple logique de donner-recevoir et rendre ; ici il s’agit de donner de la formation, de recevoir du savoir-faire et de rendre de la compétence… À défaut, Jean-Paul Dumond[6] considère que si ce cercle du don se brise, il engendre une période de retraits. Retrait des initiatives, retrait de la présence sous la forme de l’absentéisme, retrait de la vie comme dans les suicides en rapport avec l’activité de travail.
Bien que « marchandisé »[7] et de plus en plus technicisé, le monde du soin peut rester centré sur des actes de sollicitude réciproque. Le don peut s’exprimer dans l’horizon impersonnel de l’hôpital et les soignants exercer leur activité dans et à travers leur engagement personnel traduit par la conscience professionnelle. Pour le cadre soignant, la relation de confiance qui doit se nouer avec le patient peut tout autant se développer avec les membres de l’équipe qu’il encadre. C’est sans doute en partie grâce à cette dimension qu’il peut donner du sens à son activité (même si le don ne se « gère » pas). Dans cette perspective, le management des soins va consister selon ce point de vue, à trouver le juste équilibre entre la volonté de mettre les pratiques professionnelles en cohérence avec les attendus légitimes des patients, des personnes accompagnées, de la société toute entière, et le désir de faire confiance aux équipes dans leur savoir-faire et leur créativité, dans les échanges. Les rapports hiérarchiques ou entre pairs permettent une multitude de rapports de proximité, potentiellement favorables à un ajustement mutuel des compétences de chacun avec celles de ses interlocuteurs. Toutefois, cela suppose que le sommet de la hiérarchie prenne les devants en faisant sien ce souci dont les bonnes pratiques ainsi instaurées pourront ensuite se propager sous l’effet de l’exemplarité.
En désignant par le terme de gratitude ce qui permet le dépassement d’une lutte insatiable et infinie de reconnaissance[8], Paul Ricœur nous invite à attendre des progrès significatifs en termes d’efficience, de motivation, de qualité et de sentiment de reconnaissance comme autant de sources de bien-être au travail. Pourquoi les cadres de santé ne pourraient-ils pas s’engager vers le modèle de l’homme capable, capable de parole, d’action, de promesse et de réalisation, de choix et d’initiative ? Parce que notre société très plurielle ne s’accorde pas sur ce qu’est le bien[9], peut-on du moins réfléchir à ce que seraient « des institutions justes » telles que le philosophe en définit les contours dans sa visée éthique, c’est-à-dire « une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes » ?[10]
[1] La profession de cadre de santé telle qu’elle est définie aujourd’hui s’appuie sur le décret 95-926 du 18 août 1995.
[2] Le diagnostic, la thérapie, la compréhension d’un mécanisme biologique, telle interprétation de données, etc
[3] La notion de care vient du monde anglo-saxon pour caractériser l’ensemble des activités centrées autour du soin relationnel, du souci de la personne, par opposition au cure qui renvoie aux actes de soins techniques. Initié par le mouvement féministe nord-américain, il est devenu un véritable mouvement politique qui met en exergue la vulnérabilité comme élément essentiel pour réaffirmer l’urgence de la question sociale, la nécessité de « prendre soin » des précaires, des exclus et des invisibles du monde néolibéral. Voir Fabienne Brugère, L’Ethique du care, Que sais-je ?, 2017.
[4] Voir La Revue du M.A.U.S.S. Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, revuedumauss.com.
[5] Voir la thèse de Jacques Godbout qui identifie des types d’échange, qui s’apparentent de façon plus ou moins étroite à la dimension structurante du don.
[6] L’Empreinte des dirigeants, EHESP, juillet 2011.
[7] Voir « Marchandiser les soins nuit gravement à la santé », la Revue du MAUSS n°41, 1er semestre 2013.
[8] P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance, Trois études, Stock, 2004.
[9] P. Ricœur, Philosophie, éthique et politique, Seuil, 2017, p. 45-46.
[10] P. Ricœur, Soi-même comme un autre [1990], Seuil, 2015.