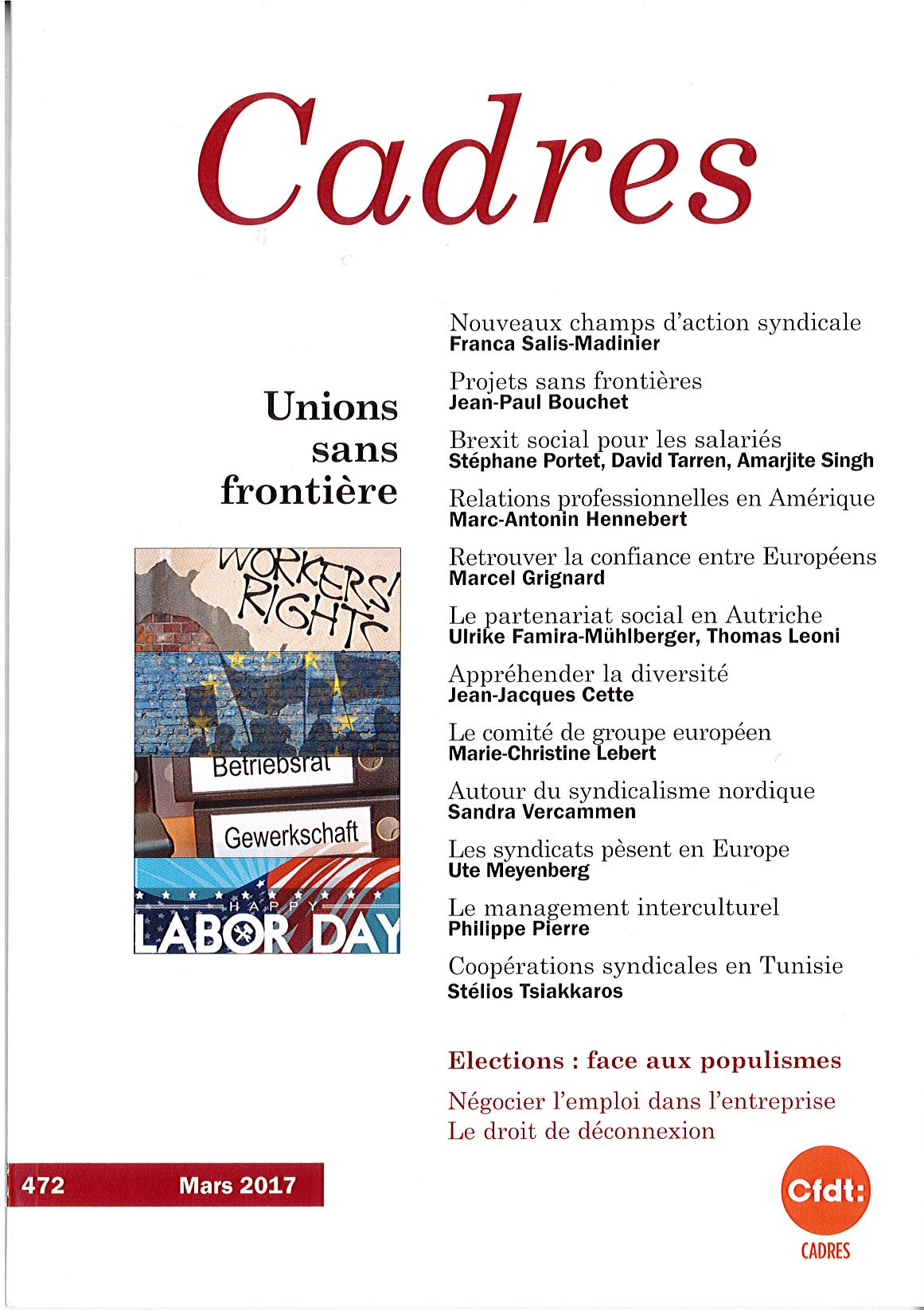Comment la négociation au niveau de l’entreprise peut-elle intervenir en conjuguant l’ajustement du niveau d’activité à la dynamique économique et le maintien des normes actuelles de protection sociale, sinon leur extension ? Malgré la progression quantitative des accords locaux, la perception de la qualité du dialogue social dans l’entreprise demeure, de façon paradoxale, globalement négative. Une trentaine de militants CFDT, issus des secteurs de la transformation alimentaire, des services publics ou privés aux entreprises et de la recherche agronomique ont échangé pour s’interroger sur l’impact des pratiques de négociation d’entreprise quant à l’emploi, tant en volume qu’en contenu. Des chercheurs et universitaires ont exploité l’enquête « Relations professionnelles et négociations d’entreprise » 2010-2011 afin de repérer les modes d’ajustement à la crise1.
Le contraste France-Allemagne
Pour Jacques Freyssinet (Paris 1), depuis la décennie quatre-vingt-dix, la négociation sur l’emploi est structurée par deux tendances concomitantes : la décentralisation des négociations collectives vers le niveau « entreprise » et la montée de la composante « emploi » dans ces négociations collectives. Ce phénomène peut s’observer au sein de tous les pays d’Europe occidentale.
Une comparaison entre la France et l’Allemagne révèle des situations contrastées. Au plan du contenu des accords, l’analogie apparaît forte en termes de concessions réciproques acceptées au nom de la protection de l’emploi. Les principales concessions syndicales portent sur les salaires, la durée du travail, la flexibilité organisationnelle, la mobilité géographique et l’élargissement aux diverses formes d’emploi atypiques. Côté employeurs, les principales contreparties s’organisent autour d’engagements relatifs à la préservation du niveau de l’emploi, du non-recours aux licenciements économiques, du maintien de certaines lignes de production (non-délocalisation), de garanties sur les investissements, de limites dans le recours aux formes de travail atypique et d’une évolution des droits pour les personnels concernés.
La prise de risque pour les partenaires syndicaux est importante dans la mesure où s’échangent des sacrifices immédiats pour les salariés avec des contreparties à moyen terme concédées par les entreprises. La crédibilité de ces accords n’est pas du même niveau entre la France où les accords doivent être exécutés de bonne foi sous la menace d’une possible évocation d’un cas de force majeure, alors qu’en Allemagne un meilleur équilibre des parties prenantes se combine avec la volonté de préserver l’image sociale de l’entreprise pour garantir la crédibilité des engagements pris...
En ce qui concerne les stratégies syndicales, le contraste est tout aussi marqué entre les deux pays. En Allemagne, des tensions initiales fortes sont apparues au sein du DGB sur les conditions de recours aux clauses d’ouverture. Aujourd’hui, elles en acceptent le principe ; les divergences ne portent que sur l’appréciation, au cas par cas, du caractère équilibré ou non des contreparties acceptées ou obtenues dans les accords d’entreprise. Le modèle de négociation collective a donc continué à jouer son rôle face à la crise économique, mais il l’a fait dans un espace de plus en plus restreint du fait de l’élargissement des zones d’emplois précaires non couvertes par la négociation collective. En France, la négociation d’entreprise met presque toujours en présence plusieurs syndicats représentatifs. Leurs confédérations affichent au niveau national des divergences radicales quant aux stratégies de négociation dans ce domaine, ce qui ne facilite pas au plan local la construction d’objectifs partagés. Cependant, il apparaît qu’en pratique une grande majorité des accords d’entreprise sont signés par la quasi-totalité des syndicats présents, peut-être à cause de la pression exercée sur les salariés du fait des menaces qui pèsent sur l’emploi. Il faut également noter des différences de contenus notables entre des accords d’établissement (l’exemple de Bosch) et des accords de groupe (Renault, Peugeot).
Les déterminants de la négociation sur l’emploi apparaissent largement partagés entre l’Allemagne et la France : les stratégies patronales de décentralisation de la négociation collective s’articulent avec les pressions de la concurrence internationale pour aboutir à une intensification des restructurations où les objectifs de sécurisation de l’emploi prennent une importance croissante pour les salariés. Les différences entre les deux systèmes nationaux tiennent à la nature et aux stratégies des acteurs tant syndicaux que patronaux mais également aux spécificités de l’organisation industrielle quant à la hiérarchie des niveaux où les normes sont produites.
Des ajustements aux déterminants multiples
Noélie Delahaie (Ires) révèle une pluralité des modes d’ajustement à la crise, fait générateur des tensions croissantes dans les relations professionnelles. Sur quinze établissements étudiés, tous impactés par des ajustements portant sur les effectifs, la rémunération ou l’organisation du travail, douze ont enregistré une variation à la baisse de leur volume d’activité sur 2008-2010.
Ces monographies montrent que les difficultés économiques (baisse du chiffre d’affaires ou des commandes) ont été assez vite surmontées au sein des établissements enquêtés. Pour certains, des conflits d’objectifs sont apparus (privilégier l’activité versus garantir la rentabilité) de même qu’une déconnexion entre les indicateurs de difficultés économiques (appréciés à l’échelle de l’entreprise voire du groupe) et le lieu de mise en œuvre des ajustements (l’établissement). Plusieurs facteurs défavorables à la négociation sur l’emploi sont mis en évidence : crise macro-économique de nature conjoncturelle mais aussi crises sectorielles (bâtiment, automobile, aéronautique), voire des anticipations tantôt liées aux politiques publiques (pharmacies et banques), tantôt aux stratégies autonomes de groupes privés (délocalisations, mise en concurrence de sites). Les ajustements privilégient un recours accru à la flexibilité externe (emplois précaires) ou interne (rapatriement des activités sous-traitées, chômage partiel). La chronologie des ajustements discrimine les salariés suivant leur position statutaire, de la périphérie (contrats précaires, intérim) au cœur d’activités selon un gradient de mesures sélectives (externalisation versus ré-internalisation d’activités, chômage partiel, suppression de postes). Cette discrimination provoque des polarisations entre juniors et seniors, cadres et non-cadres, permanents et précaires.
Lors des négociations portant sur les ajustements par l’emploi, les instances représentatives des personnels voient leurs capacités d’infléchissement limitées tandis que les directions d’établissement se décrivent dépossédées de marge de manœuvre face aux décisions de l’entreprise. Les IRP sont amenées à se recentrer souvent sur l’accompagnement de départs dont le caractère volontaire apparaît discutable. Certaines difficultés sont instrumentées pour négocier des compromis opportunistes, parfois sur fond de chantage à l’emploi. La négociation porte sur la remise en cause des augmentations générales garanties, la révision des grilles salariales pour les nouvelles recrues ou d’accords sur le temps de travail, voire l’imposition de mobilités fonctionnelles internes pour ingénieurs et techniciens, mises en œuvre sous l’égide de plans de sauvegarde de l’emploi ou de plans de départs volontaires.
Sauf si les modalités d’ajustement sont jugées iniques, voire contestées dans leur légitimité lorsqu’elles sont insuffisamment négociées, le niveau de conflictualité autour d’ajustements opportunistes demeure assez faible car l’ambiance générale de crise pousse à l’acceptation voire à la résignation. L’enquête révèle des relations de travail plus malléables qu’attendues mais obtenues au prix d’une perte de confiance des salariés à l’égard des directions d’entreprise. Celle-ci résulte d’une précarité multidimensionnelle générée par les nombreuses réorganisations du travail en interne, le poids des acteurs extérieurs à l’établissement dans les modes de gouvernance et la gestion des crises, ainsi que les fréquentes recompositions du périmètre des entreprises dans certains secteurs industriels.
Les enquêtes invitent à discuter la conception strictement comptable des difficultés économiques (baisse des commandes ou du chiffre d’affaires durant un nombre de trimestres variable selon la taille de l’établissement). Elles abordent le comportement des entreprises en situation de chute brutale mais conjoncturelle des commandes : auraient-elles pour autant licencier ? Pour certaines entreprises, la flexibilité interne est envisagée afin d’éviter des coûts liés à l’embauche de nouveaux salariés à former au moment de la reprise.
Pour d’autres entreprises, les licenciements économiques facilitent la gestion de crise notamment pour celles pouvant répartir la charge de production entre plusieurs sites. La création des accords collectifs de préservation de l’emploi induit un risque accru de chantage à l’emploi et de mise en concurrence des différents sites de production avec une surenchère dans les concessions exigées des salariés. Par rapport aux accords de compétitivité classiques conclus dans le secteur automobile, les accords de maintien de l’emploi (la loi de sécurisation de l’emploi en 2013, assouplis en 2015) ne nécessitent pas de justification des difficultés économiques ni de concessions patronales. Des compromis opportunistes pourraient ainsi fragiliser de façon durable les conditions d’emploi et de travail de certains salariés.
Limitations et reports du dialogue social
Selon la perspective développée d’une « action publique négociée » (Guy Groux), l’institutionnalisation du dialogue social sur l’emploi s’effectue à travers un cadrage négocié ciblant certaines catégories de personnel et portant essentiellement sur la qualité de l’emploi. Inscrivant de façon plus continue celle-ci à l’agenda, y compris hors période de crise, cette institutionnalisation se caractérise par une appropriation limitée des enjeux par les négociateurs en raison d’une délibération réduite par le formalisme des accords, tout en générant des attentes plus fortes. C’est pourquoi les sociologues Élodie Béthoux (ENS Paris-Saclay) et Arnaud Mias (Paris-Dauphine) se sont interrogés eux sur le contenu du dialogue social.
La comparaison des indicateurs composites de mesure du dialogue social entre les deux vagues 2004-2005 (avant crise) et 2010-2011 laisse apparaître une intensification du dialogue au cours de la période de crise. Ceci tient en partie aux procédures de décentralisation organisée de la négociation collective mais s’observe surtout là où le dialogue social préexiste : elle ne se traduit pas par une généralisation des pratiques de négociation à tous les établissements. Ainsi, observent-ils un accroissement des difficultés à mettre en débat la question de l’emploi qui conduit à un investissement croissant sur les enjeux liés aux conditions de travail. Cette relative impuissance contraste avec une implication routinière sur la formation qui s’avère peu stratégique.
La tendance des entreprises à privilégier les dispositifs individuels de sortie de l’emploi a pour conséquence un moindre recours aux plans de sauvegarde de l’emploi, induisant une diminution de l’emprise syndicale sur la question de l’emploi et un affaiblissement de l’encadrement collectif de ces dispositifs. Autre sujet de préoccupation, les mobilités internes apparaissent peu négociées, poussant à faire de la réorganisation du travail un enjeu pour combattre la déprise syndicale. La flexibilité et la sécurité s’inscrivent non seulement dans le cours des transitions professionnelles sur le marché du travail mais également au sein de l’organisation locale du travail. Les négociations débouchent souvent sur des concessions à la rhétorique gestionnaire, par exemple la négociation d’un investissement productif en échange de la révision de l’accord sur le temps de travail. Faute de pouvoir peser sur l’emploi, la négociation se reporte sur ceux qui restent avec une montée en puissance des problématiques de santé. Ainsi, les risques psychosociaux deviennent un chantier à investir. Malgré l’importance de la formation comme facteur de sécurisation des parcours, celle-ci est restée un enjeu assez peu mobilisé face aux conséquences économiques de la crise financière. C’est une thématique de négociation largement consensuelle, routinisée et qui s’avère peu présente dans les revendications.
1 : Pour un compte-rendu de la Journée FGA Cadres du 13 octobre 2016, cf. CFDT-Agro n°373, octobre 2016,.