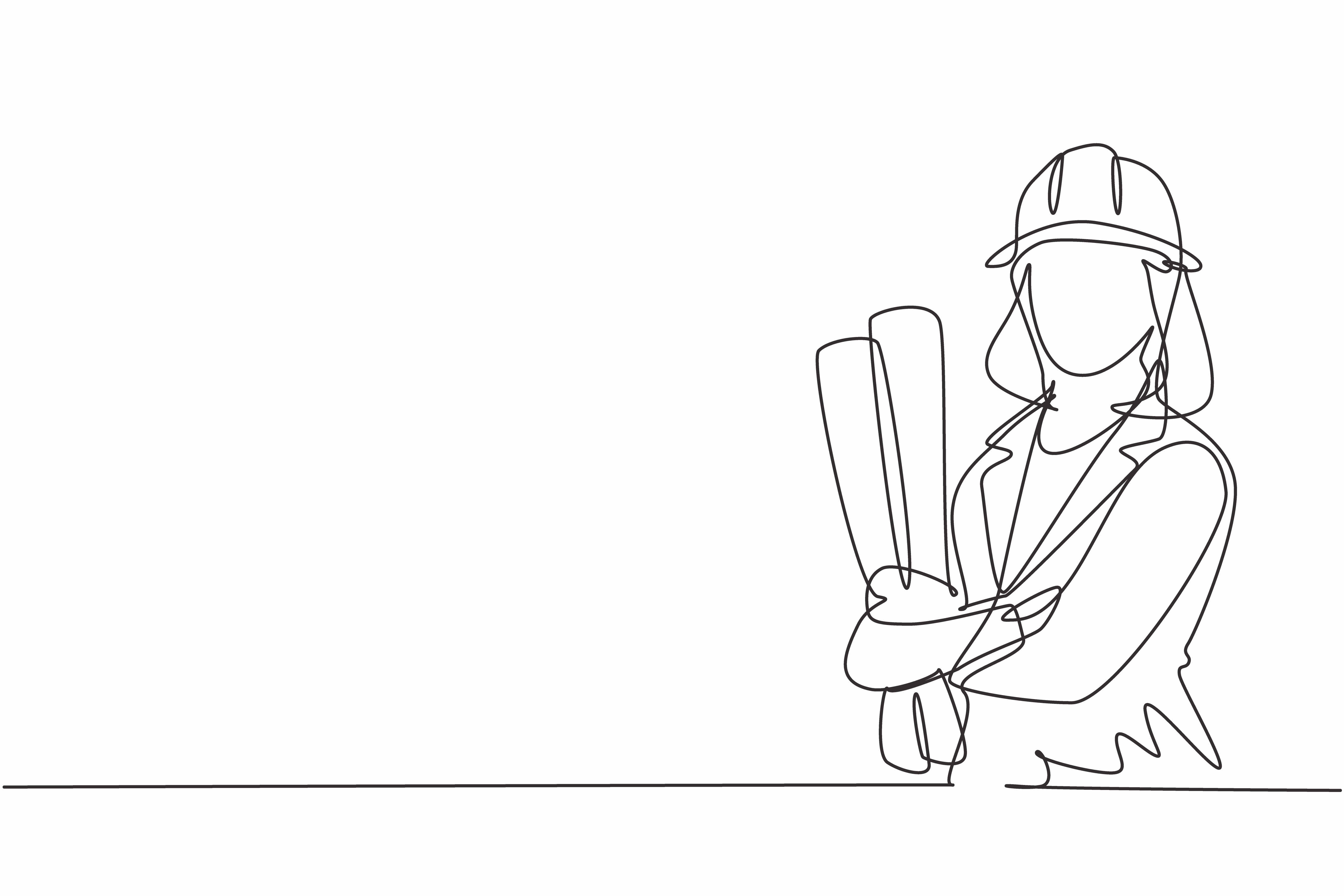En France, plus qu’ailleurs, on entrait dans une école d’ingénieur dont on sortait presque toujours diplômé si quelques critères étaient réunis : être un garçon avec une certaine appétence et des résultats suffisamment bons dans les disciplines scientifiques, l’absence d’une autre vocation forte et assez convaincante pour sa famille, et un milieu d’origine (enseignants et cadres plutôt scientifiques surtout). J’allais dire appétence pour les disciplines scientifiques et techniques, mais c’était surtout les sciences qui comptaient : la sélection scolaire vers les formations d’ingénieur se faisait – et se fait toujours – sur les mathématiques et la physique-chimie, éventuellement les sciences de la vie pour la filière dite bio (même si les « sup bio » n’avaient pas grand-chose à voir avec l’agriculture biologique). Elle ne reposait pas sur l’intérêt et les compétences en matière de technologie, sans doute un peu plus aujourd’hui avec le numérique. Elle ne reposait pas sur le désir de travailler dans les grandes entreprises privées où la majorité se ferait embaucher à la sortie. J’ai quitté l’INPG en octobre 1989 sans diplôme après une première année passée dans des amphis souvent très clairsemés, un stage ouvrier chez Pechiney et un début de seconde année. Je me posais trop de questions. J’ai pris conscience plus tard que ce que j’avais fait était rare à l’époque : quitter une école intégrée sur concours, bifurquer ou déserter, dirait-on aujourd’hui. Vingt ans avant moi, le chanteur Antoine avait opté pour la carrière musicale qu’il avait entamée avant la fin de ses études. Fils d’ingénieur, il était quand même allé jusqu’au diplôme : chanteur mais centralien quand même. Mes questions d’alors semblent traverser l’esprit de beaucoup de jeunes aujourd’hui, ces jeunes qui ont réussi – après deux ou trois ans de sacrifice – à « intégrer » une école : devenir ingénieur pour qui et pour