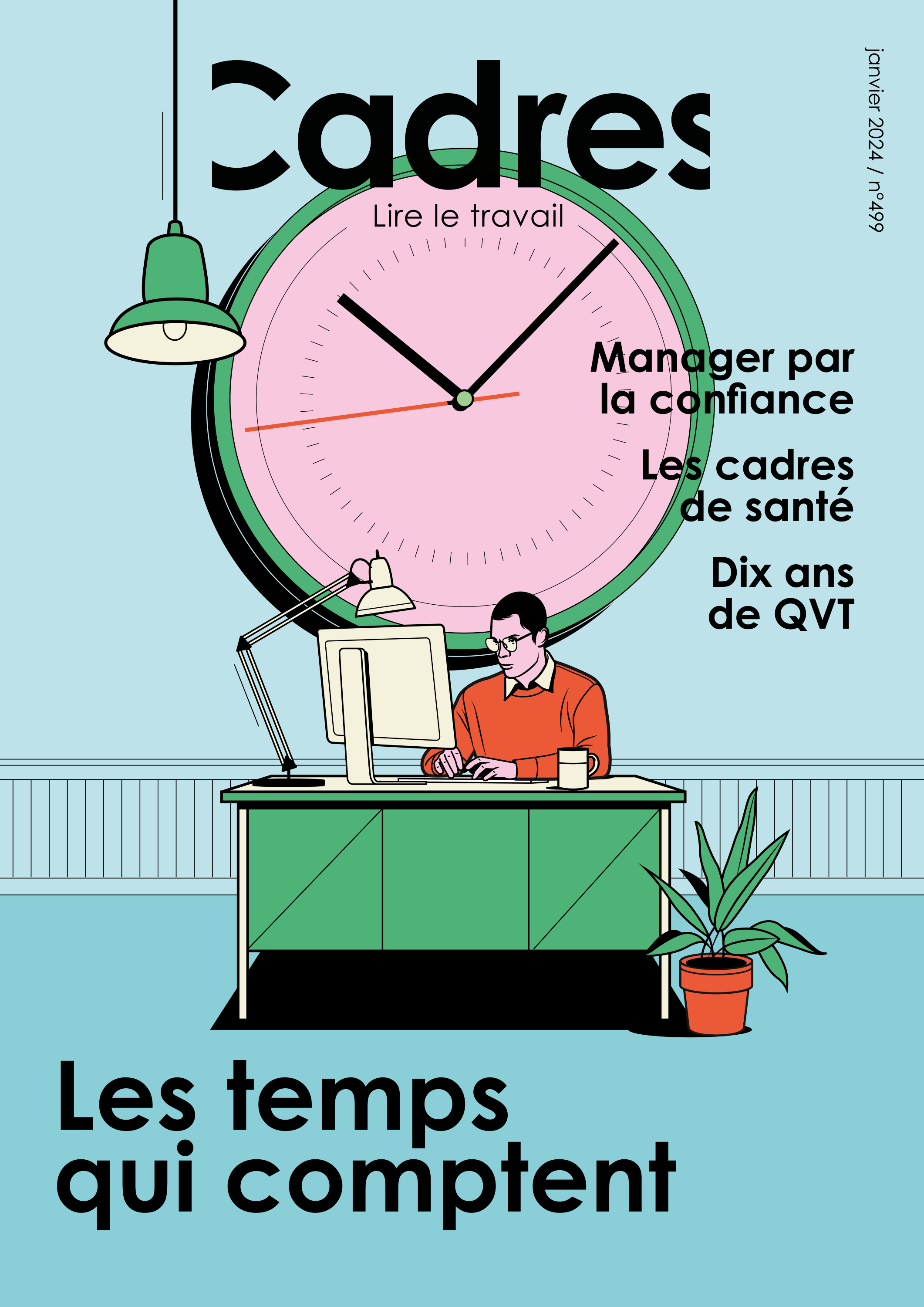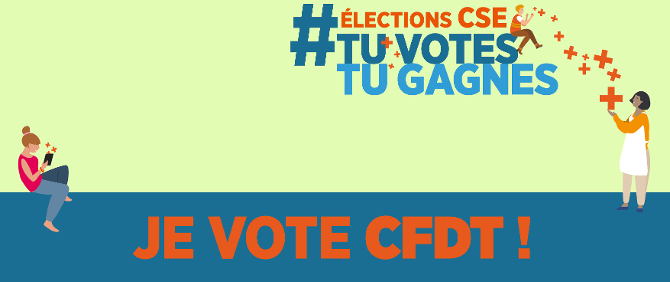La déontologie peut se définir comme l’ensemble des règles régissant une profession et la conduite de ceux qui l’exercent. Elle est fondée sur des droits et obligations préalablement et juridiquement définis. En quelques années, sous l’effet conjugué d’une opinion publique de plus en plus critique et exigeante à l’égard de la sphère publique ou politique et d’un législateur souhaitant la conforter par l’édiction de règles et principes, la déontologie est incontestablement devenue un marqueur de la Fonction publique. Elle concerne indistinctement les fonctionnaires, élèves fonctionnaires, stagiaires et contractuels qui exercent des missions de service public. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires marque une étape importante pour l’affirmation de principes et obligations déontologiques gouvernant le droit de la Fonction publique.
Selon l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifié et désormais codifié à l’article L 121-1 du Code Général de la Fonction publique (CGFP), le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à une obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité (art L 121-2 du CGFP). Invariablement opposable aux fonctionnaires comme aux contractuels, la loi du 20 avril 2016 fait des principes déontologiques (dignité, impartialité, probité et intégrité, obligation de neutralité) les valeurs premières du fonctionnaire auxquelles il ne saurait se soustraire. Sans prétendre à l’exhaustivité, les obligations d’impartialité et de probité, comme celle de neutralité méritent une attention particulière. Le droit de la Fonction publique s’est pour ce faire doter de référent en la matière.
-
L’obligation de prévenir les conflits d’intérêts
Selon l’article L 121-5 du CGFP, constitue un conflit d’intérêts, toute situation d’i