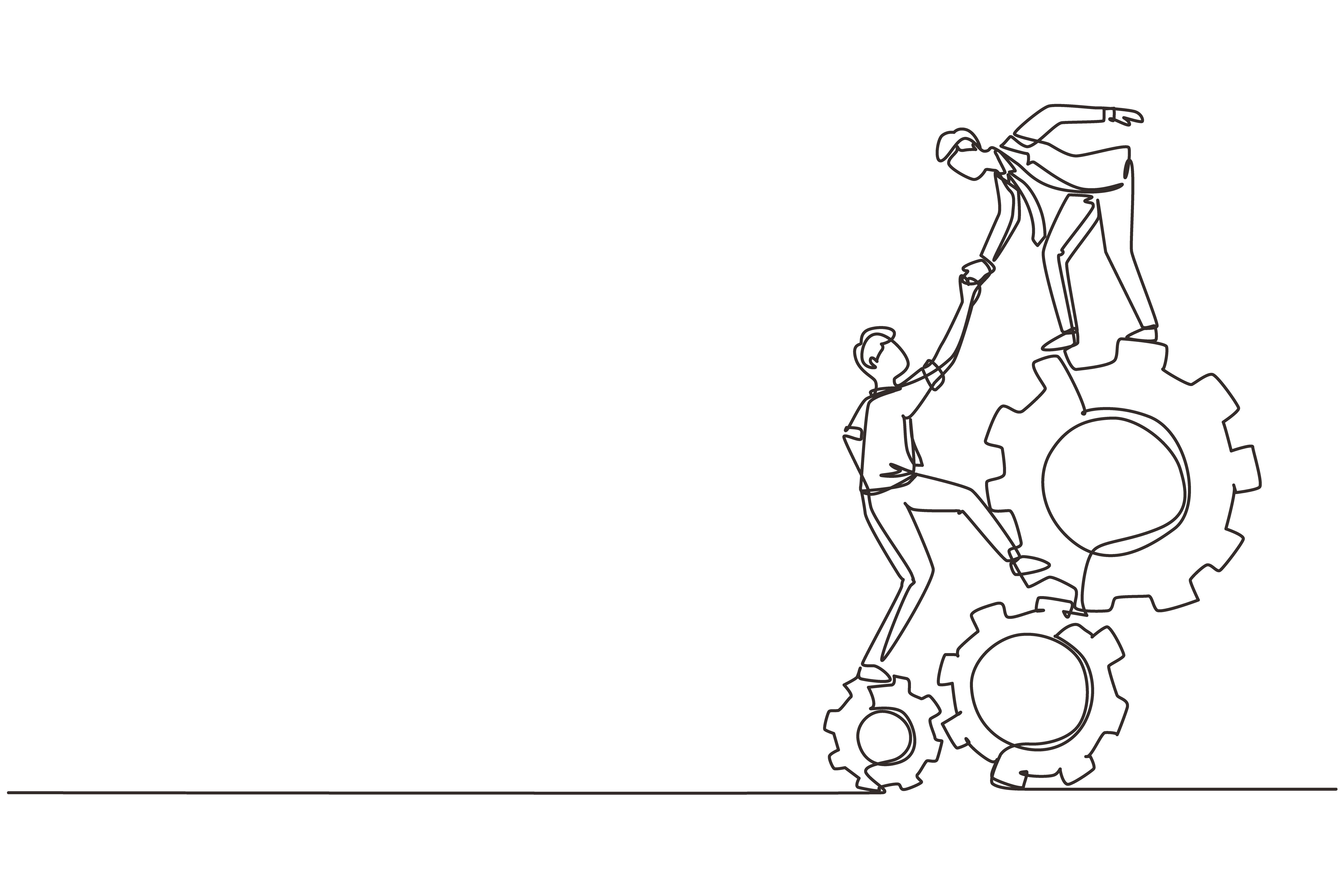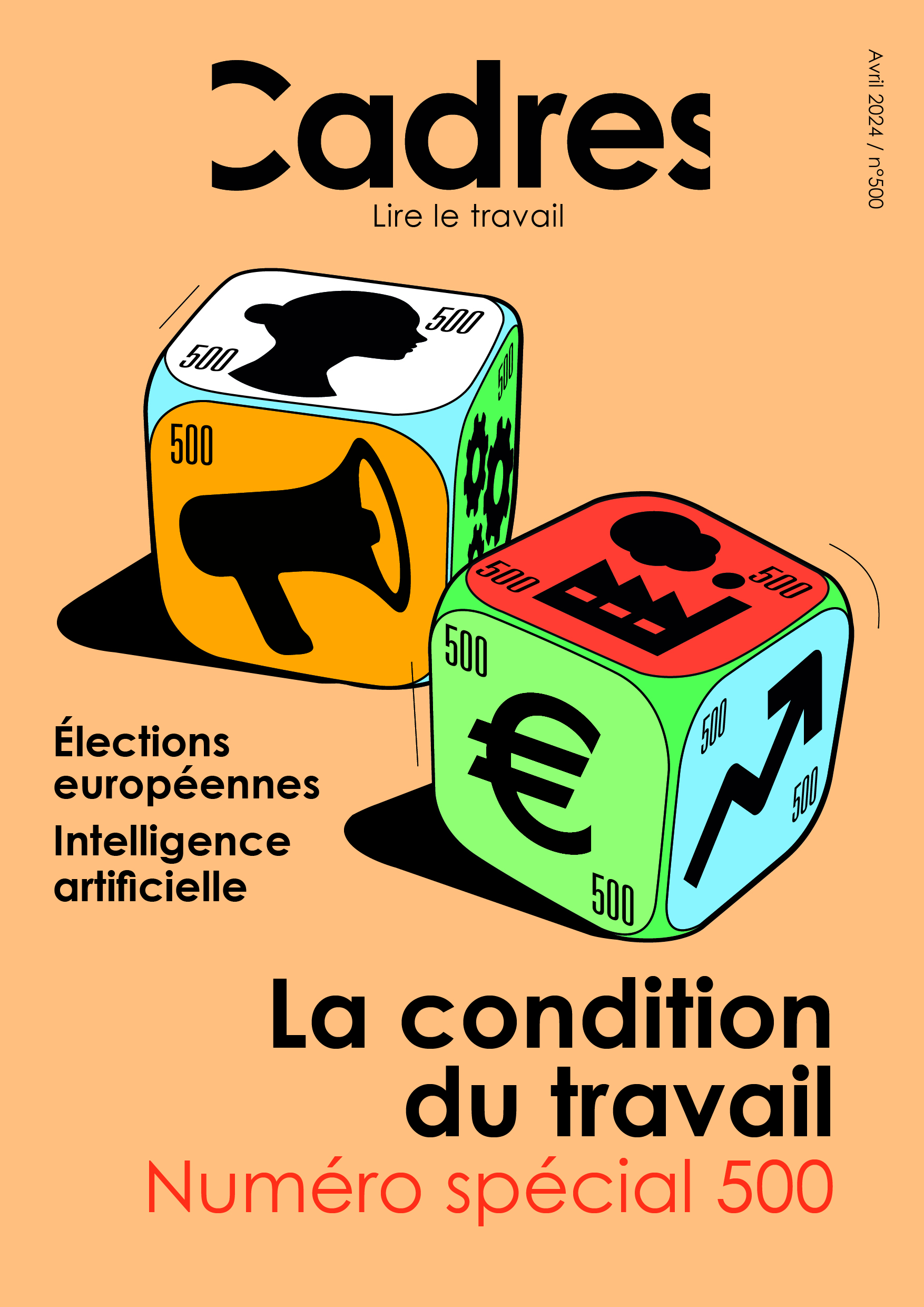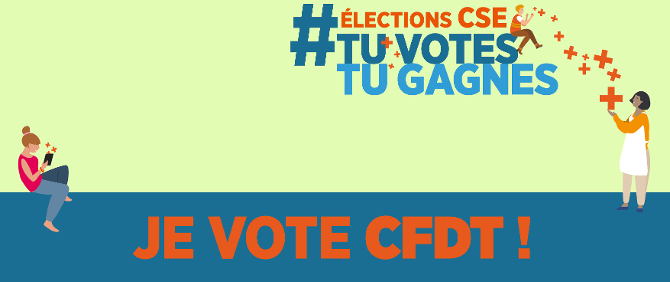Voici que le statut CDI ne ferait plus rêver, que le télétravail, imposé durant le confinement, se serait converti en avantage social, que l’expérience professionnelle serait disqualifiée au profit de l’agilité, que les indicateurs de gestion seraient devenus la seule mesure du travail réalisé et que le travail ne serait plus aussi central dans nos vies et comme condition d’intégration sociale.
Nous serions entrés dans une ère agitée, brouillant nos repères, dévoilant le foisonnement de situations contrastées, sans pouvoir en dégager quelques lignes directrices. Le travail vacillerait sur le trépied qui l’avait constitué comme institution depuis plus d’un siècle et demi. De ce rapport au temps, à un lieu et à une action, le travail donnerait à voir des échappées invitant à mieux les cerner pour recréer des repères intégrateurs.
Ces bouleversements et altérations de notre rapport au travail incitent à une certaine prudence lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la « condition du travail ». La tentation reste forte de céder aux modes, croyances et représentations managériales, ou aux catégorisations rapides qui embarquent peu le réel du travail. En effet, en dépit d’un foisonnement de travaux et savoirs en sciences sociales, le travail reste un grand impensé dans les organisations, appréhendé en extériorité par rapport à ceux qui le font.
Cet écart est le premier constat de mon expérience de sociologue-intervenante dans les mondes du travail. Il nourrit une pratique de la sociologie visant à favoriser des circulations entre le vécu des acteurs et les savoirs sociologiques, l’appropriation d’une lecture systémique sur le travail et des traductions venant équiper les acteurs pour agir. De ma trajectoire de sociologue au carrefour de la recherche, de la formation et de l’intervention, je retiens deux préceptes, enseignés par Renaud Sainsaulieu, qui m’a donné le goût de ce métier :
« Aller voir de près de quoi il en r