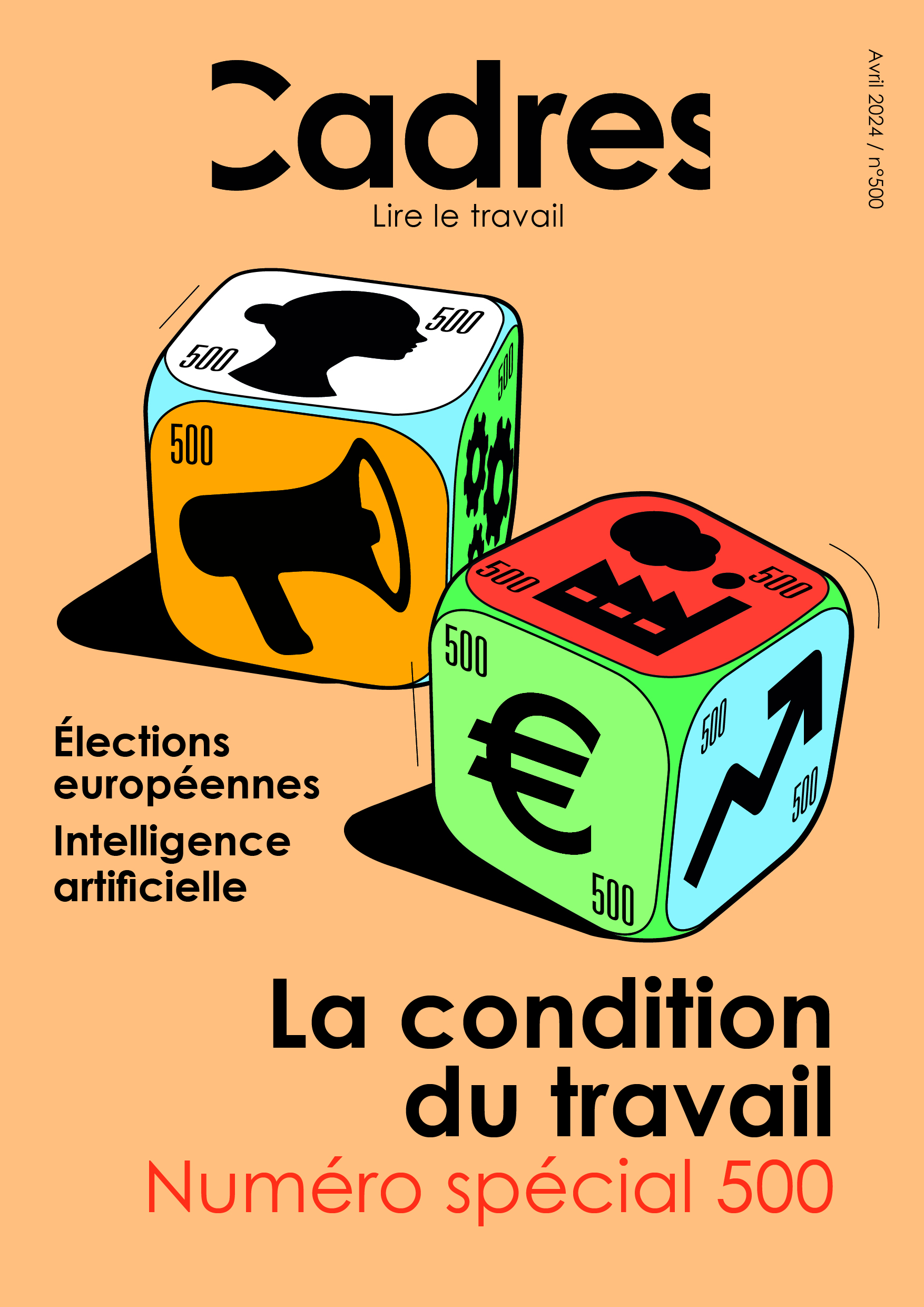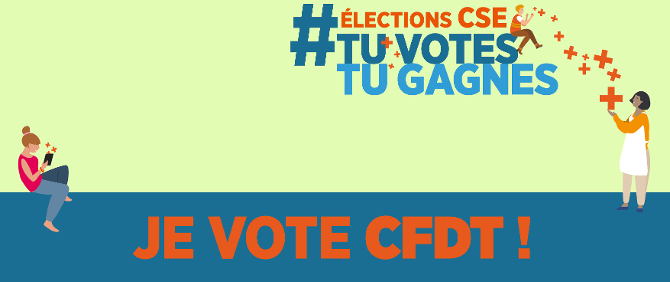S’éloigner des instances formelles de dialogue social a permis de découvrir l’existence d’un autre dialogue que nous avons choisi d’appeler un dialogue polyphonique, c’est-à-dire qui est basé sur la pluralité des points de vue et se vit comme un processus en soi, sans visée conclusive ou négociatrice.
Un dialogue quotidien, source de soutien de l’activité managériale
Dans cet environnement industriel, les managers intermédiaires occupent une place importante et avec de forts enjeux. Ils managent jusqu’à 200 personnes, qui sont des ouvriers qualifiés intervenant sur une activité de production. Les équipes tournent jour et nuit, le travail doit répondre à des normes de qualité extrêmement exigeantes et une erreur peut coûter une vie. Les managers intermédiaires ont une très grande responsabilité. Leur journée commence souvent avant 6 h pour se terminer parfois après 19 h. Ils assurent l’accueil des équipes du matin, puis du soir. Ils veillent sur leurs équipes avec attention, car les retards ou l’inattention d’un ouvrier qui serait distrait par un souci coûtent cher.
Dans un tel contexte, nous nous sommes demandé si le fait que les équipes soient fortement syndiquées et que, par conséquent, les représentants du personnel puissent intervenir régulièrement auprès du manager était de nature à gêner le travail managérial. En interrogeant plus d’une trentaine de ces managers, il est apparu qu’en réalité, ces derniers ne cherchaient pas à éviter ces moments d’échange : au contraire, ils les sollicitaient. Toutes les semaines, chaque manager propose un rendez-vous à ses interlocuteurs syndicaux. Ces rencontres deviennent ritualisées : le lundi matin, autour d’un café par exemple. Elles demeurent informelles et aussi un peu secrètes : les managers ne parlent jamais entre eux de ces rencontres avec les représentants du personnel.
À la question : « De quoi parlez-vous ? », les managers nous ont r