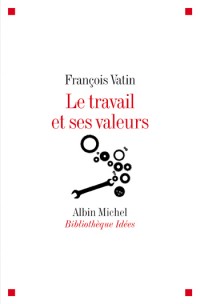Dominique Méda avait lancé il y a une dizaine d’années le thème de la « valeur travail », que les politiques de droite et de gauche se sont approprié en le détournant de son sens originel. Un débat s’est ensuivi, qui dure encore. Professeur de sociologie à l’université Paris X, François Vatin revient aujourd’hui sur la question avec un ouvrage qui constitue une salutaire prise de champ par rapport aux représentations qui informent aujourd’hui ce débat.
L’auteur repère dans les discours contemporains des schémas archaïques reconfigurés, mais aussi préservés, par les formulations modernes du rapport au travail nées dans le sillage de la pensée économique, en particulier les travaux d’Adam Smith et de Karl Marx, et des visions techniciennes qui ont culminé avec le taylorisme. La sociologie du travail, affirmant avec Durkheim la valeur centrale du travail et refusant de le réduire à une simple modalité de la dépense énergétique, est elle-même prisonnière d’un ensemble de représentations qui ont occulté une partie de la réalité du travail et qui sont aujourd’hui de moins en moins opérantes. Les politiques publiques inspirées de ces représentations, des 35 heures de Lionel Jospin au programme de Nicolas Sarkozy, sont bien en peine de répondre à un malaise dont l’origine tient sans doute à la mise en œuvre de ces mêmes représentations, dans les organisations de travail mais aussi dans ce que Castoriadis nommait les « institutions imaginaires de la société ».
Une citation du Catéchisme de morale pour l’éducation de la jeunesse (1791) permet d’introduire le thème de la « religion du travail », par laquelle se refondent, à l’aube de la révolution industrielle, des sociétés en voie de sécularisation. Le labeur humain n’est plus alors donné comme le signe de la malédiction originelle, mais comme l’enjeu d’un échange entre l’individu et la société. Cet échange devient l’alpha et l’oméga du lien social : puisque chacun bénéficie des avantages procurés par la vie en société, il est juste qu’il offre de son côté une contribution : « sans cela il fait un vol manifeste à la société en jouissant de tous ses avantages sans mettre du sien. » Smith, Ricardo puis Marx s’inscrivent dans le droit fil de cette vision en faisant du travail et des échanges productifs la clé de l’ordre social. C’est ainsi, dans un mouvement global dont les œuvres de ces auteurs sont à la fois des symptômes et des accélérateurs, que le travail est promu au rang de fondement de l’identité sociale et morale des individus.
En repérant dans cette idée communément partagée un « artefact », une construction idéologique, François Vatin appelle à renouveler le regard sur le travail. En effet, cette vision unificatrice masque une réalité beaucoup plus émiettée, caractérisée par la pluralité des modalités d’appréhension du travail. Celui-ci est représentable comme un acte technique, inscrit dans un système de valorisation économique et dans une organisation sociale. Autant de niveaux de lecture qui diffractent l’expérience de travail et interdisent de la réduire à l’illusion d’une valeur partagée telle que la dessinent les politiques, valeur qui permettrait d’en faire un référent commun et donc le fondement d’un projet politique.
François Vatin regrette en particulier que la conception sociologique du travail comme facteur d’intégration sociale ait laissé de côté la dimension matérielle et technique du travail, qui n’est pas seulement un rapport à la société mais aussi à la nature. C’est ainsi l’idée même d’une production qui se trouve ainsi éclipsée. Or le travail est d’abord cela : un acte, une intervention sur la matière, sur la nature. Mais la sociologie du travail, à l’aube du XXe siècle, naît dans le sillage d’une révolution industrielle qui a conduit à faire appauvrir les représentations du travail humain, effaçant doucement les identités de métier mais aussi l’enjeu de transformation du monde, d’intervention sur l’environnement, qui fonde l’acte de travail. Les ingénieurs du XIXe siècle développent une pensée fondée sur le modèle de la thermodynamique, où le travail n’est plus qu’une des formes de l’énergie : la réflexion se centre sur la seule dépense du travail, appréhendée et mesurée par la fatigue. Cette pensée croise celle des économistes en faisant du travail non plus un acte, unique, signifiant, inscrit dans une histoire, mais une donnée plus neutre, manipulable et échangeable à loisir. Cette neutralisation est précisément ce qui permet aux premiers sociologues d’en faire un objet d’échange et donc de lui conférer une place centrale dans la représentation du fonctionnement des sociétés humaines.
Parallèlement, les biologistes de l’époque mettent en valeur le concept d’efficience et développent une pensée organiciste des sociétés, assimilées à des êtres vivants. Une telle pensée existe depuis l’Antiquité mais se reformule au xixe siècle au prisme du travail, avec le modèle des abeilles par exemple. Différents débats opposent alors les tenants d’une vision organiciste pure – conservatrice – et ceux qui, tout en se référant au modèle animal, préfèrent y voir une logique de solidarité.
La sociologie naissante, au début du XXe siècle, hérite de ces différentes lignes de lecture qui ont en commun de gommer une bonne partie de la réalité du travail : soit qu’elles survalorisent sa valeur d’échange et donc sa fonction sociale (c’est le cas des pensées économistes et des modèles biologiques), soit qu’elles modélisent sa matérialité en négligeant tout ce qui ne rentre pas dans le modèle de la dépense énergétique (c’est ce que font les ingénieurs, avec comme horizon l’organisation scientifique du travail, mais aussi aujourd’hui le règne des indicateurs).
En somme, les pensées qui se déploient autour du travail occultent une partie de ses enjeux et de ses réalités, contribuant ainsi à faire croître un malaise, à la fois quant à la place problématique du travail comme centre de l’existence sociale, et quant à la représentation hasardeuse de ce qui constitue l’activité de chacun.
De ce malaise, la question des rémunérations est aujourd’hui un symptôme fort : si le travail définit notre rôle social et si la rémunération est le principal signe de valorisation du travail, alors qui peut se sentir à l’aise dans la société d’aujourd’hui, avec ses écarts vertigineux de rémunération ?
Le thème de la « valeur travail », ainsi mis en perspective, se retrouve au centre d’un paradoxe : il répond au malaise mais l’entretient. Il trouve son succès dans le sentiment donné aux travailleurs d’une meilleure valorisation et d’une meilleure représentation de ce qu’ils font, mais c’est précisément l’association entre travail et valeur sociale, réaffirmée avec le modèle de la valeur travail, qui nourrit le malaise.
En outre, l’idée de la valeur travail est inscrite dans un long mouvement d’occultation de la réalité du travail, qui contribue lui aussi au malaise en empêchant de représenter correctement l’expérience de chacun. Les évolutions récentes des organisations productives ne font qu’accélérer ce mouvement, avec l’automation et l’effacement des interventions humaines dans la chaîne de production. Le travail se concentre en amont et en aval, il devient « immatériel » et peut se réfugier dans des fonctions de contrôle ou simplement d’astreinte, où la seule ressource mobilisée est la disponibilité du travailleur. Ce n’est plus alors en termes d’effort qu’on peut penser, vivre, représenter le travail. Le travailleur, pour autant, ne vend pas seulement son temps. Que fait-il exactement ? Quelles sont les ressources mobilisées, quelle valeur attribuer à ces ressources, quelle place attribuer à cette expérience dans la vie sociale ? Autant de questions dont les réponses sont aujourd’hui incertaines et ne trouvent plus de réponses évidentes.
L’expérience du travail contemporain fait ainsi voler en éclats les modèles de représentation appauvris qui s’étaient imposés pour le représenter depuis la révolution industrielle. Nul doute que le malaise ressenti aujourd’hui dans les organisations de travail n’ait à voir avec cette question d’un défaut de représentation, aussi bien chez ceux qui prescrivent et contrôlent le travail que dans le monde académique et surtout chez ceux qui le vivent.
Enfin, faire du travail la clé de l’identité sociale pose un vrai problème quand le travail intégrateur est devenu un facteur de désintégration et que le chômage de masse, puis la précarité, reconfigurent profondément le rapport au travail d’une part considérable de la population.
À quoi s’ajoute que les politiques mises en place par la gauche comme la droite depuis les années 1990 sont des politiques de l’emploi, qui gomment elles aussi la notion de travail, raisonnent d’une façon quantitative, continuant à représenter le travail comme une grandeur qu’il serait possible de répartir, d’accroître, de diviser, et s’évertuent à remettre le travail au centre du social quand cette position n’est peut-être qu’un moment historique désormais achevé. On pense ici aux travaux de Robert Castel sur le salariat (Les métamorphoses de la question sociale, Gallimard, 1995), qui suggèrent la même conclusion. Si le travail, comme le salariat qui en est la forme juridique moderne, n’est pas le cœur du social, si les valeurs qu’on lui a reconnues depuis deux siècles sont à ce point biaisées, alors comment représenter le lien social ?
L’archéologie des valeurs du travail que tente ici François Vatin éclaire ainsi les limites des représentations historiques qui continuent à informer le débat public et les politiques. Elle ouvre des horizons, tant pour ceux qui s’intéressent au travail que pour la société au sens large, sommée de trouver de nouvelles institutions imaginaires.