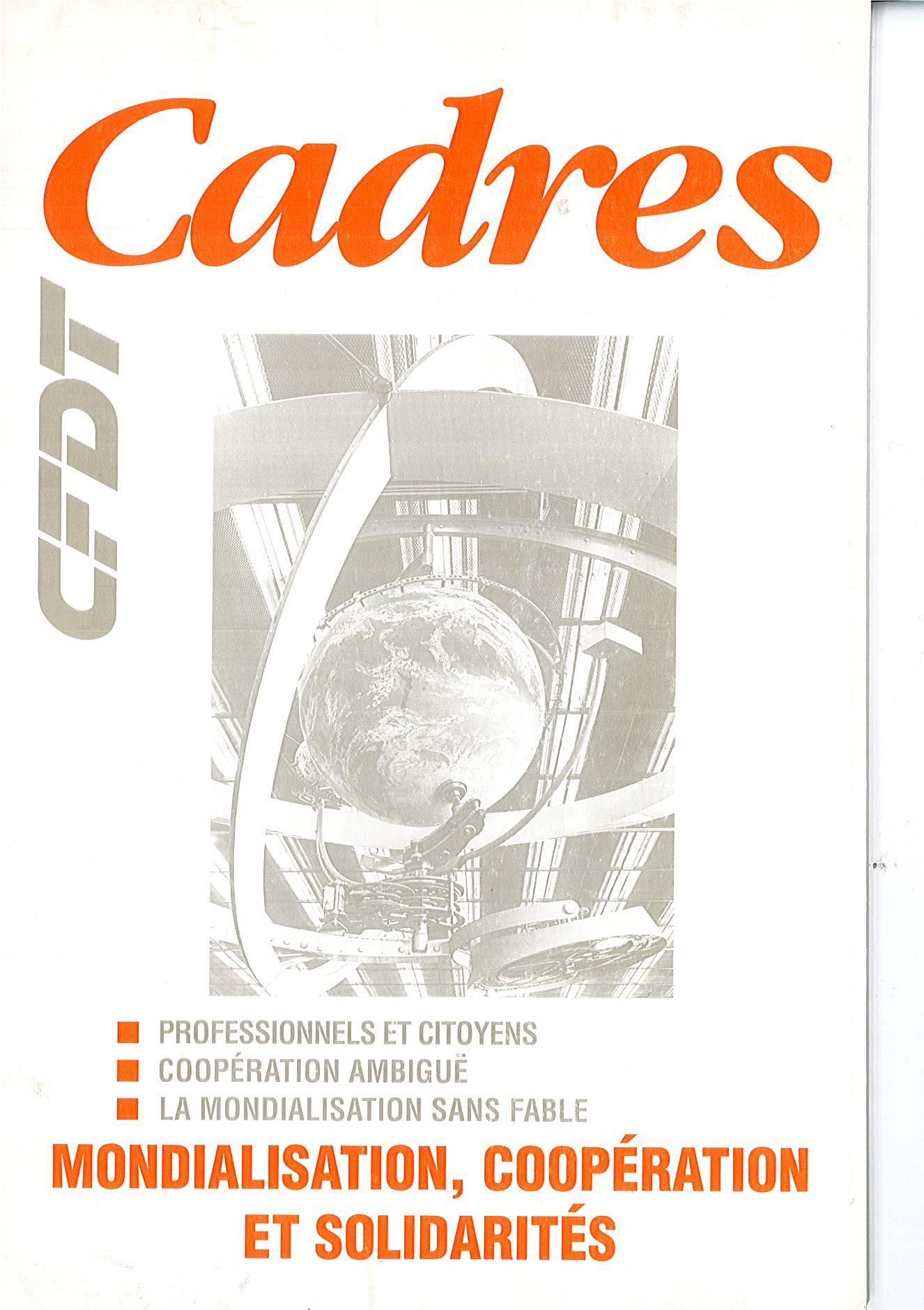Vous avez rédigé un rapport sur la coopération française à la demande de Michel Rocard qui a été « enterré » par l’Elysée, dans lequel vous critiquiez notamment la dispersion des centres de décisions. Cette analyse est-elle toujours valable aujourd’hui où on constate la diminution de la part du ministère de la Coopération dans l’aide publique au développement et une augmentation des crédits gérés par le Trésor ?
L’essentiel de nos réflexions et critiques de 1988-1990 reste valable. Je dis « nos » car ce rapport était une œuvre collective à laquelle ont pris part des personnes du Trésor, de la DREE, du ministère de la Coopération et du ministère des Affaires Étrangères. Notre principale objection portait sur la distinction radicale entre « champ » et « hors champ », avec un « champ » composé de l’Afrique francophone et lusophone où la France prenait des responsabilités non seulement culturelles et économiques mais aussi politiques. Cette attitude présente de graves dangers. Le soutien presque sans conditions à des chefs d’État sous prétexte qu’ils sont les « amis de la France » constitue le reliquat d’une attitude néo-colonialiste. Il est plus que temps de tourner cette page et de traiter ces pays indépendants avec le respect qu’ils méritent et de soutenir une évolution politique que réclament les populations. La coopération militaire, qui sert surtout à la sécurité de régimes pas toujours démocratiques, n’a pas évolué beaucoup. Ce qui a changé, c’est que l’aide de la France se porte de plus en plus sur les pays émergents, ce qui restreint la part du ministère de la Coopération. Une évolution positive est la mise à disposition de crédits plus nombreux pour la coopération décentralisée, celle des collectivités territoriales ou des ONG, mais il faudrait aller plus loin. Au total, je dirais que la France devrait avoir aujourd’hu