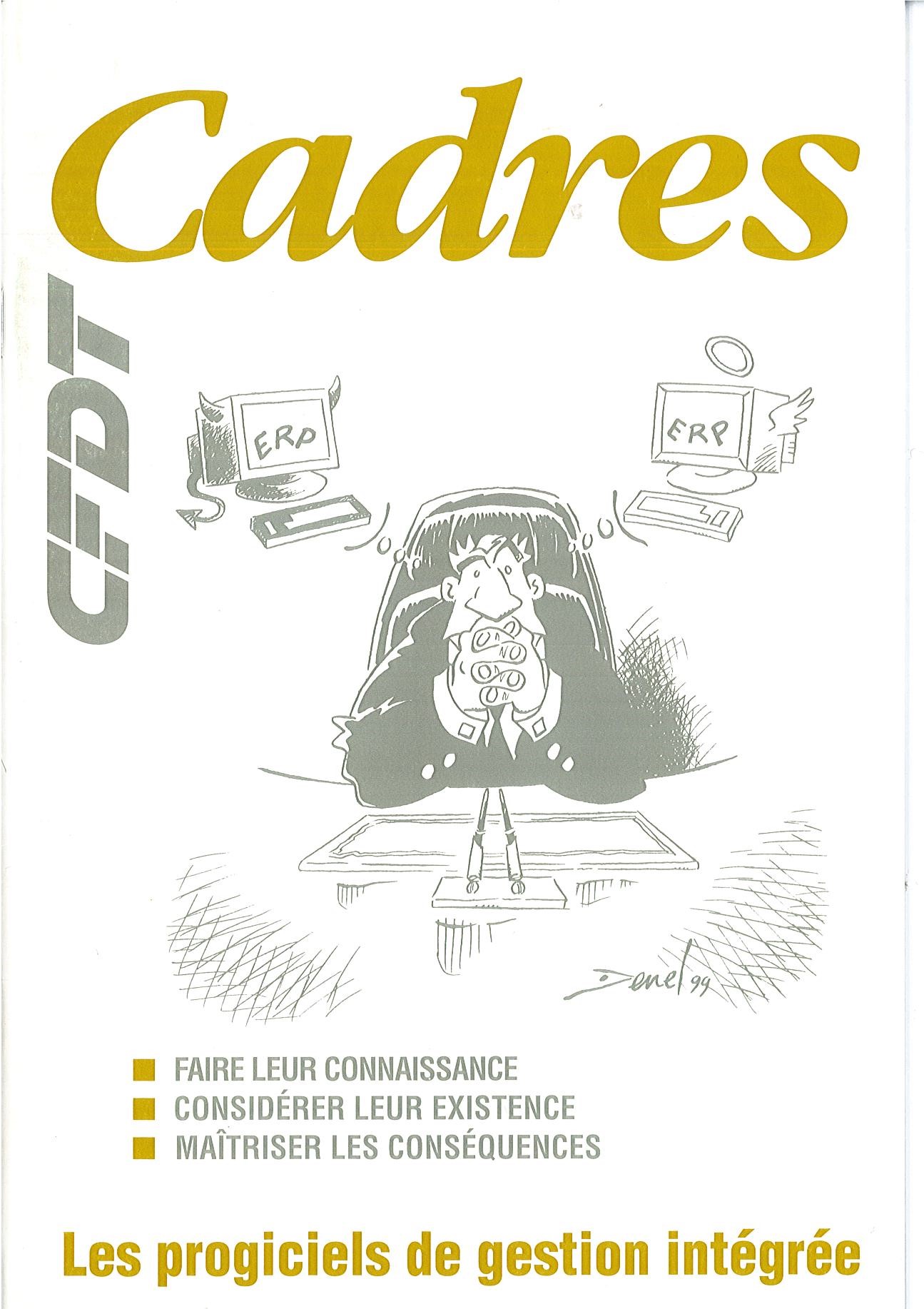Les performances économiques d’un pays sont liées à sa culture, il est vain d’essayer de transposer un modèle mais il est fécond d’analyser comment il fonctionne pour y trouver des idées : la thèse n’est pas originale mais elle est vraie.
L’économie est faite de cycles liés à l’innovation technologique, comportant chacun une phase de démarrage, puis une phase de croissance, une phase d’optimisation et enfin une phase de déclin. On aura reconnu Kondratieff et Schumpeter. Après les cycles de la machine à vapeur (démarrage vers 1780-1790), de la sidérurgie, du textile et du charbon (démarrage vers 1830-40), de l’automobile, de l’aviation et de l’électricité (démarrage vers 1890), de l’atome, du téléphone, de l’aéronautique et de la chimie (démarrage dans la fin des années trente), nous serions aujourd’hui au moment du début d’une cinquième vague, celle du génie génétique et des biotechnologies d’une part, des réseaux et de l’économie fondée sur les connaissances d’autre part. La thèse n’est pas originale mais elle est vraie.
Il n’y a pour Stratorg (le cabinet de consultants des auteurs) que quatre formes fondamentales d’organisation : le « modèle originel » , « conçu pour innover » , c’est celui de l’entreprise qui démarre (la fameuse «start-up ») ; le « modèle rationnel», «pensé pour la productivité », auquel appartiennent la plupart des entreprises françaises mais aussi McDonald, l’industrie et les services taylorisés ; le « modèle contractuel » qui est « doué pour la croissance » (IBM, BSN, ABB, Rhône Poulenc ou Bouygues); enfin le « modèle spirituel » qui est « obsédé par l’optimisation » et caractérisé par la communication, dont les entreprises japonaises sont le meilleur exemple. La thèse n’est pas entièrement originale mais elle présente de façon systémique ce que l’on a pu lire ailleurs en plus dispersé.
Les différentes sortes d’entreprise sont plus ou moins bien adaptées aux différentes phases du cycle macro-économique : la phase de rupture est le moment de prédilection du modèle originel, les entreprises organisées en mode contractuel sont particulièrement adaptées aux nécessités stratégiques de la phase de croissance, mais pendant la phase d’optimisation, le modèle spirituel est le mieux placé pour réussir, alors que pendant la période de déclin, le modèle rationnel est le seul efficace. C’est dans cette liaison entre cycle macro et organisation micro que réside l’originalité de l’ouvrage, la valeur ajoutée apportée à la connaissance économico-managériale par les auteurs.
Suit ensuite une analyse sociologique de la France qui n’est pas sans intérêt (on ne redira jamais assez la frilosité des banques envers les entreprises débutantes, la paperasserie paralysante ni la vision étroitement patrimoniale de l’entreprise des patrons de PME) ni sans préjugés (il nous semble par exemple que la loi des 35 heures aurait mérité plus qu’une mise à mort en trois phrases).
Le passage sur la « créativité dans les jardins à la française » où les auteurs montrent comment de grandes organisations publiques (CNRS, INSERM, INRA...) ou des groupes industriels (Thomson, Elf Aquitaine, Péchiney, France Télécom) ont « joué les incubateurs pour quelques unes des plus belles start-up des vingt dernières années » est lui aussi un moment de valeur. Et, fort logiquement, les auteurs préconisent de tenir compte des réalités, y compris sociologiques (la peur du risque et le besoin de sécurité des Français qui les poussent à chercher un statut ainsi que la stigmatisation sociale de l’échec) pour aider à la naissance de nouvelles entreprises. «Ce modèle d’entrepreneuriat interne, aux résultats incontestables, semble mieux adapté culturellement à notre pays que les dispositifs à l’anglo-saxonne. Dès lors, pourquoi ne pas s’en inspirer pour mettre en place dans les grandes sociétés des dispositifs destinés à soutenir les innovations et les innovateurs dont les activités restent sous-développées parce que trop éloignées des coeurs de métier ? Plutôt que de couvrir le territoire de pépinières, de technopoles ou de guichets d’accueil pour entrepreneurs-fantômes, pourquoi ne pas aller chercher les créateurs potentiels là où ils sont ? Cette idée simple présente le double mérite de partir de l’organisation réelle - et non du modèle idéal - et d’être compatible avec le capitalisme à la française dans ses caractéristiques actuelles».
La conclusion appelle à un projet commun. «Or l’éradication du chômage, mise en exergue par tous les partis républicains, n’est pas un projet collectif. Il n’est qu’une condition minimale, nécessaire pour éviter la déliaison définitive de la société. La baisse des prélèvements obligatoires, le nécessaire recul de l’Etat, autre leitmotivdes politiques, sur lequel nous nous sommes largement étendus, n’est pas un projet de société non plus : il s’agit d’un minimum vital qui conditionne la survie du système. Le seul projet possible, ou plutôt les seuls projets possibles, ne sont pas d’ordre économique. Les Français ne se battront jamais pour un taux de croissance, pour des fonds de pension, ou pour une place d’honneur dans le palmarès des nations industrielles. Mais ils sont capables de se remettre en route, de sortir de leurs dogmes ringards pour sauver leurs valeurs, en leur inventant de nouvelles applications. Le défi auquel est confronté la France est bien un défi politique. Ce n’est pas le moindre des paradoxes, pour un essai d’économie, que d’en arriver à cette conclusion». La fin de l’ouvrage donne l’impression d’avoir été écrite un peu rapidement. Ne pas céder au « yaka fauquon » ne dispense pas les essayistes de faire un peu plus de préconisations concrètes.
En résumé l’ouvrage ne manque pas d’intérêt mais laisse un goût d’inachevé.