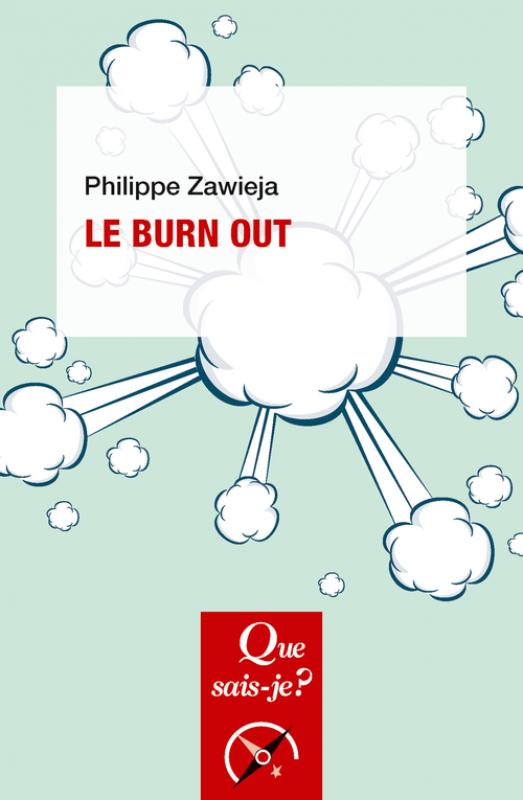La crise économique et sociale qui se profile va vraisemblablement se traduire par des recompositions d’ampleur sur le marché du travail, et obliger des personnes ayant perdu leur emploi (cadres ou non-cadres) à se repositionner, voire à se reclasser (dans un autre secteur d’activité et/ou métier). On peut dès aujourd’hui réfléchir au type de dispositif à mettre en œuvre pour accompagner les salariés victimes de la crise, étant entendu que l’un des enjeux de cet accompagnement réside dans la reconnaissance du travail réel et des compétences acquises en situation de travail par ces salariés. Ce n’est en effet qu’à cette condition que les personnes pourront prendre conscience du potentiel qui est le leur et élaborer un projet professionnel, en vue de rebondir. L’affaire paraît entendue, d’autant plus qu’il existe aujourd’hui des dispositifs qui permettent d’accompagner les personnes en transition professionnelle, et qui, de surcroît, ont fait leur preuve ; citons par exemple les bilans de compétences ou encore la validation des acquis de l’expérience (VAE). Pour autant, ces dispositifs permettent-ils réellement de reconnaître pleinement le travail réel et les compétences acquises via l’expérience professionnelle ? On peut en douter fortement, si l’on se réfère à la psychodynamique du travail et, en particulier, aux travaux de Christophe Dejours sur l’évaluation du travail. Par ailleurs, la réponse à cette question dépend de ce que l’on met derrière les termes utilisés, le travail réel et les compétences étant aussi des concepts qui sont discutés dans la communauté académique.
Le point de vue de Dejours sur cette question est intéressant parce que radical. Que dit-il au juste ? Selon lui, « Les bilans de compétences, le portefeuille de compétences, toutes ces notions reposent sur l’hypothèse selon laquelle il serait possible d’identifier les compétences isolément ou à distance du travail [réel]. De fait, l’évaluation des compétences dérive inévitablement vers l’évaluation de la personne, et s’éloigne d’autant de l’évaluation du travail proprement dit. Or l’analyse clinique du travail montre qu’on ne peut pas définir, caractériser, saisir et a fortiori évaluer, une compétence sans en passer par la connaissance fine du travail dans lequel elle s’actualise » (Dejours, 2003, p. 36). Autrement dit, on ne peut pas reconnaître les compétences acquises par les salariés en situation de travail, si l’on ne se donne pas au préalable les moyens d’analyser le travail réel. Il réédite et précise sa critique quelques années plus tard quand il écrit que « La performance est première, la compétence est seconde. C’est pourquoi toute la psychologie qu’on développe depuis une vingtaine d’années sur les bilans de compétences est théoriquement fausse. Le portefeuille de compétences ne permet pas de prédire si un technicien compétent sera capable de faire un bon technicien dans une situation nouvelle. Par exemple, d’un chirurgien jugé très compétent en France, on ne peut absolument pas prévoir s’il sera un bon chirurgien en Afrique dans un hôpital mal équipé. Il peut au contraire se révéler contre-productif et gêner le travail des autres. S’il réussit à être performant en Afrique, alors seulement, dans l’après-coup, on pourra dire qu’il possède une compétence dans la médecine humanitaire. Pas avant, jamais ! Chaque compétence est indissociablement liée au contexte de son effectuation. Les compétences ne sont pas régulièrement transposables d’un contexte à un autre » (Dejours, 2013a, p. 39). Du coup, si l’on tient pour vrais les propos de Dejours, l’affaire se complique sérieusement et les fausses évidences tombent. L’outil (ou le dispositif), aussi raffiné soit-il, ne fait pas tout et peut même s’avérer être un très mauvais allié quand on cherche à identifier les compétences acquises en situation de travail par une personne et à apprécier leur degré de transférabilité. Il convient donc d’inventer des pratiques d’évaluation qui porteront avant tout sur le travail réel (et pas seulement sur le travail prescrit), puisque c’est dans le travail réel que s’exprime la performance, mais aussi que s’actualise (et se consolide) la compétence.
Mais, pour Dejours, le couple classique travail réel/travail prescrit (ou tâche/activité) hérité de l’ergonomie, bien que fondamental, ne suffit pas à comprendre ce qui se joue dans le travail, car, pour entrer dans la boîte noire que constitue le travail réel (en vue de débusquer les compétences réellement mises en jeu dans l’activité professionnelle), il faut aussi tenir compte du réel du travail. Que faut-il comprendre par-là ? Tout travail – que celui-ci soit manuel, intellectuel ou encore relationnel – confronte inévitablement (à un moment où à un autre) le travailleur au réel du travail, c’est-à-dire à ce qui résiste à la maîtrise. Ce réel se manifeste sous la forme de l’expérience vécue, celle-ci étant toujours « une expérience subjective de l’échec, de l’incertitude, de l’impuissance, du doute » (Dejours, 2006, p. 128) ; il s’agit donc d’une expérience « pathique ». Ce qui est vrai pour le travailleur manuel, qui est confronté à la résistance de la matière et qui s’en trouve déstabilisé, l’est aussi pour l’enseignant qui, soudainement, perd la maîtrise de la classe et donc le contrôle de la situation (alors même qu’il déploie les « bonnes pratiques » pédagogiques) ; mais cela vaut aussi pour le manager d’équipe qui, malgré les efforts qu’il déploie pour mettre en œuvre ce qu’on lui a enseigné en formation, n’arrive pas à mobiliser son équipe et à asseoir sa légitimité en tant que manager. Cette rencontre avec le réel (qui est aussi l’expérience de l’incompétence puisque la performance n’est pas au rendez-vous) est évidemment une source de souffrance, mais c’est là que commence véritablement le travail, car « C’est cette souffrance qui est au départ de l’intelligence, de cette intelligence qu’il faut mobiliser pour persévérer dans l’épreuve affective qu’impose la rencontre avec le réel » (Dejours, 2013a, p. 170). Et cette intelligence, avant d’être cognitive, est intuitive car enracinée dans le corps ; ce dont il s’agit, ici, c’est donc d’une intelligence du corps, qui plus est indexée à une situation de travail particulière. C’est justement cette intelligence qui est au fondement du processus d’acquisition des compétences professionnelles. Par exemple, l’enseignant va apprendre, au fil du temps et à force d’échouer (et pour peu qu’il soit capable d’endurer l’échec), à repérer des signaux faibles dans sa classe, pour détecter chez ses élèves un flottement ou un manque d’attention (parce qu’il engage son corps tout entier dans la situation), ce qui peut l’amener à ajuster sa pratique pédagogique et à inventer quelque chose de nouveau pour surmonter les problèmes qu’il rencontre (une astuce, une ruse, une trouvaille…), quitte à s’écarter des « bonnes pratiques » qu’on lui a inculquées… Bref, chemin faisant, il va se forger une expérience professionnelle. Là commence la compétence. Il en va de même pour le bon ouvrier ou pour le bon manager.
Là commence aussi les difficultés pour qui souhaite expliciter ce type de compétence, car cette intelligence du corps – qui est au fondement de l’émergence de ce que certains auteurs appellent les compétences tacites (les fameuses tacit skills en anglais) ou encore les compétences incorporées (Leplat, 1995) – est la plupart du temps méconnue des travailleurs eux-mêmes, alors même qu’ils la mobilisent constamment dans l’action. « De sorte que souvent le travailleur habile sait mettre en œuvre son intelligence, mais ne parvient pas toujours à en rendre compte. Il ne dispose pas de tous les mots nécessaires pour décrire ce travail effectif et il est même probable que le lexique, la langue elle-même soient fondamentalement déficitaires vis-à-vis de cette expérience du corps » (Dejours, 2013b, p. 29). On butte là sur un obstacle de taille. Celui-ci est-il pour autant insurmontable ? Nous ne le pensons pas, même s’il convient d’être extrêmement modeste en la matière parce qu’il s’avère très difficile (voire impossible) d’expliciter totalement le travail réel et les compétences effectivement mobilisées par les professionnels en situation de travail. Pourtant, les chercheurs ont inventé des méthodes d’analyse du travail parfois très sophistiquées, comme par exemple l’entretien d’explicitation mis au point par Pierre Vermersch (1994), qui vise une description aussi fine que possible d’une activité réalisée par une personne en situation de pratique professionnelle, ou encore l’autoconfrontation croisée, développée par Yves Clot et son équipe (Clot et al., 2000), qui consiste à confronter un professionnel à l’enregistrement vidéo de son activité, en présence du chercheur et d’un collègue qui s’est lui aussi confronté à ses propres séquences d’activité. Ces techniques ne sont cependant pas d’un usage aisé pour des non-initiés, et l’analyse fine du travail qui en résulte peut s’avérer extrêmement chronophage et complexe, ce qui peut rebuter les professionnels qui sont chargés d’accompagner les personnes en transition professionnelle (consultants en reclassement, coachs, conseillers en bilan de compétences, accompagnateurs en VAE, etc.). Tournons-nous alors vers la psychodynamique du travail et les travaux de Dejours pour essayer de concevoir une réponse un tant soit peu ajustée à la demande des professionnels de l’accompagnement.
Si on en croit Dejours, il est possible pour un tiers (cela peut être un chercheur, mais aussi un psychologue, un consultant, un conseiller, etc.) d’identifier les habiletés professionnelles d’une personne, s’il parvient à accéder à l’expérience subjective du travail de celle-ci (quand bien même elle ne serait pas pleinement consciente des habiletés qu’elle déploie dans son activité professionnelle). Cela suppose néanmoins que plusieurs conditions soient réunies. Il faut tout d’abord que ce tiers ait été préalablement formé à l’analyse du travail et qu’il soit capable d’interpréter ce que les personnes disent de leur expérience professionnelle. Il faut ensuite qu’existe une relation de confiance entre les deux protagonistes, ce qui n’est jamais donné d’avance. Il faut, enfin, que la personne soit disposée à parler des difficultés et des obstacles qu’elle rencontre dans son travail (son réel du travail), en partant de la description de situations vécues et des actions qui ont été menées dans ces situations (à titre individuel et/ou collectif). En sachant, qu’évoquer le réel du travail, c’est aussi parler de ses échecs et de ses incompétences, ce qui n’est jamais évident… Ce n’est cependant qu’à cette condition que le tiers pourra espérer accéder au travail réel de la personne et in fine repérer ses compétences professionnelles.
Mais cela n’est possible que si, à la parole risquée de l’un (le travailleur) répond l’écoute risquée de l’autre (le tiers), qui doit renoncer à sa position d’expert et de « sachant », d’une part, et qui doit ne pas être prisonnier de la grille qu’il utilise, d’autre part. Il pourra alors entendre ce que lui dit son interlocuteur, et donc accéder à son expérience subjective du travail, quitte à être, lui aussi, quelque peu déstabilisé. Pour Dejours (2003, p. 69), « la face méconnue du travail, ne devient [en effet] effective que s’il y a une équité entre celui qui prend des risques en parlant et celui qui prend des risques en l’écoutant. Le risque qu’on prend en écoutant c’est d’entendre. Evidemment, l’évaluateur n’entend rien si ce qu’il a à faire consiste à cocher des cases sur un papier ». Ce point est fondamental parce que, selon la psychodynamique du travail, la parole ne peut donner accès à la connaissance du travail réel que si l’on atteint « le moment où la parole révèle au sujet lui-même qui est train de parler des choses qu’il ne savait pas avant de les avoir dites. Car il se trouve que parler à quelqu’un est le plus puissant moyen pour penser » (Dejours, 2003, p. 68). Sur le plan théorique, nous avons ici affaire au pouvoir qu’a le langage de catalyser la perlaboration, une
« propriété du langage [qui] tient au fait que parler à quelqu’un est un des moyens les plus puissants de catalyser la pensée. A ce point qu’en parlant, celui qui cherche à exprimer son opinion s’entend parfois proférer des propos qui lui révèlent à lui-même des dimensions de sa propre expérience du travail (qui est aussi l’expérience du réel) qu’il ignorait au moment même où il s’entend parler » (Dejours, 2013b, p. 192 et 193). Si l’on en revient à la relation d’accompagnement, c’est justement à ce moment précis, que peuvent se révéler certaines habiletés professionnelles, qui étaient jusqu’alors mises en œuvre dans l’activité de travail de façon tacite, c’est-à-dire de manière plus ou moins inconsciente. Et, pour le tiers, la tâche qui consiste à décrire et à expliciter les compétences professionnelles de la personne qu’il accompagne, devient alors à portée de main. Il lui restera ensuite à traduire ces habiletés professionnelles (au départ incorporées) en compétences professionnelles, pour faciliter le positionnement de la personne qu’il accompagne et l’aider à bâtir un projet professionnel.
Bibliographie
CLOT, Y., FAÏTA, D., FERNANDEZ, G. et SCHELLER, L. (2000). Entretiens en autoconfrontation croisée : une méthode en clinique de l’activité. Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, 2-1. http://journals.openedition.org/pistes/3833
DEJOURS, C. (2003). L’évaluation du travail à l’épreuve du réel – Critique des fondements de l’évaluation. INRA Editions (Coll. Sciences en questions)
DEJOURS, C. (2006). Aliénation et clinique du travail. Actuel Marx, 39, 123-144.
DEJOURS, C. (2013a). Travail vivant – 1. Travail et sexualité. Editions Payot & Rivages.
DEJOURS, C. (2013b). Travail vivant – 2. Travail et émancipation. Editions Payot & Rivages.
LEPLAT, J. (1995). À propos des compétences incorporées. Éducation permanente, 123 ,101-113.
VERMERSCH, P. (1994). L’Entretien d’explicitation. ESF.