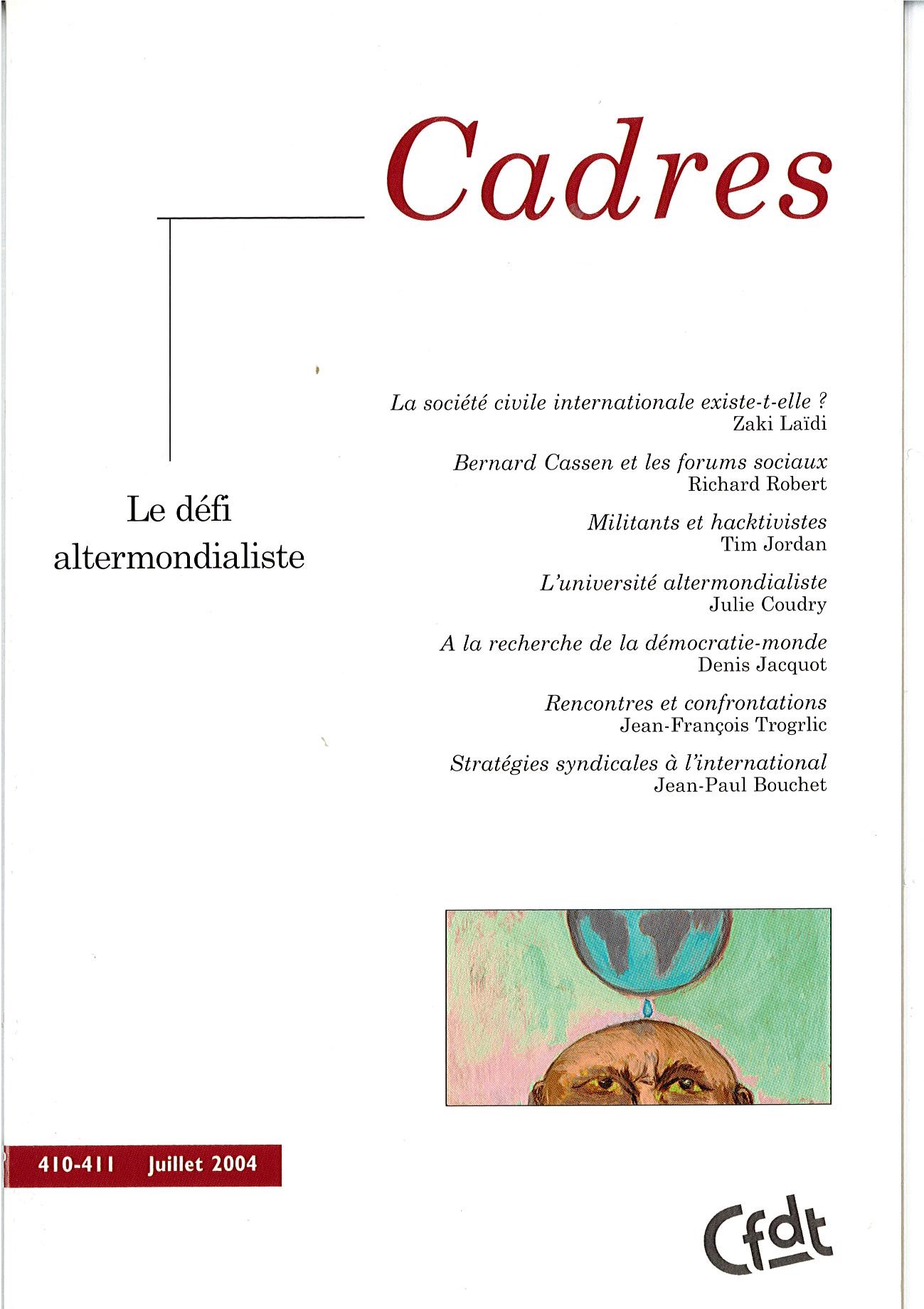Comment penser la notion de société civile internationale ?
La question de la place et du rôle de la société civile internationale est une des expressions les plus galvaudées du débat sur la mondialisation. Il en découle une énorme imprécision terminologique et une inévitable confusion politique. Pour beaucoup de gens, la « société civile mondiale » est assimilée au monde des ONG. Mais faut-il inscrire les syndicats dans le monde des ONG ? Certains altermondialistes pensent que non et beaucoup de syndicalistes ne veulent pas être identifiés au monde des ONG ou de l’altermondialisme. Mais là encore, rien n’est simple : la conférence de Seattle de l’OMC en 1999 a été perçue et vécue à travers le monde comme l’acte de naissance de l’altermondialisme et le révélateur de la montée en puissance de la société civile internationale. Pourtant, le gros bataillon des manifestants était composé de 30 000 syndicalistes américains membres ou proches de l’AFL-CIO auxquels s’étaient joints 5000 écologistes avec lesquels ils avaient fait alliance sur une base protectionniste. Les syndicalistes combattant l’ouverture des secteurs protégés ou en difficulté comme la sidérurgie, tandis que les écologistes se battaient pour que l’ouverture des marchés ne remette pas en cause les standards environnementaux élevés. Comment donc sortir de cette gigantesque confusion et introduire de la rigueur dans une interprétation qui en manque ?
Pour cela, il faut, je crois, procéder en deux temps. Partir de la notion de société civile qui comme vous le savez, remonte à Aristote, et voir quelles dynamiques nouvelles celle-ci porte-t-elle. Tenter ensuite de typologiser cette société civile internationale dont on parle tant.
Commençons par le premier point que j’appellerai le voyage conceptuel de la société civile. Pour Aristote, la société civile désigne ce que l’on appellerait aujourd’hui l’espace public. C’est l’espace extérieur à l’oikos, à la sphère privée si vous voulez. Cette définition de base présente un intérêt pour comprendre aujourd’hui l’idée de société civile, car ce qui, pour Aristote, distingue la sphère privée de la sphère publique, c’est la différence du rapport à l’autorité. Dans la vie privée, pour Aristote, le pouvoir est vertical. Dans la société civile, ce sont des rapports horizontaux et contractuels entre hommes libres qui prévalent. On retiendra donc ici une première notion, celle d’une sphère qui échappe à l’autorité verticale.
La définition moderne de la société civile est toutefois concomitante avec les théories modernes de l’Etat, ce qui revient à dire que même si la société civile peut s’opposer à l’Etat, il n’est pas possible de penser la société civile indépendamment de l’Etat. C’est un point très important qui se vérifie tous les jours : les sociétés civiles les plus sophistiquées existent dans les sociétés politiques les plus sophistiquées, celles où l’Etat est développé, structuré et organisé. C’est un point important qui joue beaucoup dans la mondialisation : les asymétries entre Etats se retrouvent entre ONG. Autrement dit, les ONG du Nord sont incomparablement plus puissantes et développées que les ONG du Sud ; et beaucoup de gouvernements du Sud voient dans les ONG du Nord leurs pires adversaires et cela pour de multiples raisons sur lesquelles je reviendrai.
Mais reprenons notre itinéraire conceptuel. Avec les théories de l’Etat moderne, on voit se développer des théories contractualistes et des théories libérales. Pour les « contractualistes », la société civile renvoie à l’idée de mobilité sociale intériorisée par les individus et garantie par ce que l’on pourrait appeler l’Etat de droit. Pour les libéraux, la société civile renvoie à l’idée selon laquelle ce n’est plus du souverain que dépend l’ordre social, mais de l’interaction des comportements individuels. Mais pour les libéraux historiques, les liens marchands sont constitutifs de cette société civile car c’est par l’échange marchand et la culture que les individus se « civilisent ». La société civile est alors identifiée à la société commerçante.
Naturellement, pour l’altermondialisme français du XXIe siècle, et notamment sa frange politique anticapitaliste, l’identification de la société civile à une société commerçante apparaîtra comme une abomination anglo-saxonne ! Mais si l’échange marchand est alors identifié à la civilisation, c’est parce qu’il apparaît très clairement comme un substitut à la guerre.
Hegel, puis Marx, continuent d’ailleurs à penser la société civile par référence à une société commerçante travaillée par la sociabilité, l’intérêt individuel et la civilité. Mais le principal apport de Hegel n’est pas là : il se situe plutôt dans la définition de la société civile comme une sphère sociale indépendante de l’Etat et de la famille, dans laquelle se développe la subjectivité propre des individus. Hegel voit donc dans la société civile une sphère sociale de jugement autonome et indépendante de l’Etat.
Par rapport à la définition hégélienne, la définition actuelle de la société civile contient des éléments de continuité important et des discontinuités non moins significatives.
La continuité importante se situe dans la référence à un espace social dominé par le vécu de ses membres et non par un rapport à une hiérarchie ou une autorité. Pierre Manent nous dit que ce que l’on appelle la crise de la souveraineté, c’est avant tout la perte de contrôle de l’Etat sur la société des individus. La montée en puissance de la société civile exprime cette évolution.
Mais il y a dans l’acception actuelle du terme de société civile une dimension particulière liée à la mondialisation : la critique du marché. Dans la définition hégélienne ou même dans la représentation qu’on a pu avoir de la société civile à travers les actions de la dissidence des sociétés de l’Est, la société civile ne s’oppose plus seulement à l’Etat. Elle tend de plus en plus à s’opposer au marché, qu’elle identifie comme un acteur autonome et qui aurait même supplanté les Etats.
D’ailleurs, si vous prenez un mouvement comme Attac, vous constaterez très facilement que sa cible, c’est le marché et non l’Etat. Bien au contraire. Attac rêve d’Etats forts, capables d’encadrer la mondialisation sur une base au fond très classique. Vous voyez donc, au travers de ce rapide voyage, qu’il y a en permanence des éléments de continuité et de discontinuité.
Au regard de ce que vous venez de dire, peut-on, malgré tout, donner une définition de la société civile ?
Ma définition est inspirée de celle d’Habermas. Je parlerai d’elle comme d’une sphère autonome de jugement constituée en dehors de l’Etat et du marché pour influencer, infléchir ou contrarier des choix collectifs nationaux ou globaux. Jusqu’à présent, on était dans un jeu binaire où les libéraux mettaient en avant les défaillances de l’Etat pour prôner la dérégulation, tandis que les libéraux-sceptiques mettaient en avant les défaillances du marché pour prôner l’intervention de l’Etat. Il me semble que le fait inédit que porte la société civile (avec toutes les réserves et limitations que ce terme appelle), c’est la reconnaissance de défaillances sociétales dont la solution ne passe ni par l’action mécanique du marché, ni par le recours automatique à l’Etat, mais par des procédures tierces qui mobilisent Etat et marché, tout en refusant catégoriquement de réduire les enjeux à un arbitrage entre ces deux acteurs.
Pour moi, l’idée de société civile est une idée opératoire chaque fois qu’elle permet de comprendre l’émergence d’une rationalité sociale collective autonome, indépendante de l’Etat et du marché, sans pour autant exclure ces deux acteurs dans la construction de cette rationalité. Cette rationalité collective autonome ne peut éclore et se développer que si elle s’appuie sur l’implication des acteurs concernés. C’est, à mon avis, le fond de l’affaire.
Pour en revenir à la société civile internationale, comment la définir concrètement ? S’agit-il d’une agrégation de sociétés civiles nationales ou d’un acteur à part entière ?
Les deux à la fois. Mais il faut à tout prix éviter de l’identifier à une sorte de nouveau sujet socio-historique qui jouerait au XXIe siècle le rôle qu’aurait dû jouer la classe ouvrière au XXe siècle ! On sent bien notamment chez beaucoup d’anciens marxistes, cette volonté de faire de la société civile une sorte de nouvelle avant-garde planétaire. La réalité est assez éloignée de ce projet. La société civile internationale renvoie plutôt à une pluralité de réseaux décentralisés qui, sur différents sujets, parviennent à produire du savoir, provoquer de la délibération publique, et à dégager des actions en jouant de trois atouts : la vitesse, l’information et l’individualisme. Or ces trois valeurs sont des valeurs de notre temps, que les nouvelles technologies de l’information permettent d’ailleurs de bien manier. Mobiliser rapidement un savoir expert, médiatiser les enjeux, permettre à chacun d’intervenir dans ce réseau sans rite initiatique ou adhésion à une doctrine, c’est ce qui fait la force de cette société civile.
Les actions de cette société civile paraissent parfois spectaculaires. Qu’en est-il de son influence effective ?
C’est un point sur lequel il faut rester très prudent. Le risque est de surestimer son rôle quand son action prend précisément des formes spectaculaires. Mais à l’inverse, il serait absurde de sous-estimer sa capacité à éroder certaines croyances et à influencer le jeu social.
Pour apprécier de manière précise cette influence, je propose de la mettre en regard avec trois modes d’influence : la fonction d’expertise, la fonction de dévoilement et l’influence concrète sur les décisions. En termes d’expertise, les ONG ont acquis un avantage comparatif dans tous les domaines où les Etats se sont peu impliqués ou qu’ils ont délaissés, et dans tous ceux où traditionnellement ils ne se sont jamais montrés très présents, parce que le sujet était nouveau ou trop technique. Ces domaines sont très clairement l’environnement, les droits de l’homme et les enjeux liés au développement des pays du Sud. Les ONG peuvent dans tous ces domaines mobiliser un savoir que les Etats n’ont pas, ou une contre-expertise quand les Etats avancent des solutions contestables. Il ne faut pas d’ailleurs s’imaginer que ces ONG travaillent « contre » les Etats. De plus en plus, elles travaillent avec eux1. Mais le fait est là : la société civile mondiale est malgré tout parvenue à produire du savoir légitime et à rompre le monopole de l’expertise publique. C’est là son principal acquis, ce qui est loin d’être négligeable. D’autant que cette « production de savoir » se prolonge désormais par une capacité de mobilisation. C’est ce qui explique d’ailleurs pourquoi, dans les trois domaines que j’ai indiqués, la société civile internationale a réussi à faire en sorte que les questions de dette, de droits de l’homme et d’environnement ne soient pas totalement négligées par les Etats. Maintenant, si nous nous plaçons du point de vue de l’influence effective de cette société civile sur les choix collectifs, les résultats sont plus modestes. Pour moi, l’environnement est le domaine où la pression des ONG a été la plus effective car l’expertise civile est indiscutable. Mais le fait que le protocole de Kyoto ne soit pas entré en vigueur alors même que nous savons qu’il est très insuffisant, montre qu’il ne faut pas se payer de mots et d’illusions. Les Etats peuvent bloquer le jeu pour le meilleur et pour le pire. La société civile mondiale parvient très souvent à se réapproprier les échecs des Etats, ce qui conduit à surestimer son influence. Mais, on le voit bien à l’OMC, les échecs de Seattle et de Cancun doivent peu à la mobilisation des ONG. Ils s’expliquent avant tout par les divergences entres Etats.
A rebours de certaines interprétations, vous insistez beaucoup sur le caractère local des enjeux les plus globaux. Comment expliquez-vous cela ?
Prenons un exemple simple : celui de l’altermondialisme français et d’Attac en particulier. C’est un mouvement qui se veut internationaliste. Mais c’est avant tout un mouvement français qui s’inscrit très bien dans le panorama politique français. C’est tout d’abord un mouvement politique et non un mouvement social. Attac est un produit du Monde diplomatique et de toute la tradition qui s’y rattache : tiers-mondisme, anticapitalisme, antiaméricanisme très puissants, dont la tonalité est d’ailleurs politique mais aussi culturelle. Quand nous examinons maintenant non pas le discours d’Attac, mais la trajectoire de ses dirigeants, vous retrouvez le même modèle : une direction chevènemento-communiste, très étatiste et très anti-européenne. En fait, la direction d’Attac est l’héritière d’une tradition très classique (nationaliste de gauche) qui dans les faits croit beaucoup plus aux Etats qu’au mouvement social. C’est la raison pour laquelle elle a tant investi affectivement en Lula. Elle y voyait l’amorce d’une reconstitution politique d’une ligue dissoute, celle des anciens non-alignés. Pour Attac, la création du G-20 à Cancun eût été une excellente nouvelle politique, si son chef de file, le Brésil, n’avait pas pris des positions extrêmement libérales pour s’opposer aux pays du Nord. Car il faut bien voir qu’à l’OMC, le conflit se joue parfois à fronts renversés. Ce sont de gros exportateurs de produits agricoles du Sud qui reprochent au Nord son protectionnisme. Or dans ce débat, les altermondialistes français sont par exemple moins à l’aise que les ONG type Oxfam. Toute leur socialisation s’est faite sur la base d’une sanctification du cadre national, du pouvoir régulateur de l’Etat et d’une hostilité profonde vis-à-vis du libre-échange. Ce que je veux dire, c’est que pour comprendre un mouvement altermondialiste, il faut avant tout voir d’où il vient. Les luttes d’influence qui au sein d’Attac, opposent par exemple communistes et troskystes, s’inscrivent elles aussi dans une logique de déjà-vu historique. La mondialisation n’est de ce point de vue qu’un prétexte, ou plus exactement une actualisation de clivages historiques, culturels et idéologiques plus anciens, même si, naturellement, chaque période historique a sa spécificité.
L’une des critiques que vous adressez à l’altermondialisme est de ne pas renvoyer à une condition sociale mais à une condition existentielle. Pouvez-vous préciser ce point ?
Ce n’est pas une critique. C’est un constat. Les groupes sociaux les plus surreprésentés dans l’altermondialisme – je parle des militants – sont les groupes sociaux les moins exposés à la compétition mondiale. Les plus vulnérables face à la mondialisation, ce sont les paysans, les ouvriers, les employés. Or, ce sont les groupes les moins représentés dans l’altermondialisme. C’est en cela que l’altermondialisme se distingue profondément du syndicalisme, et c’est pour cela qu’il faut à tout prix éviter de s’aligner mimétiquement sur lui en croyant qu’il représente le nouveau parti des « damnés de la terre ». D’autant que leur pouvoir de proposition est très faible et que leur volonté de négocier et de s’engager l’est encore davantage. Je pense que ce constat est difficilement contestable. De cela, je tire une interprétation en disant que l’altermondialisme renvoie à une condition existentielle plutôt que sociale. En faisant cette hypothèse, je dis simplement que l’altermondialisme est un radicalisme sans classe, dont les militants actifs sont une « minorité d’initiés » confrontée au « désintérêt des classes populaires ». Ce n’est d’ailleurs pas moi qui le dit, mais l’ancien président d’Attac. Au-delà, je crois que l’essentiel de mon propos pourrait se résumer ainsi : le rapport social à la mondialisation n’obéit à aucun déterminisme simple. J’ai identifié quatre facteurs autour desquels se construisaient les représentations de l’altermondialisme : la génération, la qualification, la perception de son exposition à la compétition économique et la socialisation des individus et des groupes sociaux. Ce qui veut dire que la peur de la mondialisation n’est pas, chez un ouvrier, par exemple, corrélée de manière mécanique au risque qu’il encourt de perdre son emploi. Un jeune de 18 à 24 ans a beaucoup plus de chances de perdre son emploi que son aîné de 40 ans. Or, statistiquement, sa peur de la mondialisation sera beaucoup plus faible.
De tout ce que vous venez de dire, peut-on dégager un espace socio-politique réformiste qui ne se reconnaisse ni dans l’altermondialisme ni dans l’acceptation des règles du jeu libéral ?
C’est la question centrale sur laquelle la social-démocratie doit se prononcer aujourd’hui. Pour tenter d’y répondre, il faut partir de la nouvelle configuration sociale créée par l’émergence d’un nouveau capitalisme : le capitalisme financier. Socialement, la conséquence la plus importante de cette nouvelle dynamique capitaliste est le déséquilibre créé entre les forces du capital et les forces de travail, pour faire court. Les premières ont pour atout essentiel la mobilité planétaire tandis que les secondes restent sédentarisées.
La médiation nationale corrigeait et limitait ce déséquilibre non parce que les capitaux étaient moins financiers et donc plus industriels, mais parce que les Etats avaient créé des obstacles à cette fluidité du capital.
Ce déséquilibre crée à son tour des déséquilibres en chaîne, dans la mesure où non seulement il modifie l’équilibre général entre travail et capital au profit du second, mais l’accentue en « dégroupant » le travail, en le « déconditionnant ».
Le « déconditionnement » du travail se traduit par le recul fort de la notion de condition du travail. Il n’y a pas ou plus de condition du travail ; il y a des conditions du travail où les vécus sont différents et de plus en plus individualisés. Ce déconditionnement du monde du travail est à son tour accentué par le déséquilibre créé au sein du monde du travail entre travailleurs qualifiés et non qualifiés.
Dans cette nouvelle donne, on voit donc clairement qu’il y a des perdants sociaux alors que l’identification des gagnants est plus difficile à établir ou, lorsque elle est possible, paraît plus limitée. Le fond du problème est donc le suivant : le nouveau capitalisme permet la création de richesses dans des conditions nouvelles et à un rythme très soutenu, en jouant sur l’innovation, la créativité, l’individualisme et la conversion de toute création en valeur marchande, mais il laisse entière la question de la redistribution des gains de cette création de richesse. Comment sortir de là ? Les libéraux ont deux réponses complémentaires : la première consiste à faire confiance aux individus eux-mêmes pour s’adapter à la nouvelle donne en s’adaptant et en se formant. La seconde consiste à faire confiance au commerce mondial, à l’échange ouvert pour réduire les déséquilibres, notamment entre travailleurs qualifiés et non qualifiés. Or, ces deux réponses ne sont pas pleinement satisfaisantes car elles font trop confiance au pouvoir correcteur du marché. Naturellement, l’adaptation et la requalification sont indispensables. Mais croire que le volontarisme individuel y suffit est pour le moins naïf. D’autant que l’on sait parfaitement bien que les salariés sont profondément inégaux face au changement. Il nous faut donc réfléchir socialement et politiquement au thème de l’inégalité face au changement pour rendre ce dernier plus acceptable, plus tolérable, voire plus attractif. Si je prends maintenant le second point, l’égalisation par l’échange mondialisé, là non plus les libéraux ne sont pas pleinement convaincants. La théorie libérale libre-échangiste nous dit que l’ouverture économique crée des gagnants et des perdants mais que leur distribution est égalisatrice : au Nord les bénéficiaires de l’ouverture sont les travailleurs qualifiés ; au Sud, les travailleurs non qualifiés. Or, quand on regarde les choses telles qu’elles se passent, on ne peut pas être aussi optimiste : les travailleurs non qualifiés sont les grands perdants partout, au Sud comme au Nord, car le travail tend à se raréfier. Or, face à une ressource rare, ce sont les plus qualifiés qui gagnent, même quand le travail offert n’est pas en soi un travail qualifié. C’est là que réside à mes yeux l’explication centrale de l’inégalité sociale mondiale.
Cela étant posé, il faut donc essayer de revenir à votre question qui est celle du positionnement face aux altermondialistes. Je dirai qu’il faut répondre en trois temps. Il faut tout d’abord éviter de considérer les altermondialistes comme un bloc, car il y a dans cette galaxie une pluralité d’acteurs, de tendances et de factions. Ce premier point est très important, surtout en France où, comme je le disais, nous avons à faire à un altermondialisme très politisé, dominé par des souverainistes ou des trotskystes. Une fois ce tri effectué, il faut procéder de nouveau à une distinction entre le diagnostic et les solutions. On peut, à mon sens, sans difficulté majeure, partager une partie du diagnostic critique des altermondialistes sur le capitalisme mondialisé, mais on doit le raffiner, le rendre plus sophistiqué et surtout mettre en évidence ses potentialités en termes d’épanouissement, de créativité. Je dirai donc que l’on peut avoir un diagnostic général commun mais que l’on doit le nuancer – ce que ne font jamais les altermondialistes – en mettant en avant sa positivité et surtout en récusant toute idée de déterminisme. C’est au fond la grande différence qui a pu opposer les marxistes aux réformistes. Les premiers sont déterministes (loi d’airain du capitalisme) et ne croient à une sortie que par l’alternative globale. Les seconds croient aux bifurcations (notamment culturelles), à l’absence de déterminisme et au refus de l’alternative globale.
Les « sociaux mondialistes » ne veulent pas forcément d’un autre monde profondément différent de celui dans lequel ils vivent et dans lequel les règles du jeu seraient fondamentalement différentes. Ils veulent corriger les déséquilibres en croyant aux mécanismes de réappropriation sociale et surtout en croyant à la négociation et au compromis. Car c’est là que l’écart entre altermondialistes et sociaux mondialistes est le plus sensible. Les altermondialistes – notamment français – sont radicaux : ils refusent toute idée de négocier car négocier, c’est se compromettre, et leur base ne le leur permettrait pas. C’est là que l’on retrouve des débats que le syndicalisme français connaît bien : certains syndicats récusent l’idée de majorité d’engagement qui les contraindrait à « s’engager » et à se compromettre. Pour survivre, il faut donc refuser le compromis avec les institutions existantes et placer la barre toujours plus haut.
Regardez Greenpeace : ils jugent par exemple que la prise en compte des questions environnementales par l’OMC est très faible et donc inacceptable. Mais ils ne feront aucun effort pour épauler la Commission européenne dans cette voie, alors que l’Europe est la seule région du monde qui se préoccupe sérieusement du lien entre environnement et commerce.
L’Europe est l’ensemble politique le plus proche de leurs thèses. Mais au lieu de la soutenir, ils la vilipendent. La Confédération paysanne procède de la même manière : l’Europe est le seul ensemble politique qui porte l’idée de multifonctionnalité. Mais la Confédération paysanne ne le dira jamais. Elle dénoncera en revanche l’Europe libérale. Je n’ai pas parlé d’Attac car Attac est un mouvement très clairement anti-européen, en tout cas au niveau de ses dirigeants. Naturellement, cette hostilité est parée des atours de l’antilibéralisme. Mais cet antilibéralisme n’est qu’un prétexte. Leur hostilité politique à l’Europe est profonde, culturelle et idéologique.
Pour me résumer, je dirai donc que la démarche réformiste face à la mondialisation peut se construire autour de trois axes : un diagnostic critique du système capitaliste actuel, une prise en compte de ses potentialités, autrement dit de ses avantages, ce qui interdit de raisonner en termes de statu quo, une implication concrète assumée dans toutes les instances de pouvoir où se joue la mondialisation. J’ai conscience que ce schéma n’est pas encore assez précis, mais il indique une orientation.
1 : Sur ce point, voir le livre récent de Thierry Pech et Marc-Olivier Padis, Les Multinationales du cœur. Les ONG, la politique et le marché (Le Seuil/La République des idées, 2004).