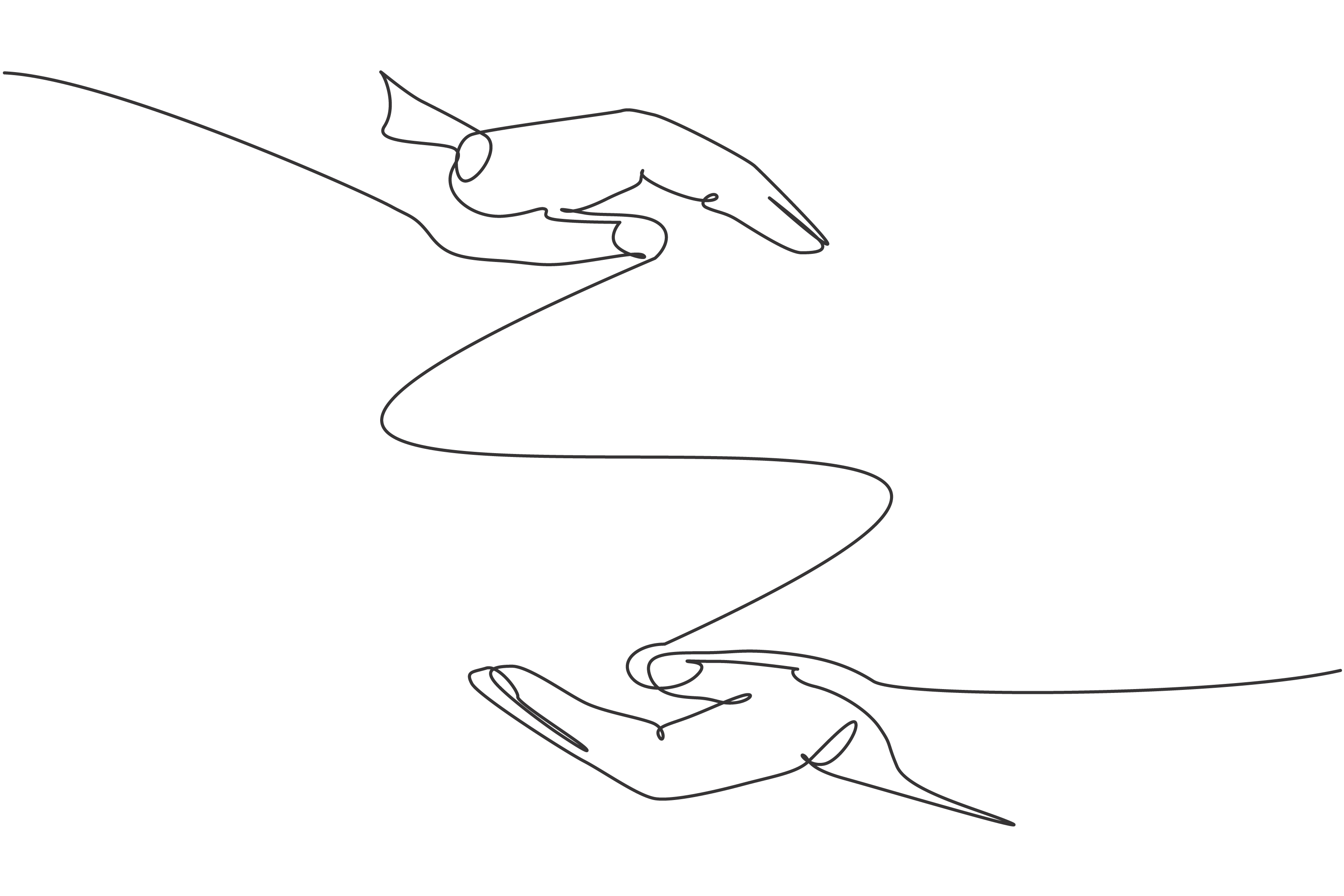Il y a des alertes sous la forme d’une spirale sans fin de la défiance à l’égard du certain équilibre bâti après-guerre dans les démocraties occidentales. Urgence, donc, face à l’émergence de gouvernements populistes et d’extrême-droite, ce que nous pensions impossible il y a quelques années[1]. La victoire et l’hégémonie libérale que nous célébrions il y a trente ans est bien derrière nous. La démocratie française n’avait jamais été en effet aussi apaisée qu’en 1989. Chute du Mur, victoire de la démocratie libérale, désarmement nucléaire : la République du centre qui a structuré la génération des responsables actuels relève désormais d’une autre époque, et ce pour trois raisons : l’autoritarisme réussit lui-aussi économiquement (le développement de la Chine en témoigne), le maintien d’une croyance que la centralité du vote suffit à garantir la démocratie (les populismes se développent en s’appuyant sur cette légitimité) et la formidable expansion des sources d’information et d’expression (numérique) qui font que les citoyens sont - ou se sentent - bien davantage compétents et se méfient des mécanismes de représentation ou sont très exigeants à l’égard des mandats de pouvoir (pour Pierre Rosanvallon, l’opinion publique existe désormais grâce aux réseaux sociaux). On pourrait ajouter que le libéralisme économique est aujourd’hui mis au défi monumental de la finitude écologique (« capitalisme extractif »).
Les années 1990 ont ainsi vu se développer une « insécurité sociale » profonde (Robert Castel) et une individualisation de la question sociale. En somme, la démocratie représentative de l’après-guerre nourrie de collectifs institués et de redistribution ne va plus de soi[2]. Il y a de la fatigue démocratique. Il y a un besoin, une demande de protection directe pour chacun, une demande de réalisation de soi, parfois réduite à de la consommation effrénée. Epuisante obéissance à l’injonction à l’autonomie : l’homme moderne est performant. Le contexte d’une mondialisation violente et des effets de la crise de 2008 les ont amplifiés, et ces peurs et mal-être s’expriment dans des votes de plaintes, voire d’appels à la grève générale ou même à de l’insurrection (gilets jaunes). La France n’en finit plus de compter les « crises » (sociale, économique, financière, de la participation, de l’expression, des corps intermédiaires…) depuis un demi-siècle et abuse du mot dans une société qui aime dramatiser les passions politiques et recherche l’absolu cartésien. Il faut dire que ce qui était institué n’est plus, à l’exemple du conflit Eglise - Parti communiste (CFTC - CGT) longtemps structurant dans l’hexagone.
L’hystérisation de l’espace public
Nous vivons ainsi un moment de basculement autoritaire et des historiens du Camp des Milles (Bouches-du-Rhône) en ont étudié les phases. D’abord une perte de repères dans la société, d’identité et un besoin de protection conçoivent un terreau propice à la dérationalisation (le racisme ordinaire en est une illustration), exploité par une minorité extrémiste. Celle-ci désigne des coupables aux crises traversées par le pays (citons le lien imaginaire entre immigration et chômage de masse). Une partie de la population, la plus atteinte socialement, accueille ces messages simples et efficaces. La population protégée, elle, en ignore la gravité. Peu à peu, le pays s’habitue des formes de propagande et de violence contre des personnes et des institutions (lorsque des personnages publics de premier rang cognent sur l’autorité judiciaire, par exemple). Une société en crise et en souffrance préfère l’ordre à la liberté, le « confort de la meute » à la complexité. L’extrémisme identitaire s’installe, conquiert le pouvoir. Jusqu’où va-t-il ? Quelles résistances opposons-nous ? Travailler sur les urgences démocratiques est une réflexion sur la notion d’engrenage. La peur d’un retour aux années 1930 et la naïve diabolisation de l’extrême-droite ne suffisent plus : il faut prendre au sérieux la vague démagogique, populiste et dogmatique.
La première résistance à l’engrenage totalitaire, à la prise de pouvoir de l’extrême, est de casser la représentation que la démocratie se résume, se réduit à l’élection. Certes, on défendra la séparation des pouvoirs (équilibre), l’égalité entre les hommes (citoyenneté), la justice sociale (fraternité), la liberté de conscience, etc. Mais ne défendons pas la démocratie seulement comme un régime : la promesse est lourde et porteuse de déceptions. C’est d’abord un état d’esprit (Mendès-France) et la capacité de s’entendre pour gouverner à plusieurs, à faire société, reposant sur la qualité des expressions et des débats. L’agora athénienne a d’abord enseigné la qualité de l’espace public. La fécondité des contradictions et du débat est un pilier majeur de cet état d’esprit. Ils permettent de se représenter la réalité et de la transformer[3].
Dans ce monde de l’après « après-guerre » vient la question de la démocratie dans le travail et la qualité d’expression et de participation des travailleurs. La CFDT a bâti son projet d’émancipation en réponse à la subordination. Car on ne saurait plaider que l’entreprise vit en démocratie et ne peut être démocratique. On ne peut se satisfaire de notre héritage intellectuel qui oppose capitalisme et démocratie : le capitalisme est un projet politique du 20ème siècle qui pose comme dominant le détenteur des moyens de production. Dès lors, l’indicateur de l’émancipation peut être le niveau d’autonomie et de son corollaire, la coopération. L’entreprise en tant que collectif de travail repose sur un capital humain, à l’image des services publics reposant sur la qualité d’engagement professionnel davantage que sur un capital.
La forme « libérée » de l’entreprise illustre à ce titre le besoin de dégager des marges de manœuvre dans le travail face à la gabegie procédurière et aux pyramides hiérarchiques. Il y a des recherches de résistance à la pression gestionnaire, aux dérives du taylorisme et du lean management, aux tyrannies locales. Si la démocratie est la culture du débat, interrogeons-nous sur la qualité de l’expression dans les entreprises libérées au travail et sur le travail. Car elles prennent le risque de s’en tenir à une autonomie fonctionnelle du quotidien et à un projet grandiloquant qui oblige à toujours plus d’engagement de soi, d’enrôlement de la personne au-delà du professionnel. Reste que l’entreprise traditionnelle au sens industriel et le lien salarial sont aujourd’hui remis en cause comme d’autres institutions. L’urgence démocratique est ainsi un appel à la vigilance, un enjeu syndical dans la cité comme représentant et reflétant les réalités sociales dans une société qui peine à voir, à se comprendre (d’où l’utilité des enquêtes et des recherches-action par exemple). Il s’agit de mettre de l’intelligence et de la rationalité pour ne pas laisser les plaintes être exploitées, façonnant l’hystérisation de l’espace public. Une culture démocratique favorise elle une conflictualité, organise le conflit des logiques en vue d’infléchir la difficile réalité d’aujourd’hui.
[1] www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-video-universite-syndicale-d-ete-une-farouche-volonte-de-faire-vivre-la-democratie-srv1_1006538. [2] Th. Pech, Insoumissions, 2017. [3] A noter le livre Les Ingénieurs du chaos décrivant les stratèges du Brexit, de l’élection de Trump, de Grillo, de Bolsonaro..., https://esprit.presse.fr/actualite-des-livres.