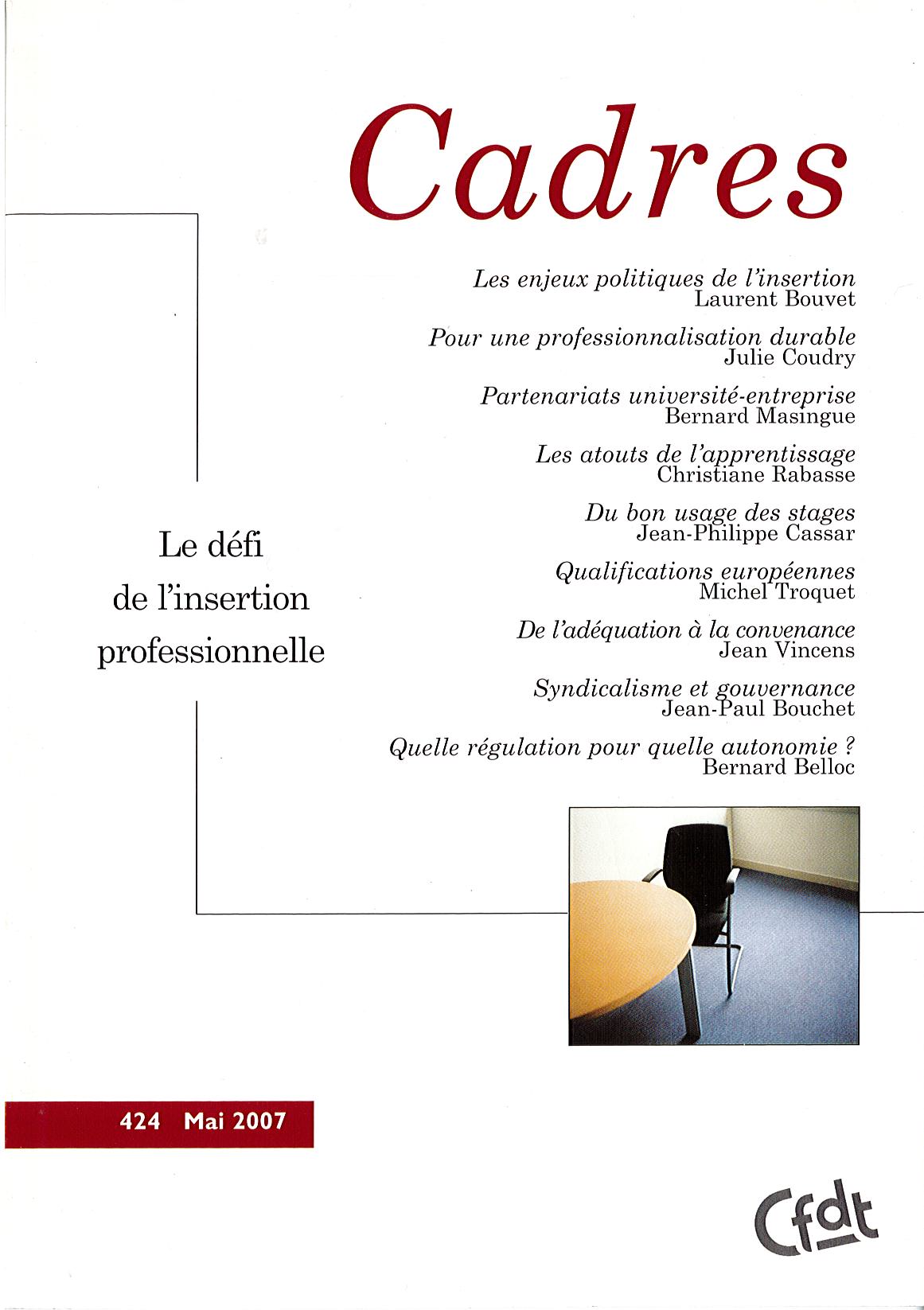L’université se serait-elle mise en mouvement ? En posant avec fracas la question de l’insertion professionnelle des jeunes, la crise du CPE semble avoir précipité une évolution que beaucoup jugeaient improbable.
Dans les années 1960 l’université formait surtout des médecins, des avocats, et des diplômés de lettres ou de sciences qui trouvaient naturellement leur place dans les fonctions publiques. Puis sont venues des politiques visant à former des bacheliers et donc des diplômés de plus en plus nombreux. L’institution a suivi tant bien que mal, si occupée à répondre à ce défi de la quantité qu’elle a dû laisser de côté la qualité – à commencer par celle des conditions de travail des étudiants et des enseignants-chercheurs, terriblement dégradées. Depuis une quinzaine d’années la qualité des diplômes, ou plus précisément leur valeur sur le marché du travail, est elle aussi mise en question.
L’université est devenue le ventre mou de notre système d’enseignement supérieur. Les bons élèves et ceux qui ont la chance d’être bien conseillés vont ailleurs, en classes préparatoires ou dans les cycles courts. Les autres arrivent à la fac et découvrent vite dans quelle galère ils se sont embarqués : trop nombreux, mal orientés, mal encadrés, ils finissent par connaître une forme de sélection naturelle particulièrement sauvage. Plus de 80 000 sortent chaque année du système sans aucun diplôme. D’autres traînent quatre ou cinq ans pour obtenir une licence. A l’autre bout du cursus, les docteurs cherchent en vain des débouchés professionnels et une reconnaissance de leurs compétences. Pour tous, l’entrée dans la vie active est hasardeuse. Les réseaux personnels ou familiaux font alors la différence, et tant pis pour ceux qui n’en ont pas.
Pendant longtemps, le conservatisme naturel de l’institution a pu trouver des alliés dans les idéaux abstraits des syndicats étudiants et le petit jeu des corporatismes professionnels. Les uns défendaient leur prébende, les autres parlaient République, gratuité, égalité et la machine pouvait continuer à produire ses contingents de chômeurs. Des chômeurs d’autant plus déçus qu’issus de familles modestes, ils avaient cru à la promesse qu’on leur faisait : travaille à l’école, décroche un diplôme, tu auras un emploi.
Tout n’est pas de la faute de l’institution. Le chômage de masse, la mauvaise organisation du marché du travail, l’évolution rapide des métiers et des secteurs industriels expliquent largement ce ratage. Mais l’insertion professionnelle des jeunes est désormais une priorité et un consensus s’est fait jour pour affirmer la responsabilité conjointe des employeurs et de l’université sur ce sujet. A côté de l’enseignement et la recherche, c’est désormais sa troisième mission.
Le rapport présenté l’automne dernier par Patrick Hetzel a dégagé quelques pistes. Améliorer l’information et l’orientation des étudiants est une voie efficace et déjà consensuelle. Plus délicate est la question de l’évolution du système, qui interroge l’évaluation, l’autonomie et la gouvernance des établissements. Enfin, ne nous le cachons pas, dans certaines filières la simple idée d’une professionnalisation est une véritable révolution. C’est pourquoi il est impératif d’en préciser les termes, sans quoi on fera le jeu de ceux qui refusent encore toute évolution au motif de ne pas inféoder le savoir à l’entreprise. Précisons donc, et précisons fermement.
L’université n’est pas seulement un lieu où l’on écrit des thèses : c’est là que s’écrit l’avenir de notre jeunesse. L’insertion professionnelle est le point le plus fragile et le plus décisif de notre pacte républicain. C’est là que tout peut se défaire, mais aussi que tout peut se refaire.
Il faut comprendre que les contraintes de la professionnalisation sont une chance. C’est une bonne nouvelle pour les élèves des filières scientifiques, auxquels les recruteurs reprochent de manquer de pratique. C’est une chance inespérée pour les étudiants des filières littéraires, qui n’ont souvent aucune idée de leurs propres savoir-faire. Enfin, dans une situation de concurrence objective avec d’autres institutions dont c’est précisément le principal avantage comparatif, c’est une formidable opportunité pour les universités. En offrant un meilleur avenir à leurs étudiants, elles se donnent enfin une chance de faire revenir les plus motivés. Certains établissements l’ont déjà compris.
La mise en œuvre de cette mission ne pourra se faire qu’en dotant les universités des moyens nécessaires. Mais là encore il faut être clair : la question des moyens est indissociable de celle de la gouvernance. L’Etat n’a aucune raison de se montrer moins pingre si les universités ne font pas un effort à leur tour, en rénovant leur organisation politique afin de préciser et distinguer les responsabilités.
Faut-il s’en plaindre ? Bien au contraire. C’est la promesse d’un meilleur usage des deniers publics. Et si l’on lie réforme de la gouvernance, souci de l’emploi et rapprochement avec le monde du travail, alors le syndicalisme a son mot à dire. La CFDT sera au rendez-vous.