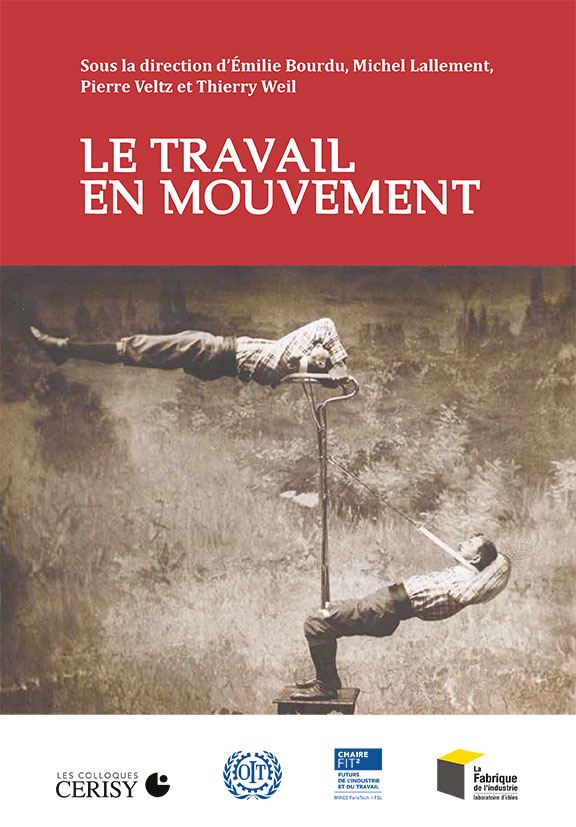La numérisation des processus productifs entraîne de larges et profondes recompositions des activités professionnelles, avec des formes nouvelles d’engagement au travail, des collaborations plus horizontales et des régulations sociétales qui évoluent. Cet ouvrage collectif analyse ces transformations contemporaines en confrontant les conceptualisations théoriques aux expérimentations sur le terrain. L’approche heuristique dans l’appréhension du travail est résolument pluridisciplinaire, conjuguant les observations statistiques aux bilans d’expérimentations particulières à certains ateliers et territoires et mobilisant un large panel de sources et d’experts des sciences sociales pour analyser les représentations du travail, et ses régulations sociales ou juridiques.
Par ses investigations sur les transformations du travail sous l’impact conjoint de la diffusion des technologies numériques et de la modification du lien de subordination dans le contexte d’une économie en voie de tertiarisation, l’ouvrage s’inscrit dans la poursuite d’un questionnement sur la nature du travail, initié par le colloque de Cerisy en 2017. En premier lieu, l’ouvrage décrit les conditions d’émergence de la responsabilité des agents dans les organisations classiques ainsi que ses limites. Puis, il examine les transformations du travail induites par la numérisation des activités pour analyser l’impact sur l’organisation productive et les conséquences qui en découlent pour les travailleurs salariés ou indépendants. S’en suit l’identification des nouvelles régulations émergeant en réponse à ces mutations et la délimitation des espaces de négociation ouverts tant au plan national qu’international par ce processus. Enfin, sont décrites les expérimentations se développant sur les territoires pour ouvrir la voie à des formes innovantes d’activité se démarquant des modalités professionnelles classiques.
Ainsi, la première partie de l’ouvrage est consacrée à dire, en le mesurant, ce qu’est un travail « normal » car c’est à l’aune de cette représentation que sont délivrés les diagnostics sur le travail, selon trois registres de normalisation : les théories scientifiques, les observations statistiques, et le corpus juridique (Michel Lallement). Dire, c’est mettre le travail en mots au moyen de différents langages qui, en reconstruisant une réalité professionnelle émiettée, reflètent les rapports de pouvoir au sein de la sphère du travail (Maryse Salles). Une revue bibliographique (Laurence Décréau) rend compte du brouillage des anciennes segmentations tayloriennes ou fordiennes, produites par la recomposition des processus productifs provoquée par la transition numérique : dopée par les outils de communication numérique, l’intensification du travail étend progressivement son empire sur le temps et la sphère de la vie domestique. Le travail codifié en chiffres, en particulier dans les indicateurs de gestion des entreprises, permet d’analyser la relation entre santé économique et qualité de vie au travail pour 408 entreprises classées selon quatre niveaux d’intégration technologique (P. Caillou & alii), aboutissant à des graphes de relation causale entre indicateurs de performance économique et ceux dédiés aux relations humaines. Ces modélisations confirment les effets positifs de la formation et de la prévention des risques sur la productivité et, symétriquement, les effets négatifs de l’absentéisme et du taux de démission sur la productivité. À noter également, les effets positifs d’emplois en CDI sur la performance économique et ceux du recrutement de femmes sur le taux de rentabilité, bien que ce dernier soit conditionné par de moindres rémunérations. Sont également présentées les premières analyses exploratoires de deux enquêtes « Parlons Travail », la première dans une entreprise de web design, la seconde dans une entreprise de production audiovisuelle, à l’initiative de la CFDT avec le concours d’un groupe de recherches en sciences sociales (Serge Volfof & alii). L’analyse factorielle multiple des correspondances indique que vieillissement et intensité du travail ne s’accordent guère : les seniors se positionnent en retrait vis-à-vis de la pression concurrentielle et des contraintes de temps au prix d’un recul en termes de responsabilités et de dynamiques de progression, lorsque des ajustements de poste sont proposés. À défaut, l’intensification conduit à la cessation précoce d’activité de certains des seniors. Quant à mettre le travail en images, cela suppose une perspective : Jean-Michel Saussois rend compte du parti-pris d’Harun Farocki « qui filme le travail en artiste plus qu’en militant ». Jean-Marie Bergère s’interroge : peut-on faire confiance aux images, elles-mêmes en mouvement ? Louise Gaxie et Alain Obadia dressent une cartographie mentale des mutations du travail qui révèle comment les mutations technologiques alimentent la transformation des processus productifs.
La seconde partie de l’ouvrage s’attache à mettre en évidence les conflits de la responsabilité (Yves Clot) suscités par l’émergence de revendications affirmées en faveur d’une plus grande autonomie en contradiction avec la multiplication et le renforcement des pressions émanant des clients, des supérieurs, voire des collègues. Cela suppose d’instaurer le dialogue sur la qualité de vie au travail pour cibler conjointement l’amélioration de la performance et de la santé au travail. Comme le montre, l’expérimentation conduite à l’usine Renault de Flins sous l’égide du laboratoire de psychologie du travail du CNAM, la coopération même conflictuelle permet de transformer l’organisation du travail tout en renouvelant le dialogue social (Jean-Yves Bonnefond). La réflexion sur la responsabilisation peut conduire à un rééquilibrage entre verticalité et horizontalité, même au sein d’entreprises comme Michelin, doté d’une forte identité productive forgée par son propre système, le Michelin Manufacturing Way (Bertrand Ballarin). Si l’industrie du futur ambitionne de renouveler les outils de production par la voie d’une politique déterminée de modernisation incluant des robots, cela suppose de repenser le travail au plan ergonomique des activités, en favorisant la représentation des sciences humaines du travail au sein d’instances pilotes de ce changement, notamment pour développer un cadre négocié d’interaction avec les humains dans la conception de robots collaboratifs (Flore Barcellini). En effet, les sciences humaines du travail ont montré que la prise de responsabilité humaine s’écartant des règles formelles en développant des capacités d’arbitrage, peut s’avérer salvatrice, comme l’a encore récemment montré la catastrophe nucléaire de Fukushima (Pierre Falzon). De ce point de vue, l’enseignement proposé dans les écoles de management se limitant souvent à la diffusion d’une panoplie de recettes et de boîtes à outils extrapolées de quelques cas-types prépare médiocrement à la gestion des risques en univers incertain. L’analyse menée par Brigitte Nivet révèle la superposition de modèles contradictoires engendrant le malaise au sein de la population des cadres qui ne disposent pas d’espaces d’expression adaptés pour débattre des difficultés de management. La figure de l’entreprise « libérée » du management classique fait donc l’objet de réactions fortement contrastées soulignant que la multiplicité des anecdotes ne suffit pas à masquer le flou méthodologique dans la conduite du processus de libération des énergies, et que la liberté ne peut s’exercer en entreprise que de manière fortement conditionnée (Dimitri Peplé & Isabelle Magne). En témoigne les conclusions de l’atelier sur l’engagement, qu’il soit individuel ou collectif, qui conclut sur l’ambivalence entre sens donné à l’action et levier de manipulation à l’usage des managers (Jean-Michel Saussois).
La troisième partie de l’ouvrage centre le propos sur les nouvelles formes de travail et d’emploi à l’heure du numérique : que nous apprennent les algorithmes sur les transformations du travail ? Selon Isabelle Berrebi-Hoffmann, les entreprises usant d’algorithmes propriétaires déployés à l’échelle mondiale s’affranchissent des accords nationaux de régulation du travail tout en captant les marchés de secteurs professionnels où le travail est régulé. L’impact de « l’intelligence artificielle » est d’autant moins prévisible que l’essentiel des algorithmes régissant l’économie des plates-formes numériques ne sont pas accessibles aux instances d’évaluation publique. Face à ces évolutions, émerge une action citoyenne autour de trois thèmes : l’équité, la transparence et la responsabilité des algorithmes, réclamant une régulation sur les algorithmes pour que la société civile puisse en contrôler les usages. La place du travail dans l’économie des plates-formes numériques, analysée par Sophie Bernard, illustre la distance avec les conditions régissant le travail au sein des processus de production classiques : faiblesse des rémunérations, dépassements d’horaires et asservissement aux fluctuations de la demande. Même si ces conditions varient d’une plate-forme à l’autre, l’absence de régulations commune à ces organisations numériques rend très difficile le contrôle des relations entre les commanditaires et les mandatés, délibérément conçues pour échapper au cadre salarial. Une enquête menée auprès des chauffeurs de VTC (Sophie Bernard) montre que ceux-ci cumulent les inconvénients des statuts d’indépendant et de salarié avec une forte dépendance envers Uber qui les intègre de facto à un sous-salariat déguisé. Ainsi, les tentatives de définition de nouvelles formes de travail et d’emploi (Louise Fauvarque-Gobin) s’avèrent fondées sur des dénominations floues et des réalités mouvantes. Selon Myriam Eldaya, une solution technique fondée sur la blockchain contribuerait à assurer l’autonomie des travailleurs des plates-formes numériques et à rendre obsolète la question de la requalification de ces relations en contrat de travail. Qu’il nous soit permis d’en douter car cela supposerait de forger des régulations adéquates du travail au plan international. Les mutations du travail remettent en cause la juxtaposition entre vie professionnelle et vie personnelle pour exiger désormais une articulation sur des séquences temporelles plus étendues, tout au cours de la vie : une enquête de la CFDT montre que 70% des cadres travaillent à leur domicile le soir et le week-end. L’idée d’une société du libre choix défendue par Gösta Rehn à la tête du Département de la main d’œuvre et des affaires sociales de l’OCDE au cours des décennies 1960 et 1970 semble refaire surface avec la récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel donnant la primauté au compte personnel de formation (Jean-Yves Boulin). Pour ce faire, il faut concevoir de nouvelles structures d’accueil pour accompagner les mutations dans la division du travail et l’émergence de nouveaux métiers à l’ère de la transition numérique (Jean-Luc Molins). Cela suppose d’inscrire définitivement la formation comme un processus continu tout au long de la vie, permettant au « vrai travail » de s’émanciper des réalités du travail réel. De telles tentatives se heurtent au flou entretenu autour de la notion de compétences : la reconnaissance des compétences acquises permet-elle d’échapper à la dictature du diplôme ou bien n’est-elle que le paravent pour cacher la tentation des entreprises d’assujetir la formation continuée à la relation de travail pour garantir un meilleur contrôle ? La validation des acquis de l’expérience en validant ces compétences dans le cadre d’un processus de formation-qualification professionnelle doit permettre aux individus et aux entreprises de dépasser ce dilemme (Sabrina Labbé & Naïma Marengo) : en France, la loi Rebsamen de 2015 a rendu la gestion prévisionnelle des emplois et compétences obligatoire et la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel constitue un levier supplémentaire. Ces dispositifs législatifs ne couvrent cependant pas tous les besoins puisque le rapport Automatisation, numérisation et emploi du Conseil d’orientation pour l’emploi souligne que la numérisation nécessitera l’acquisition de nouvelles compétences.
La quatrième partie examine quelles sont les nouvelles régulations nécessitées par la transition vers une économie numérique, y compris au plan international. Repenser le droit du travail à l’aune des mutations technologiques suppose de réfléchir conjointement l’exercice du pouvoir économique et la protection sociale, y compris dans leurs dimensions systémiques au plan mondial. Cela suppose pour les partenaires salariés comme pour les employeurs la mise en œuvre concrète de véritables droits participatifs à la gestion de l’entreprise mais aussi à celle du système de protection social (Josépha Diringer). En effet, l’économie de l’intermédiation numérique instaure des rapports de travail où l’exercice du pouvoir économique est dilué. Ainsi, le droit français tente de mieux définir les liens de subordination entre les intermédiaires numériques et leurs sous-traitants, prestataires soient-disant « indépendants » : la loi du 8 août 2016 inscrit dans le droit la responsabilité sociale des plates-formes lorsqu’elles déterminent « les caractéristiques de la prestation fournie ou du bien vendu ou fixe son prix ». En outre, la jurisprudence européenne reconnait également aux travailleurs des plates-formes la possibilité de négocier collectivement les tarifs de leurs prestations (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2014). Au plan multilatéral, l’Organisation internationale du travail (OIT) constitue le cadre incontournable pour refonder sur le droit la protection des travailleurs, mise en question par les pratiques des plates-formes d’intermédiation. En effet, selon Valérie Van Goethem du Bureau international du Travail (BIT), les conventions de l’OIT accordent en pratique une protection étendue aux formes de travail atypiques, en particulier sa Recommandation 198 opposant le principe de la prépondérance des faits à la qualification fictive des relations du travail. Selon Xavier Beaudonnet, coordinateur des conventions du travail au BIT, les normes de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation syndicale (Conventions 87 et 98) s’appliquent à tous les travailleurs qu’il soient salariés ou indépendants, à l’exception possible des forces armées et de police ou des fonctionnaires d’État. Pour les travailleurs des plates-formes numériques, elles constituent un socle suffisamment robuste pour appuyer leurs revendications nationales. Ainsi, en 2017, la législation irlandaise a été amendée pour reconnaître aux journalistes free-lance et aux doubleurs leur droit à négocier collectivement. Cependant la transcription de ces normes dans le droit national et la jurisprudence sont loin d’être effectives : en France par exemple, pour le droit de grève, la loi El Khomri reconnait seulement l’exonération de responsabilités en cas de cessation d’activité concertée aux travailleurs des plates-formes numériques mais n’interdit ni le lock-out, ni les discriminations, ni la main d’œuvre de remplacement. Un autre modèle de régulation existe depuis les années 80 : ce sont les accords transnationaux d’entreprise (Mathilde Frappard). Cependant, ils relèvent de la seule volonté des employeurs, aucune réglementation contraignante n’existant au niveau tant européen qu’international. Ces accords transnationaux sont conclus essentiellement par des entreprises européennes, en particulier allemandes ou françaises, reprenant les principes directeurs de l’OCDE rédigés à l’intention des multinationales et ceux des Nations-Unies dans la décennie 1980 sur les droits syndicaux, l’égalité des chances et l’abolition du travail des enfants. Depuis, 2011, leur révision a permis d’introduire des thématiques comme la santé et la sécurité au travail, les restructurations, la formation, la qualité de vie au travail et récemment le télétravail. Cependant, leur capacité à protéger les droits des travailleurs des plates-formes numériques demeurent limitées selon Konstantinos Papadakis du BIT, en particulier du fait leurs lacunes en matière de représentativité : du côté des entreprises, les principaux fournisseurs de certaines chaînes de valeur en sont souvent exclus ; du côté des salariés, dans certains pays, les employés ne peuvent adhérer aux fédérations syndicales internationales signataires.
La cinquième partie tente de dresser un bilan des politiques publiques conduites pour accompagner le développement économique territorial. Pour Olivier Bouba-Olga, trouver une voie alternative à la métropolisation supposerait de susciter des « arrangements locaux » entre acteurs publics et privés, comme au sein de la Communauté de Vitré (Pierre Méhaignerie) qui a procédé à un allègement de charges pour attirer les entreprises industrielles mais aussi créé un guichet unique pour la formation et l’emploi, accessible aux demandeurs comme aux employeurs. Pour Frédéric Rey, cela passe par une volonté de réappropriation territoriale de certains secteurs de syndicalisation, qu’illustre la tentative de la CFDT de s’implanter durablement dans le tissu des petites entreprises. L’économie sociale et solidaire (ESS) constitue un autre terrain sur lequel s’expérimente de nouvelles formes d’emploi, du « travail flexibilisé » déployé par sa financiarisation sur orbite du néolibérale au « travail réparé » organisé autour de communautés élaborant un nouveau mode coopératif de régulation localisée de l’économie (Hervé Dafalvard), telles que la « P’tite Coop » de Ligreville (Sabrina Labbé) ou la coopérative d’activité et d’emploi Crescendo, membre du réseau « Coopérer pour entreprendre » regroupant plus de 8 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros. Les territoires « zéro chômeur de longue durée », initiative d’ATD Quart-Monde en partenariat avec plusieurs acteurs de l’ESS, sont déployés pour cinq ans sur une dizaine de communes comptant entre 5 000 et 10 000 habitants. Les « fab labs » de Gonesse et de Montreuil illustrent les potentialités du numérique pour la réinsertion sociale des jeunes en difficulté : ces tiers-lieux pédagogiques permettent à certains jeunes de recouvrer leur pouvoir d’agir via la motivation du « learning by doing » et leur capacité de s’inscrire socialement dans une activité économique (Vivien Roussel). Cependant, les métiers du numérique ne sont pas accessibles à tous les jeunes de banlieue même si la fragmentation du labeur digital peut absorber les capacités développées par certains d’entre-eux.
L’ouvrage se conclut sur un débat autour du revenu de base inconditionnel (Danielle Kaisergruber). Pour certains, cette « utopie mobilisatrice » permet de penser concrètement la déconnexion entre revenu et travail, une réalité vécue en France par 2 millions d’actifs percevant l’allocation de chômage et 700 000 retraités auto-entrepreneurs, sans compter 2,6 millions de foyers bénéficiaires de la prime d’activité.
Plutôt que de disséquer un travail confit dans le salariat et l’attente du plein-emploi, l’ouvrage a le mérite d’explorer le tourbillon des ajustements concrets qui composent le flux et le reflux des activités productives, selon une grande variété d’approches combinant l’expertise pluridisciplinaire de psychologues, d’ergonomes, de praticiens des ressources humaines, d’économistes et de sociologues pour analyser comment les collectifs de production innovent pour reprendre la main sur leur travail et s’adapter aux mutations technologiques, en particulier celles que véhicule la transition numérique. Les « mouvements » du travail se caractérisent par la multiplication de zones grises où, pour les experts, les modes de management (hiérarchies « plates », salariés « autonomes », entreprises « libérées »), les organisations (plateformes, fab labs, ESS), les technologies (« intelligence » artificielle, robotique), les rythmes d’activité (horaires décalés, frontière professionnelle/domestique) demeurent difficiles à saisir dans leurs impacts économiques et sociaux, soulevant incidemment des questions juridiques complexes. Le « taylorisme connecté » qui émerge de ces réalités mouvantes témoigne d’une subordination accrue aux systèmes d’information qui imposent de plus en plus leur syntaxe réductionniste aux processus productifs, le secteur hospitalier illustrant cette dérive par une nomenclature des actes régissant à l’excès le travail des soignants. Cependant, malgré un dédale de recompositions suscitées par la transition numérique, des alizés persistent en faveur de l’autonomie individuelle contribuant à gonfler les voiles de la revendication. Le syndicalisme CFDT devra continuer à naviguer au plus près.