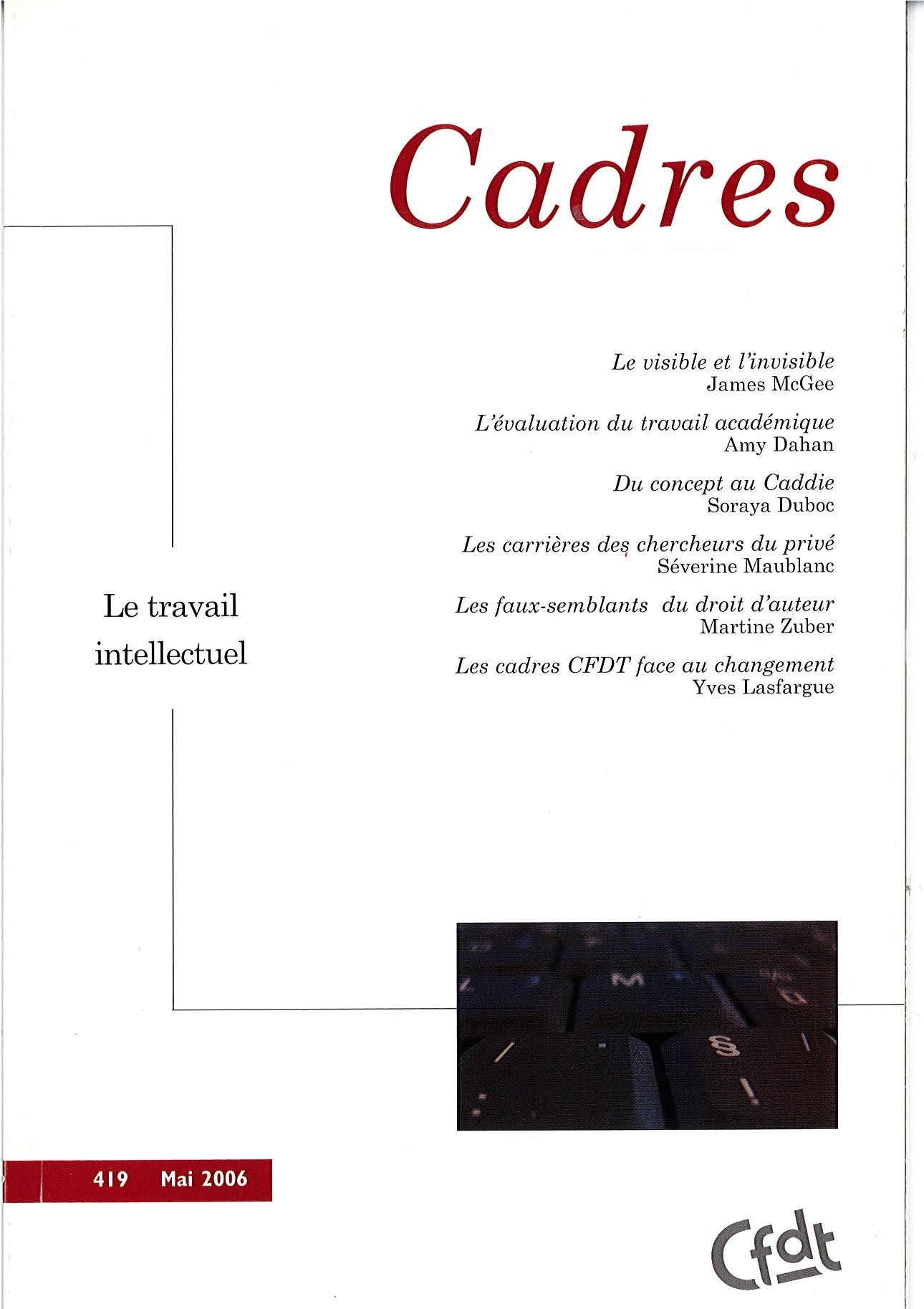Quoi de plus riche que l’histoire d’une revue pour se replonger dans les débats d’une époque ? Et tout spécialement lorsqu’il s’agit d’Esprit, revue parmi les plus anciennes (depuis 1932) et les plus attachées aux valeurs du pluralisme au sein même d’une équipe rédactionnelle remarquable de diversité.
Goulven Boudic, dans un ouvrage passionnant consacré à la période 1944-1982, retrace la manière dont est analysée, pensée et discutée à Espritla situation nationale et internationale dans un contexte de mutation radicale. Si chacun des directeurs successifs (Emmanuel Mounier, Albert Béguin, Jean-Luc Domenach, Paul Thibaud) imprime sa marque propre à la réflexion, on est frappé, avec l’auteur, du constant souci d’échapper au confort de l’idéologie. D’où l’évolution de positions intégrant au fur et à mesure, et non sans conflits, les enseignements de l’histoire. A la séduction communiste des lendemains de guerre ne tarde pas à succéder une posture de plus en plus critique quant à la vraie nature du système soviétique. Esprit sera d’ailleurs l’une des premières revues à faire du totalitarisme une préoccupation de premier plan. De même voit-on évoluer son point de vue sur l’Europe fédérale initialement soupçonnée de faire le jeu américain avant d’apparaître comme un facteur de rééquilibrage dans le jeu des blocs. La question de la décolonisation n’est pas jugée moins décisive. Elle fait l’objet de positions aussi novatrices que courageuses sur fond d’« éthique de détresse » (Ricœur). « Penser le politique sans être du politique », selon le mot de Mounier, assure une liberté de ton sans égale qui vaudra à la revue d’avoir maille à partir autant avec le Parti communiste qu’avec la police française ou le Vatican qui envisagera sa mise à l’index en raison de ses opinions sur l’école privée ou sur le dossier des prêtres-ouvriers. Bref, Esprit irrite les institutions qui fonctionnent au conformisme quand l’urgence est à l’invention de solutions audacieuses.
Les transformations de la société française sont elles aussi au cœur de sa réflexion. C’est dans ses pages que naît, en 1953, le beau débat encore si actuel autour de la « civilisation du travail » appelée de ses vœux par Henri Bartoli dans une perspective de « réhumanisation » quidoitbeaucoup au marxisme et à Georges Friedmann. L’idée, également défendue par le Père Chenu, est de le restaurer dans sa dignité créatrice non sans risque d’un « pan-travaillisme » dénoncé par Ricœur qui fait valoir, dans un bel article, les droits de la parole en tant qu’elle échappe à la stricte utilité. L’homme n’est pas qu’un travailleur. Et c’est ce que confirmera le mouvement de « modernisation » des années 1960 qui modifie la structure de la société et libère de nouvelles aspirations qui éclateront en gerbe en mai 68. Ce dernier épisode ne saurait masquer que l’heure n’est plus à la rupture révolutionnaire, encore d’actualité à la Libération, mais au réformisme conséquent attaché à tracer sa voiedans « l’entre-deux » delajustice et de la liberté. De là l’intérêt nouveau porté à la question de la « participation » au pouvoir à tous les niveaux, de la « nouvelle citoyenneté » et de l’autogestion si chère à la deuxième gauche dont Esprit constitue l’un des grands creusets. De là également le souci de soumettre la société de consommation à la critique d’un nouveau matérialisme qui pour être plus démocratique n’en est pas moins oublieux du spirituel comme forme de légèreté dans le détachement et la dépossession.
Sur tous ces fronts, et sur bien d’autres qui se découvrent à la lecture du beau livre de Goulven Boudic, se manifeste l’infinie fécondité du pari de Mounier de créer un espace de « démocratie intellectuelle » qui poursuit aujourd’hui encore son œuvre nécessaire et auquel nous devons tant.