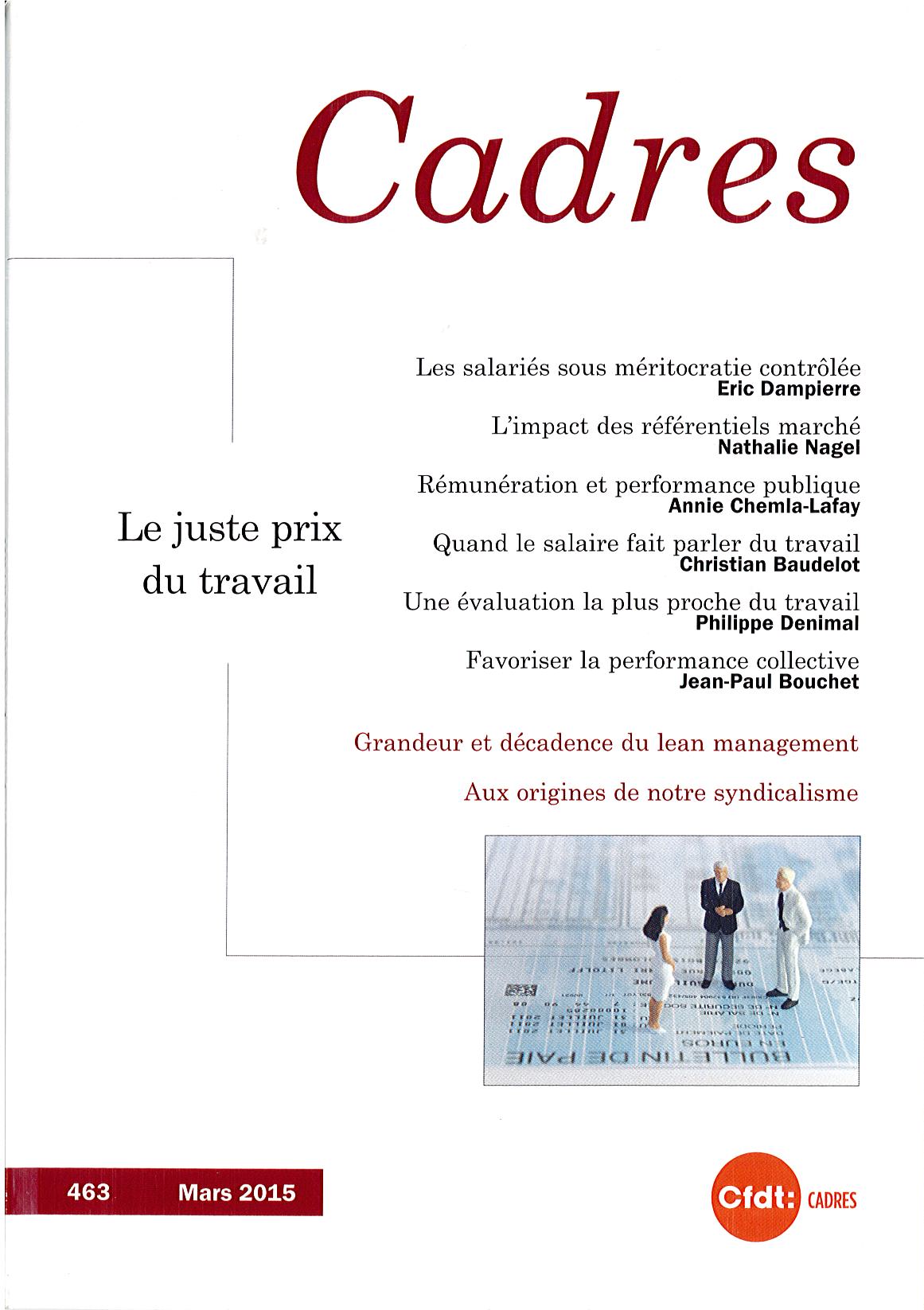Des huit chapitres de l’ouvrage, sept sont de fait consacrés à la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), la spécialité des auteurs, qui leur ont consacré, ensemble ou séparément, de nombreux travaux qui font référence, notamment Mythes et réalités de l’entreprise responsable il y a dix ans. « Le mouvement actuel de RSE, qui s’est constitué à partir de couches apportées par de multiples acteurs, est composé de discours, de pratiques, de politiques et de normes sans véritable cohésion » et que l’on ne peut comprendre la RSE « sans étudier les tensions entre les trois principaux types d’acteurs en constante interaction » : les entreprises, les sociétés civiles organisées et les puissances publiques. « En focalisant sur les responsabilités de l’entreprise envers la société, nous visons à réinterroger, voire à repenser, la nature et les finalités de l’entreprise en rapport avec l’intérêt général ».
L’entreprise, qui « n’a jamais vraiment été pensée par les différentes sciences sociales », ne se résume pas « à l’aventure individuelle de son dirigeant ou aux préoccupations de ses actionnaires ». Elle est « encastrée dans la société, soumise à ses règles de droit, et elle utilise des ressources qui sont puisées dans le patrimoine commun de l’humanité ». Dans le contexte de l’affaiblissement des États-nations, l’entreprise « apparaît à la fois utile et prédatrice » et, pour recueillir une acceptabilité sociale, elle doit se préoccuper des impacts de son action sur son environnement social et naturel, en tenir compte dans sa stratégie et sa gestion et en rendre compte aux tiers concernés.
Les auteurs soulignent que le rapport entreprise / société a connu trois phases aux États-Unis : le business ethics (appel à l’éthique personnelle du chef d’entreprise pour qu’il se livre au mécénat et à la philanthropie), puis le refus de tout ce qui n’est pas la recherche du profit maximal (les auteurs notent que Friedman ne récuse pas les actions charitables de l’entreprise mais les admet à condition qu’elles accroissent le profit) et le business case (c’est la conception utilitariste : la RSE apporte un avantage compétitif, ce qui n’a jamais été prouvé). L’Europe s’empare de la RSE dans les années quatre-vingt-dix et la fait évoluer. La convergence des performances sociales et financières des entreprises reste néanmoins « la quête du Graal ».
L’ouvrage, dense, ne se résume pas. On notera que les auteurs considèrent que la distinction traditionnelle entre soft et hard law n’est pas (ou plus) opérationnelle. La théorie des parties prenantes leur parait insuffisante et ils préfèrent le concept de bien collectif (ou bien public, local ou mondial) : les entreprises bénéficient des biens publics dont elles sont redevables à la société. Il appartient aux autorités politiques de définir le socle des biens collectifs qui ne doivent pas faire l’objet d’une appropriation privée et doivent rester accessibles à tous. Les grandes entreprises sont souvent sollicitées pour agir à la place des États en faveur de l’intérêt collectif mais ce n’est pas leur rôle dans un contexte de concurrence. La responsabilité sociale ignore la responsabilité fiscale, alors que la contribution aux finances publiques est centrale pour l’intérêt collectif et que les grandes entreprises multinationales payent proportionnellement moins d’impôts que les PME...
Dans le chapitre « Vers une conception renouvelée de l’entreprise », les auteurs considèrent qu’il existe une différence de nature entre la mégafirme (« puissance financière privée mondialisée ») et l’entreprise entrepreneuriale, même si l’illusion d’une unité des formes productives marchandes est entretenue par les groupements professionnels tels que le Medef. Notant que le critère de gouvernance prend une place croissante dans les analyses extra-financières, à côté des critères environnementaux et sociaux, les auteurs affirment que cela « assure une légitimation réciproque entre la finance mainstream et l’investissement socialement responsable ».
Élargissant la théorie de l’agence (les actionnaires mandatent les dirigeants pour veiller à leurs intérêts) à d’autres parties prenantes, les auteurs envisagent, plutôt que la consultation ou le dialogue avec les parties prenantes, la participation de celles-ci à la gouvernance. « La vision d’un dirigeant, agent des stakeholders plutôt que des seuls shareholders, devrait conduire à la constitution de conseils de surveillance ou d’administration où les représentants des salariés mais aussi des représentants des autres parties prenantes siégeraient au même titre que les actionnaires ». Reste à savoir comment choisir les représentants des autres parties prenantes.