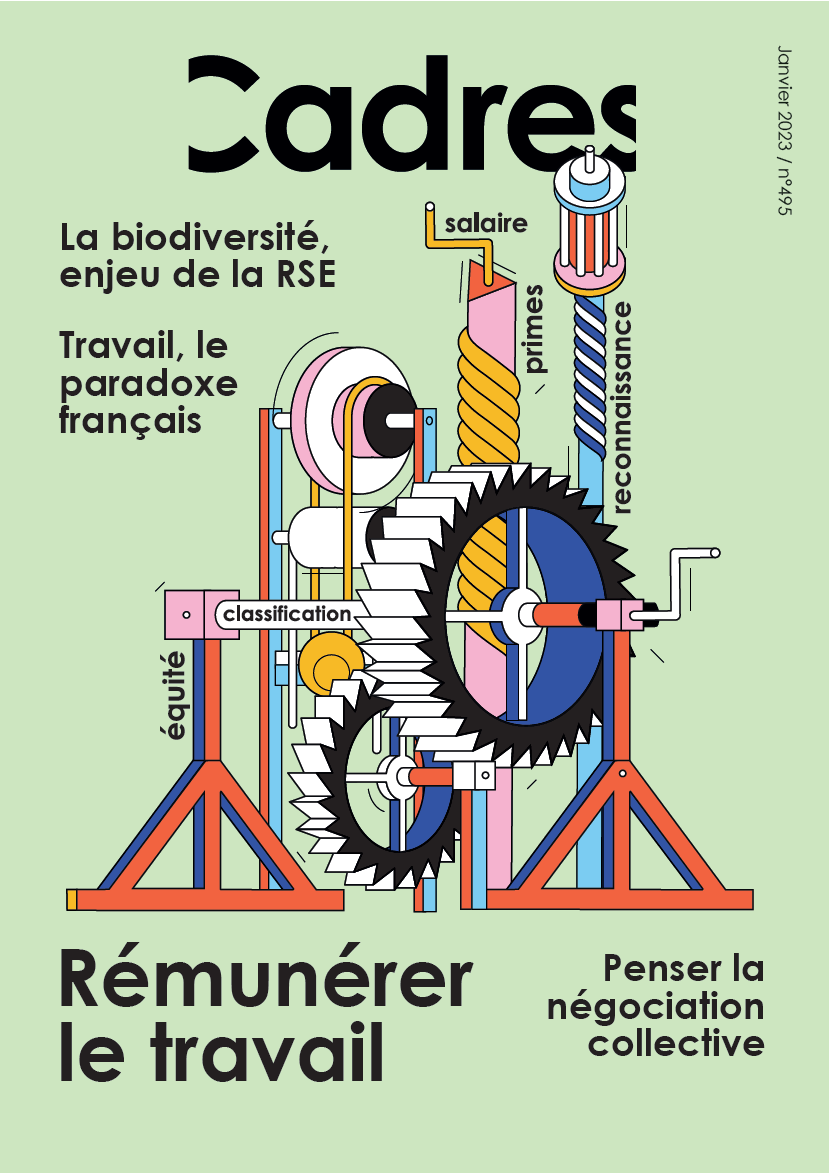Prélude à la 15e Conférence des parties (COP 15) sur la biodiversité qui se tiendra du 7 au 19 décembre prochain à Montréal, le communiqué de presse de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) publié au mois de juillet alerte sur l’érosion planétaire de la biodiversité (en mer, par exemple, les stocks mondiaux de poissons sauvages s’épuisent), pressant les Etats-membres d’adopter des politiques susceptibles d’y remédier.
Le déclin des espèces
En Europe, les dernières extinctions de mammifères dataient du XVIIe siècle pour l’auroch et du XVIIIe pour le pika, un cousin sarde du lapin… Cependant, depuis 2015, trente-six espèces ont complètement disparu en Europe, dont neuf espèces de corégone[1], un mollusque d’eau douce[2] et la Violette de Cry[3]. Depuis le XVIe siècle, on estime qu’au moins 187 espèces aviaires ont disparu, une sur huit étant désormais menacées d’extinction. Ce phénomène va s’accentuant : le rapport quadri-annuel de BirdLife International, publié en septembre, constate que 49% des espèces d’oiseaux sont en déclin, alors que le précédent rapport de 2018 estimait ce taux à 40%. Depuis 1970, ce sont 2,9 milliards d’oiseaux qui ont disparu en Amérique du Nord, soit 29% des oiseaux. En Europe, les chiffres sont tout aussi inquiétants : depuis 1980, 600 millions d’oiseaux ont été éliminés, avec des espèces communes comme le martinet, la bécassine ou le corbeau freux qui désormais s’acheminent vers l’extinction. Les oiseaux des zones rurales paient le plus lourd tribut : 57% d’entre eux ont disparu du fait de la mécanisation, des intrants agricoles et des nouvelles mises en culture de terres. En Australie, 43% des oiseaux marins parmi les plus abondants ont connu un déclin entre 2000 et 2016. Conséquence des températures estivales de 2022, les gorgones rouges[4] du nord de la Méditerranée viennent de subir une éradication massive de la plupart de leurs colonies des aires sous-marines inférieures à 30 mètres de profondeur. À terme, ces populations de gorgone ainsi que les écosystèmes qui en dépendent, seraient menacées par la recrudescence de tels événements météorologiques[5]. Alerte similaire pour la posidonie, une herbe marine qui pourrait disparaître des îles Baléares d’ici à 2040[6].
Parmi les facteurs de ce déclin, l’augmentation des feux de forêt a affecté des habitats jusqu’ici préservés. Menaçant les espèces endémiques, les épisodes plus fréquents de vagues de chaleur, de sécheresses et d’inondation contribuent à accélérer ce phénomène d’extinction. En se dissolvant dans les océans, le CO2 émis par l’activité humaine contribue à l’acidification de l’eau, nuisible à certains organismes marins comme les coraux.
Figurant parmi les créatures les plus étudiées de notre planète, le groupe des oiseaux joue un rôle déterminant dans les chaînes alimentaires de nombre de réseaux trophiques : certains se nourrissent d’insectes, d’autres dispersent les graines, éliminent les déchets organiques, ou contribuent au transfert de nutriments entre océans et terres émergées. Aussi, leur disparition a-t-elle de nombreuses répercussions. Réciproquement, l’état du groupe des oiseaux, véritables sentinelles de la nature, nous renseigne sur la santé de l’environnement en particulier par le niveau de leurs stocks populationnels.
L’impact sur notre écosystème
La biodiversité de l’environnement naturel rend des services écosystémiques importants pour l’agriculture, comme la pollinisation. À l’échelle des paysages, une meilleure gestion des interactions écologiques permet de développer une agriculture plus résiliente. La biodiversité des sols est déterminante pour le bouclage des cycles du carbone de l’azote, du phosphore et de l’eau.
L’Intergovermental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), créée le 21 avril 2012, est une institution multilatérale en charge notamment d’évaluations « scientifiquement crédibles, indépendantes et actualisées des connaissances disponibles afin de prendre des décisions mieux informées et des mesures aux niveaux local, national, régional et international ». Selon le premier rapport mondial de l’IPBES en 2019 sur la biodiversité et les services écosystémiques, les trois premiers facteurs ayant des incidences directes sur la biodiversité naturelle sont l’utilisation des terres et des mers, l’exploitation directe des organismes vivants et les changements climatiques. Parmi les facteurs de pollution responsables, les produits phytosanitaires agissent comme un facteur aggravant la dégradation des écosystèmes naturels, classé au quatrième rang devant les espèces envahissantes. L’expertise scientifique collective d’INRAE et de l’Ifremer concernant l’impact des produits phytosanitaires sur la biodiversité confirme que ces produits « sont impliqués dans le déclin des populations d’invertébrés terrestres (comme les insectes pollinisateurs et les coléoptères prédateurs de certains ravageurs des cultures), d’invertébrés aquatiques et d’oiseaux communs »[7]. Les changements dans l’utilisation des terres se caractérisent par un accroissement de plus de 80 % des terres cultivées au cours du vingtième siècle. Dans un récent rapport sur la lutte contre la désertification, l’ONU estime qu’entre 20 et 40% des terres émergées de la planète sont dégradées par les activités humaines. Pour les écosystèmes marins, les études scientifiques confirment les impacts directs et indirects à l’échelle des individus (sensibilité accrue des huîtres et des dauphins aux virus, disparition d’habitats essentiels pour certains invertébrés marins, etc.), sans qu’on puisse établir actuellement que ces impacts s’étendent à l’échelle des populations ce qui affecterait leur biodiversité.
Le dernier rapport IPBES sur les différentes valeurs de la nature et leur estimation, signé par les experts délégués de vingt-deux pays différents et approuvé le 9 juillet dernier par 139 États-membres, alarme sur un biais préoccupant dans la gestion de notre environnement : dans le monde entier, profits et croissance économique sont privilégiés par des gouvernances de court terme alors que de multiples valorisations de la nature demeurent négligées par les décideurs politiques. Les spécialistes de la conservation établissent un lien entre paradigme de croissance et perte de biodiversité, fusse-t-il implicite : généralement, les politiques de préservation ou de restauration de la biodiversité considèrent la croissance économique comme une nécessité[8].
La gestion de la biodiversité
Le nouvel objectif mondial « 30x30 » en faveur de la biodiversité, soumis pour la COP15 de Montréal, a l’ambition de porter à 30% des terres et 30% des océans la part des aires protégées d’ici 2030 contre 17% de surface terrestre et 7% de surface maritime actuellement. Cette ambition, étroitement imbriquée aux enjeux mondiaux de sécurité alimentaire et de santé, a été défendue lors de l’ouverture à Charm el Cheikh de la 27e Conférences des parties sur le climat (COP 27) par la France qui copilote, avec le Nicaragua et le Royaume Uni, le volet « océans » de la Coalition pour la Haute Ambition pour la Nature et les Peuples. Selon Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, « la protection de la nature et la lutte contre le changement climatique vont de pair ». L’objectif « 30x30 » est désormais soutenu par au moins 90 pays.
D’après les responsables de recherche au Cirad, à INRAE et à l’IRD, une telle ambition n’est réalisable que si les politiques actuelles de gestion de la biodiversité tirent un meilleur parti des connaissances scientifiques acquises pour imaginer les agricultures et les systèmes alimentaires de demain[9]. Présentée lors de la COP 21 en 2015 à Paris, l’initiative « 4 pour mille »[10] de stockage du carbone organique dans les sols, afin d’atténuer le changement climatique tout en en améliorant la sécurité alimentaire, passe par une restauration du microbiote des sols cultivés.
Paul Leadley, professeur d’Écologie des populations à l’université Paris Saclay, co-auteur d’un rapport d’une cinquantaine de chercheurs sur l’extension des aires protégées, précise : « Bien faite, elle peut être très importante mais reste largement insuffisante pour stopper la perte de biodiversité ». Appelant à arrêter les subventions néfastes pour la biodiversité, ces scientifiques réclament l’abandon de certains projets, comme la restauration des aides à la construction de navires de pêches dans l’Union européenne, ou l’utilisation dérogatoire de certains biocides en agriculture comme les néonicotinoïdes[11], pour protéger les intérêts particuliers de filières économiques aux pratiques contestées. D’ailleurs, des alternatives aux produits phytosanitaires existent : selon les travaux de chercheurs de l’Inra[12], une adoption plus systématique de la lutte intégrée contre les ravageurs[13] des grandes cultures conduirait à une réduction de 30% dans l’usage de pesticides sans affecter les revenus des agriculteurs, même si le niveau des productions en serait réduit.
Plusieurs ONG du réseau Natura 2000 déplorent une "course à la désignation de nouvelles aires protégées, au détriment de la mise en place de mesures de gestion appropriées". Car, selon France Nature Environnement, « seules 4 % des aires marines classées disposent aujourd'hui d'une protection forte, contre un objectif de 10% qui devait être atteint en 2022 ». Très peu protégées, les autres aires marines classées souffrent des conséquences de la surpêche pratiquée au moyen de techniques destructrices.
À l’ère de l’anthropocène où les sociétés humaines se sont imposées de façon irrépressible comme un facteur influant l’évolution des systèmes biophysiques, la question des moyens affectés à la gestion de la biodiversité devient un impératif catégorique des sociétés les plus avancées au plan économique et social. Du fait de leur emprise et de leur impact sur l’environnement, les entreprises des économies développées doivent désormais réfléchir aux leviers instrumentaux susceptibles de limiter ces externalités négatives.
Une nouvelle politique RSE
En tant qu’acteur global de l’agroalimentaire, le groupe Danone a entamé une démarche RSE qui l’a conduit à adopter le statut d’entreprise à mission qui inscrit des objectifs sociaux, environnementaux et sanitaires dans ses statuts, accordant une importance stratégique à la biodiversité dans son rapport annuel 2020. Cependant, l’éviction récente d’Emmanuel Faber, ancien directeur financier succédant à son PDG Franck Riboud pour cumuler les deux fonctions, illustre sous la pression de fonds spéculateurs activistes la fragilité managériale des entreprises à mission cotées en bourse. Le changement de statut, conçu aussi dans ce cas d’espèce comme une stratégie de dissuasion contre les OPA hostiles, n’a pas suffi à protéger une gouvernance déstabilisée par des résultats inférieurs à ses concurrents, par l’appréciation boursière dépressive qui en a résulté, et in fine par une crise économique combinant choc de demande et choc d’offre provoqués par la pandémie de Covid 19. En l’espèce, cette péripétie souligne l’incomplétude de la loi PACTE promulguant en 2019 le statut d’entreprise à mission : la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises doit pouvoir s’appuyer sur de nouvelles règles d’évaluation de leurs performances économiques permettant de contrebalancer le primat de critères purement financiers. Une des clés de cette transition économique serait la fixation d’un coût de référence pour les équivalents-tonnes de CO2 émis qui permette de rééquilibrer la rentabilité des investissements « verts » par rapport au business as usual. La classification des activités vertes prévues par le nouveau cadre réglementaire européen parviendra-t-elle à s’imposer au niveau mondial ?
De façon stratégique, les entreprises doivent dépasser une conception purement instrumentale de la gestion de la biodiversité pour intégrer au sein des politiques de responsabilité sociétale d’entreprise les interactions entre biodiversité des écosystèmes et singularisme des sociétés humaines. Une première urgence est d’ancrer plus résolument les concepts de la gestion d’entreprise au sein du patrimoine naturel des écosystèmes en développant une comptabilité écologique susceptible de soutenir des perspectives de durabilité forte[14], ce qui suppose l’adoption de nouvelles normes comptables qui soient harmonisées au plan international.
L’accord sur un nouveau cadre mondial post 2020 pour protéger les écosystèmes n’est pas encore finalisé : la dernière réunion préparatoire de juin 2022 a enregistré « des progrès limités » selon Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention de l’ONU pour la diversité biologique (CDB). Les discussions achoppent sur le niveau des financements : le Gabon, représentant du groupe africain, l'Inde, le Pakistan, le Brésil rejoint par d'autres pays d'Amérique latine demandent aux pays développés au moins 100 milliards de dollars par an dans l’immédiat, puis 700 milliards de dollars par an en 2030 et au-delà, contre 200 milliards prévus dans le document de travail pour les pays en développement. Il faut espérer que les évolutions politiques intervenues récemment aux USA et au Brésil permettront de modifier cette donne. Cependant, si la dégradation des écosystèmes a été abondamment discutée au cours des deux semaines de négociation à Charm El Cheikh, l’accord final de la COP 27 sur le changement climatique ne mentionne pas la prochaine COP 15 sur la biodiversité dont l’objectif devrait être d’enrayer l’érosion.
[1] Un salmonidé victime de la surpêche, de l’eutrophisation des lacs et de l’étroitesse de son aire de répartition. [2] Graecoanatolica macedonica, un petit escargot d’eau douce endémique du lac Dorjan (situé à la frontière de la Grèce et de la Macédoine du Nord). [3] Fleur endémique au département de l’Yonne, disparue depuis 1950 à la suite de l’extension d’une carrière. [4] Espèce de corail emblématique de la Méditerranée, les gorgones rouges constituent des forêts sous-marines jouant un rôle essentiel pour la nourriture, l’abri et la nurserie de nombreuses espèces associées. [5] The effects of marine heatwaves on acute heat tolerance in corals. M. R. Marzonie Garrabou & al., Global Change Biology, 2022, https://doi.org/10.1111/gcb.16473. [6] Marine heatwaves drive recurrent mass mortalities in the Mediterranean Sea, J. Garrabou & al., Global Change Biology, 2022, https://doi.org/10.1111/gcb.16301. [7] Impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques : résultats de l’expertise scientifique collective INRAE-Ifremer | INRAE INSTIT. [8] Biodiversity Policy beyond Economic Growth, Otero I. & al., Conservation Letters 13 (4), 2020. [9] La biodiversité : enjeux et leviers pour la durabilité des agricultures et des systèmes alimentaires face au changement climatique Cultiver la biodiversité – cultiver la résilience. D. Bazile, T. Caquet et Y. Vigouroux, Congrès mondial de la nature, Union internationale pour la conservation de la nature, septembre 2021, 4 p. [10] L’Initiative internationale "4 pour 1000"- Les sols pour la sécurité alimentaire et le climat (4p1000.org) [11] La famille des néonicotinoïdes regroupe cinq molécules : la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaméthoxame, l’acétamipride et le thiaclopride. La loi française « Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » de 2016 a instauré l’interdiction des produits à base de néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. De façon dérogatoire, un arrêté de 2021 a autorisé provisoirement l'emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des néonicotinoïdes. Actuellement, seule l’acétamipride reste autorisée en Europe. [12] An economic analysis of the possibility of reducing pesticides in French field crops, F. Jacquet, J.-P. Butault, L. Guichard, 120th European Association of Agricultural Economists Seminar “External Cost of Farming Activities: Economic Evaluation, Environmental Repercussions and Regulatory Framework”, Chania, Crète, Grèce, 2-4 septembre 2010. [13] La lutte intégrée est une stratégie écosystémique de long terme qui se fonde sur la prévention à long terme basée sur une combinaison des techniques de lutte biologique et chimique intégrant les mécanismes naturels de régulation des populations de ravageurs. [14] La durabilité forte, conception promue par Herman Daly (1990), suppose que le stock de capital naturel ne doit pas diminuer. À l’opposé, la durabilité faible admet la substituabilité du capital naturel par d’autres formes de capital, qu’elles soient issues du développement économique (production) ou humain (éducation).