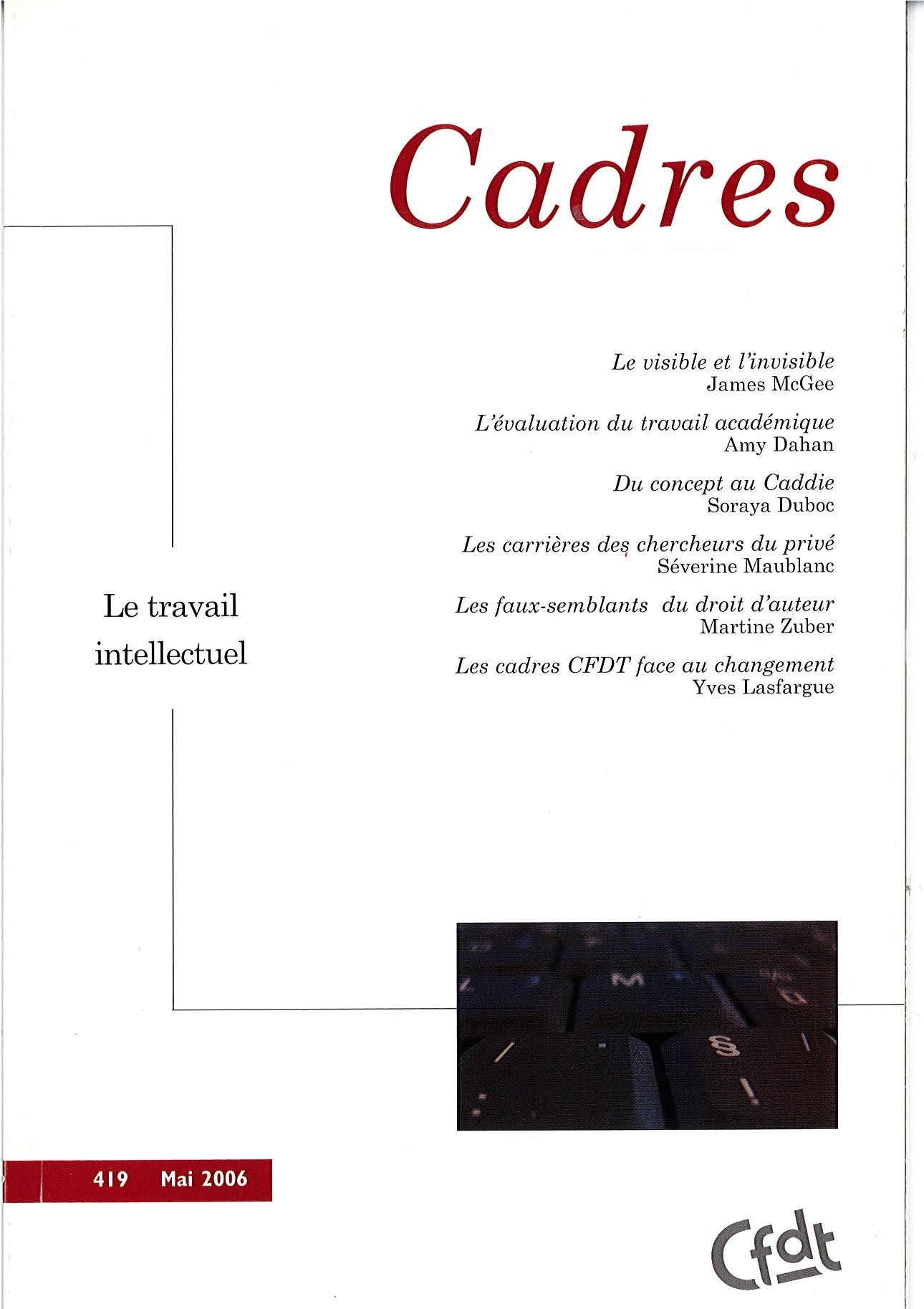Il ne s’agit pas ici de revenir sur le débat concernant le bien fondé du CPE par rapport à l’objectif affiché, la baisse du chômage des jeunes. De fait, rares ont été les économistes à soutenir la mesure. La plupart pronostiquaient, à l’instar de Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo, de faibles effets sur l’emploi et un impact avant tout en terme de dualisme accru du marché du travail. La crise du CPE offre plutôt l’occasion de s’interroger sur les conditions d’insertion professionnelle des jeunes. Au-delà de la mobilisation contre une mesure précise, le malaise exprimé renvoie sans doute à des problèmes profonds qui restent à régler.
L’insertion des jeunes est-elle, d’un point de vue global, comparativement plus difficile en France ? L’argument justifiant la proposition de loi reposait sur un diagnostic particulièrement alarmiste concernant l’insertion des jeunes dans notre pays : avec un taux de chômage de l’ordre de 23 %, il serait difficile de nier l’évidence. Pourtant, comme toujours, il faut être très prudent dans le maniement des statistiques, surtout lorsqu’on se livre à des comparaisons internationales.
Il faut souligner d’abord que si le taux de chômage des jeunes est aussi élevé dans notre pays, c’est avant tout parce que le taux de chômage global l’est aussi. Il faut en effet se focaliser sur le taux de chômage non pas en termes absolus, mais en termes relatifs – c’est-à-dire rapporté à celui de l’ensemble de la population active. Si on se livre à cet exercice, le diagnostic change : le rapport était en 2004 (derniers chiffres de l’OCDE dont on dispose) de l’ordre de 2,0 en France, un chiffre comparable à celui de l’Italie (2,2) mais aussi des Etats-Unis (2,1), et inférieur à celui constaté en Suède (2,7) et au Royaume-Uni (2,6). Seuls des pays où le système d’apprentissage joue un rôle important comme l’Allemagne (1,3) ou le Danemark (1,4) font nettement mieux.
De même, il faut rappeler que l’assertion selon laquelle « un jeune sur quatre est au chômage » est en toute rigueur fausse. Le taux de chômage se calcule sur la population active (soit en emploi ou au chômage). Or comme la majorité des jeunes (15-24 ans) est en formation et donc comptabilisée comme inactive, c’est seulement environ 8 % de cette classe d’âge qui est au chômage – proportion identique à celle que l’on retrouve en Italie, au Royaume-Uni ou en Suède.
Faut-il alors se réjouir, suivant le vieil adage « quand je me regarde, je m’inquiète, quand je me compare, je me rassure » ? En partie seulement. Car une partie du chômage des jeunes est « camouflée » en France. D’une part on sait qu’un certain nombre d’entre eux restent dans le système de formation (notamment à l’Université) pour échapper au chômage. D’autre part, plus que dans d’autres pays, les dispositifs de la politique de l’emploi jouent en France un rôle déterminant sur la marché du travail des moins de 25 ans : depuis 1995, chaque année, entre 30 % et 40 % des jeunes qui sont en emploi occupent un emploi aidé. On peut cependant penser qu’une partie de ces mesures (notamment l’apprentissage et les autres formations en alternance subventionnées) sont l’équivalent fonctionnel de l’apprentissage dans d’autres pays – qui assure, on l’a souligné, de bonnes performances en termes d’insertion des jeunes.
Les désajustements de la relation formation-emploi
Il faut en fait abandonner le point de vue global pour saisir les ressorts profonds de la crise de l’insertion.
Malgré la hausse considérable du niveau moyen de formation depuis le milieu des années 1980, 8 % des sortants du système éducatif n’ont pas de diplôme. Ils sont le plus souvent d’origine modeste, et cumulent les difficultés, la ségrégation spatiale corrélée à la ségrégation sociale accroissant les difficultés d’insertion. Si les jeunes concernés ont pu se retrouver dans les émeutes des banlieues, ils ne semblent cependant pas avoir été les premiers mobilisés dans le mouvement anti-CPE.
En revanche, ce sont les étudiants des universités qui se sont retrouvés en première ligne. On peut comprendre pourquoi : ce sont les premières victimes des effets pervers de la « démocratisation ségrégative » de l’enseignement que retrace Marie Duru-Bellat dans son ouvrage récent (cf. note de lecture p.89). Le gonflement des effectifs de l’enseignement supérieur – pratiquement un doublement au cours des vingt dernières années – s’est fait avant tout dans les filières les moins sélectives (à l’université plutôt que dans les grandes écoles) et aux débouchés les plus incertains. Il s’est accompagné d’une ségrégation sociale accrue : alors que la part des enfants d’ouvriers et d’employés stagnait voire diminuait dans les grandes écoles, elle augmentait dans les formations universitaires.
Les travaux du Cereq montrent bien les conséquences de ces évolutions en termes d’insertion.
D’une part, le taux de chômage des diplômés de deuxième et troisième cycle universitaire est supérieur à celui des Bac + 2 sélectifs (BTS, DUT), ou encore celui des sortants d’un Deug non validé supérieur à celui des titulaires d’un Bac professionnel et technologique ou même d’un CAP-BEP.
D’autre part, pour ceux qui s’insèrent, c’est souvent au prix d’un « déclassement » – c’est-à-dire l’occupation d’un poste de travail ne correspondant pas à leur niveau de formation.
De ces phénomènes peuvent résulter beaucoup de déceptions et même de souffrance sociale – et la crise du CPE en a sûrement été un symptôme. La déréglementation du marché du travail discriminatoire à l’encontre des jeunes n’est pas la réponse à apporter à des déséquilibres résultant d’une part de la pénurie globale d’emplois, d’autre part des dysfonctionnements de l’offre de formation. Si l’élévation rapide du niveau moyen de cette dernière a eu des aspects positifs indéniables, elle n’a pas été suffisamment contrôlée et accompagnée, notamment en termes d’orientation et de professionnalisation.