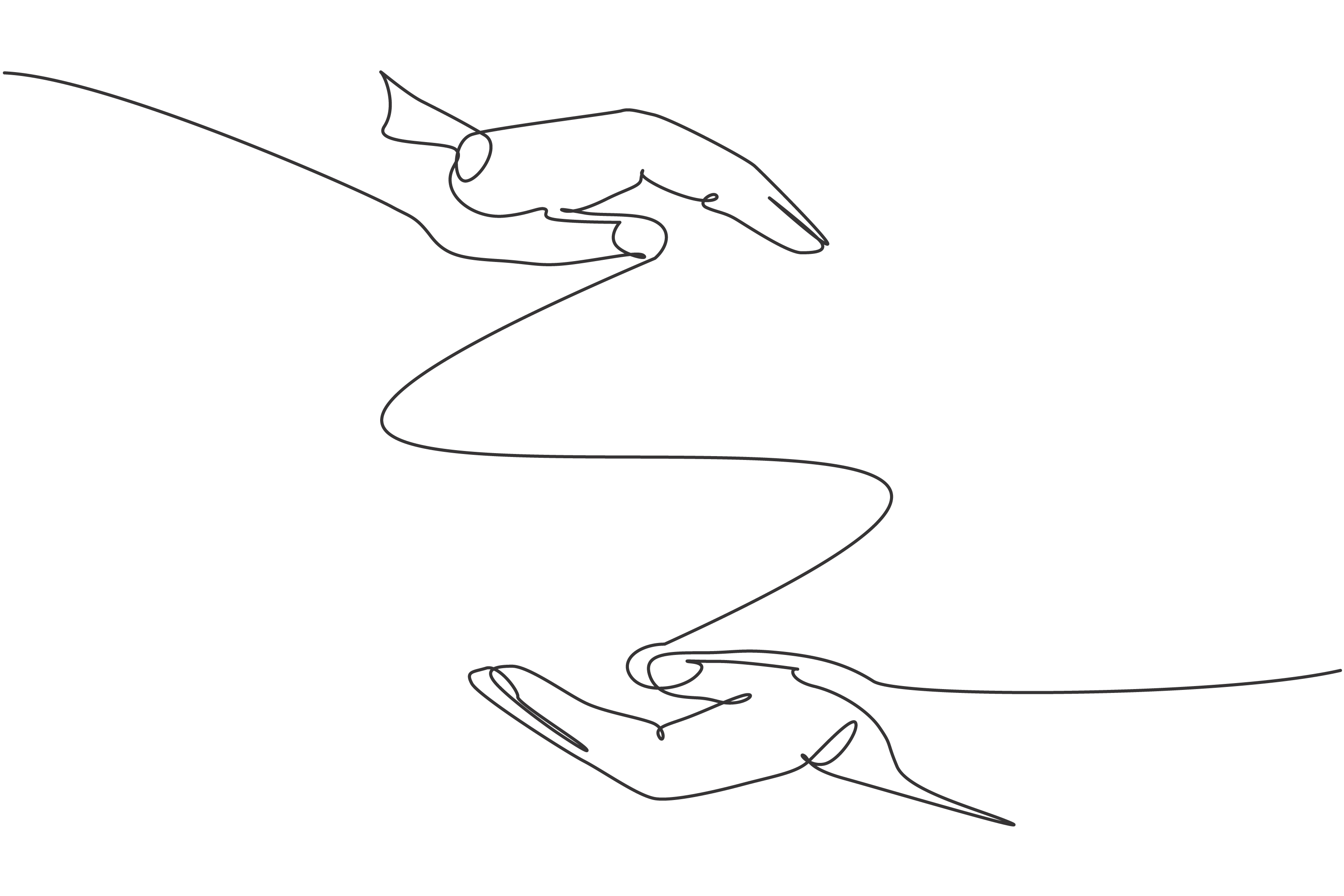D’un côté, une immaturité persistante de notre démocratie sociale, observée au prisme des relations entre l’État et les organisations syndicales et patronales - en témoignent l’incroyable feuilleton de la « concertation sociale » sur les retraites ou le burlesque épisode des dernières « négociations » Unedic. D’un autre côté, la progression du dialogue social dans l’entreprise, attestée par le nombre d’accords collectifs signés localement entre délégués syndicaux et directions - le total avoisine les 50 000 textes - mais aussi par le degré croissant d’acceptation sociale de ce dialogue, aucun responsable d’entreprise ou de dirigeant syndical ne se risquant désormais à en taire l’ardente nécessité. Le paradoxe est réel.
Comprendre ces deux affirmations, simultanément vraies - des partenaires sociaux incapables de nouer des compromis au niveau global, mais capables de le faire au niveau local - est l’objectif de cet article. L’intérêt est double : rendre compte de cet apparent décalage, mais aussi, en tentant de le comprendre : entrevoir l’avenir possible de notre système de relations sociales, aujourd’hui en transition.
Analyser le jeu des acteurs
Nommons « paradoxe de l’accord collectif » cette contradiction (apparente) entre une mise en accord quasi improbable au niveau interprofessionnel/étatique et une mise en accord pensable au niveau de l’entreprise ou du territoire, parfois de la branche professionnelle. Pourquoi cette césure, et que signifie-t-elle ? Deux séries de motifs apparaissent : les premiers sont d’ordre épistémologique et liés à notre lecture (orientée) de la réalité sociale et aux moyens que nous utilisons pour la (mal) comprendre ; les seconds sont systémiques, liés à la nature et à l’histoire du jeu social français. De sorte que ce paradoxe s’éclaire dès lors que l’analyse devient compréhensive, centrée sur le jeu des acteurs et l’entrelacs de leurs stratégies.
Certaines approches du monde social nous empêchent de discerner l’émergent ou d’attribuer correctement les causalités. Deux erreurs sont commises : ne saisir les individus que sous le type général auquel nous supposons qu’ils appartiennent, les considérer comme des fragments d’un même tout, sans percevoir l’étendue des différences et des divergences ; et procéder à une lecture sur-déterministe des événements et phénomènes. Conséquences : nous ne percevons pas qu’un cheminot n’est pas par nature et par statut un adepte de la grève reconductible ; qu’un militant CGT-Énergie n’est pas par contiguïté un envahisseur de locaux CFDT ; un policier, un faiseur de croc-en-jambe de manifestantes ; une députée de LaREM, une obéissante aveugle aux consignes de son groupe parlementaire, etc. Ces personnes sont saisies à travers de nombreux stéréotypes ; nous oublions que derrière ce cheminot, ce militant CGT, ce policier et cette députée, il y a un parent, un amant, un militant, ou un cuisinier, une bricoleuse ou une trésorière de club sportif, que ces dimensions multiples de la vie sociale et intime influent sur les comportements de ces acteurs sociaux, mus par différents intérêts et diverses motivations.
Nous sommes également victimes de notre attirance pour les raisonnements déterministes, plus que pour les raisonnements contingents qui, eux, laissent une part à l’imprévisible et l’inattendu. Le déterminisme - la situation en t + 1 dépend de son état en t - en rendant prévisible l’avenir (puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets) nous rassure : la situation de 2019 ressemblant à celles de 1995 et de 2003, l’attitude du Premier ministre actuel ressemblant à celle du Premier ministre de l’époque, leur méthode et leur rhétorique semblant identiques, etc., nous voilà prompts à imaginer la fin du présent épisode à la lumière de l’épisode passé. Nous constituons ainsi des chaînes causales fictives et négligeons l’énorme quantité de différences entre les situations, pour ne conserver que les éléments qui confirment nos analyses - ou nos désirs et croyances. Or il y a indétermination objective : rien n’est écrit à l’avance et, à tout moment, les événements (et l’action des personnes !) peuvent générer un cours différent d’action collective. La structure d’une situation sociale est telle qu’elle laisse aux acteurs sociaux une autonomie leur permettant de procéder à des choix entre des options contrastées pour lesquelles ils n’ont pas, a priori, de préférence prévisible. Chacune de ces options offrent avantages et désavantages ; ceux-ci sont difficilement comparables, ou peu évaluables. Les personnalités de ces acteurs sociaux, leur expérience, leurs convictions et leurs valeurs jouent ainsi un rôle primordial dans tel choix d’option.
Un jeu social dysfonctionnel
Nous sommes-nous éloignés du « paradoxe de l’accord » ? Non, car ce premier détour est nécessaire ; il met en garde contre une lecture partiale et partielle du monde social. Celle-ci se fonde sur une croyance erronée : que le monde social est un ensemble fini, et que si une dimension s’accroît, une autre régresse, de sorte que, en vertu du principe physique des vases communicants, les pertes d’un acteur social sont les gains d’un autre, une victoire compense une défaite, et le blocage ici est l’envers du déblocage là. Erreur de perspective car, dans nombre de situations sociales, plusieurs séries d’événements sociaux peuvent coexister dans une même temporalité sans être co-dépendants. Pourquoi ce « paradoxe de l’accord collectif » - probable ici, impossible là ? Trois motifs, systémiques, sont en jeu. Le premier motif relève de la physique sociale - il y a peut-être effet d’hystérèse, à l’instar du bruit d’un avion supersonique résonnant après qu’il soit passé au-dessus de nos têtes ; le deuxième concerne le jeu entre acteurs, devenu à la longue autobloquant ; le troisième renvoie aux mutations socio-productives et, concomitamment, à celles des idées et des principes par lesquels nous régulons le vivre-ensemble au travail.
L’hypothèse d’un effet d’hystérèse apparaît (de prime abord) de bon sens : des conséquences peuvent en effet perdurer après la disparition de leurs causes, des phénomènes sociaux retarder au cadran des sociétés, et des acteurs appliquer des stratégies peu adaptées aux situations dans lesquelles ils agissent. L’expression, forgée par le sociologue Alfred Schütz et reprise par Pierre Bourdieu sous l’intitulé d’« effet Don Quichotte » désigne une situation courante (voire une constante sociale) : le monde nouveau émerge au sein de l’ancien monde ; une fois établi, ces formes novatrices coexistent avec les formes sociales antérieures, qui persistent dans leur être, pourrait-on dire avec Spinoza, et continuent de matricer une partie de ce réel en évolution. Ainsi est-il probable que certains comités d’entreprise survivront plusieurs années dans diverses entreprises, sans que leurs membres ne se résolvent à se transformer en comité social et économique ; que certains employeurs resteront persuadés ad vitam aeternam que le dialogue social institutionnalisé est une perte de temps et une atteinte à leur autorité ; et que certains syndicalistes refuseront encore longtemps toutes formes de co-détermination, estimant que cette régulation conjointe et cette administration paritaire les détournent de ce qu’ils pensent être leur raison d’être de militants…
L’heuristique de cet effet d’hystérèse est cependant réduite ; elle ne permet pas de comprendre pour quelles raisons les dirigeants syndicaux et patronaux, dès lors qu’ils exercent des mandats nationaux, seraient les derniers à moderniser leurs pratiques, ce qu’auraient su faire les dirigeants locaux, touchés par la grâce d’un dialogue social dynamique et assumé… Une autre hypothèse semble plus féconde et rend mieux compte de ce « paradoxe de l’accord » : celle du jeu singulier (et historique) des acteurs sociaux, noué autour de quelques refus et craintes, et opéré en vertu de quelques croyances, qui, au niveau national, produit cette immaturité. Il y a effet d’hystérèse, certes, mais du fait de la structure du jeu relationnel, et parce que cette structure est devenue vicieuse, alors que le jeu relationnel d’entreprise, et pour d’autres raisons, lui, est devenu vertueux. Tel est, nous semble-t-il, le schéma explicatif de ce « paradoxe de l’accord collectif » : au niveau macro-social, compte tenu des contraintes de chacun des acteurs et de leurs objectifs, le jeu social antérieur perdure, bien qu’il soit devenu dysfonctionnel ; au niveau micro-social, il a su se réorganiser autour d’une nouvelle fonctionnalité - car les conditions du jeu se sont modifiées. Détaillons le raisonnement.
Un jeu social dysfonctionnel ? Oui, assurément ; et pour des raisons de mécanique sociale : ce qui a pu être à un moment une réponse adaptée au jeu de contraintes issues des volontés et des ressources des acteurs ne l’est plus. La singularité de notre système de relations professionnelles est qu’il s’est fondé, dès l’origine, sur un triple refus : refus des patronats, petits et grands, d’instituer l’entreprise comme un espace contractuel pertinent, de crainte de voir atteinte l’autorité du chef d’entreprise en y concédant des droits syndicaux et en partageant certaines décisions de gestion ; refus des syndicats, y compris les moins radicaux, d’inscrire l’action collective dans un processus de co-décision et d’administration paritaire des règles du travail, de peur de voir s’éteindre leur flamme contestataire, devoir endosser une responsabilité de gestion dont ils se méfiaient et, pour cette raison, faire s’éloigner leur objectif de devenir « un groupement autonome de production et de répartition » - si l’on reprend les termes de la Charte d’Amiens, 1906, jamais désavouée ; enfin, refus de l’État républicain de se déposséder de son droit d’intervention dans les affaires sociales, celles-ci étant considérées, depuis la Commune de Paris en 1871, une affaire de politique intérieure, qu’il faut traiter politiquement et de façon jacobine - et sans mollesse aucune…
Les stratégies étatique, syndicale et patronale épousèrent ces refus : les syndicalistes, estimant favorable le rapport des forces dans l’entreprise (puisque capables de mobiliser rapidement les travailleurs sur des mots d’ordre nationaux customisés localement) tentèrent de contraindre les employeurs, à partir de conflits du travail médiatisés et emblématiques, d’accorder des augmentations de salaires ou des droits syndicaux susceptibles d’être étendus à d’autres secteurs professionnels ou géographiques ; les employeurs, évitant de s’engager dans ces processus de négociation collective localisées qu’ils redoutaient, préférèrent négocier des minima salariaux dans des conventions collectives de branche éclatées et peu actualisées et, pour le reste, s’en remettre au législateur et à la représentation nationale pour que soient adoptées des lois sociales non contraignantes - le travail de lobbying auprès du politique se substituant ainsi au travail de transaction avec leurs partenaires syndicaux. Le législateur français, habitué à étendre le champ du régalien à des domaines que d’autres pays européens avaient su délaisser et confier aux partenaires sociaux, heureux de l’aubaine, a donc pu légiférer à sa guise, et profiter de la peur française du face-à-face social pour occuper une place prépondérante dans le jeu social.
Ce jeu fonctionna plusieurs décennies, malgré tout. Il devint progressivement bloquant dès lors que le législateur, sous l’effet de sa volonté, croissante, d’instituer l’entreprise comme un lieu pertinent de négociation collective et d’expression des salariés (et de redynamiser la branche professionnelle comme lieu efficient de régulation collective et d’accompagnement des entreprises dans leurs efforts de modernisation productive), modifia les règles du jeu.
Les employeurs, au départ méfiants et réticents (rappelons-nous les débats, vifs, à propos de l’introduction dans l’entreprise de l’obligation annuelle de négocier et des batailles parlementaires que provoquèrent au début des années 1980 le vote des lois Auroux…), comprirent leur intérêt à s’engager dans des transactions locales, tant pour définir des règles socio-productives adaptées aux situations que pour profiter de l’affaiblissement syndical afin de regagner du bargaining power à un niveau, l’entreprise, qu’ils avaient jusqu’alors historiquement délaissés. Surtout, ils comprirent que le meilleur moyen de tenir à distance les velléités étatiques de réglementation résidait dans l’usage circonstancié des outils contractuels que le législateur leur offrait. D’où leur progressive découverte, depuis le début des années 2000, des vertus du contrat collectif – ils économisent ainsi des coûts de transaction individuelle – et du bénéfice retiré d’une réglementation locale paritaire à laquelle ils ont contribué (ou qu’ils ont façonné).
Les syndicalistes d’entreprise, pour la plupart, furent pragmatiques. Bien que peu habiles ou rompus aux pratiques de la négociation coopérative, ils firent ce qu’ils faisaient jusqu’alors : exiger des négociations. Celles-ci mises à l’agenda social par leur partenaire patronal, ces syndicalistes engrangèrent ce qu’ils purent, ayant trop longtemps dénoncé haut et fort son refus de négocier dans l’entreprise pour s’autoriser à faire la fine bouche. Ainsi 85% des accords d’entreprise sont-ils désormais signés par les sections CGT, et nul salarié ne vient s’en plaindre auprès d’eux.
Ce pragmatisme n’a aucun intérêt au niveau national. D’autres logiques y sont à l’œuvre. Hormis ceux de la CFDT, réformistes dans l’âme et politiquement aptes à nouer des compromis, la plupart des dirigeants syndicaux, CFE-CGC comprise, purent ainsi s’exonérer d’une redéfinition de leur politique de contestation ; les dirigeants patronaux oublièrent leur volonté antérieure de « refondation sociale » et se concentrèrent sur leur travail de pression sur l’acteur étatique, exigeant pêle-mêle l’allégement des charges sociales, la formation qualifiante de chômeurs qu’ils embaucheraient alors en masse, dirent-ils, ou l’assouplissement des règles relatives aux contrats de travail… L’acteur étatique, enfin, toujours au centre d’un jeu dont il subit les effets pervers tout en tirant les ficelles, s’efforça de maintenir le cap - décentraliser la négociation collective, notamment, ou simplifier le code du travail - tout en dictant aux partenaires sociaux, au mépris de la loi qu’il avait instituée en 2007, ce qu’ils doivent négocier, ce à quoi ils doivent aboutir, et avant une date limite qu’il décide de son seul gré…
Reste les mutations socio-productives contemporaines. Impossible de nier qu’elles ont profondément bouleversé nos vies, intimes et professionnelles, et que notre façon de penser l’organisation du travail et la régulation sociale s’est radicalement modifiée. Nous sommes ainsi à un moment de transition, et c’est ce qu’illustre ce « paradoxe de l’accord collectif » : il traduit une structuration désormais différente de notre système de relations sociales. Laquelle ?
La configuration classique en trois niveaux de dialogue social (interprofessionnel, professionnel et d’entreprise), avec trois acteurs (l’État, le patronat, l’acteur syndical) et fondé sur la réticence à contracter et la préférence pour la loi laisse place, progressivement mais sûrement, à une configuration plus ouverte, avec de multiples niveaux de dialogue social, dont l’établissement, le groupe et le territoire ; avec de nouveaux acteurs (les conseillers en organisation et relations sociales, les militants d’ONG) et avec des acteurs syndicaux et patronaux différenciés (des réformistes et des radicaux ; des « petits patrons » prudents et des top managers éclairés - ou l’inverse ?), avec une habitude, nouvelle, de coucher par écrit l’accord et le désaccord et de mettre en place des démarches locales de co-résolution de problèmes.
Le rapport à la règle s’est également modifié, et cela n’a pas peu contribué à cette restructuration du jeu social français. Ne nous y trompons pas : le fait que les accords collectifs soient désormais à durée limitée (cinq ans, dit le législateur), que nombre d’entre eux soient des accords de méthode, qu’ils portent sur des sujets à la fois classiques (les rémunérations et le temps de travail, en majorité) mais ouvrant sur des domaines novateurs (l’organisation du travail, les conditions de performance et de productivité, etc.), et qu’ils peuvent être soumis à référendum, la légitimité de l’accord coexistant avec celle de l’acteur, tout cela n’est pas cosmétique ni anecdotique…
Une restructuration par le bas
Un arbre peut cacher la forêt, dit-on. Et si cet arbre est majestueux, la probabilité de ne pas discerner l’immense forêt qui l’entoure est forte. Notre propos invitait à mieux discerner ce qui change, et radicalement, dans le système français de relations sociales, alors que perdurent certaines formes et pratiques sociales anciennes.
Car derrière des phénomènes visibles, saturant l’espace médiatique et qui nous semblent être l’histoire en train de se faire (et parfois : la même histoire, infiniment répétée !) - des centaines de milliers de salariés et d’agents publics manifestant dans les rues cet hiver 2019-2020 contre une réforme de nos retraites, injuste et brouillonne - il existe une quantité d’actions réciproques et de formes relationnelles, à première vue négligeables et non médiatisées. Observées, compilées, mesurées, elles apparaissent pourtant pour ce qu’elles sont : le cœur de la production de notre société. Il faut, pour les saisir, se placer au niveau des individus - car une société est la somme de leurs actions réciproques.
Les gloses sur l’impitoyable domination managériale (et donc l’implacable assujettissement des agents et des salariés…), ou sur l’obsolescence et la non-représentativité des syndicats, ont peu d’intérêt. Ressasser aux dominés qu’ils le sont, et le resteront, ou ressasser aux syndicalistes que leur âge d’or est passé, voilà qui n’aide ni les uns à mieux résister ni les autres à se réinventer… Il faut plutôt s’intéresser à l’exercice concret de cette domination, donc à ses multiples failles et faiblesses, et à la manière dont, tout aussi concrètement, délégués et militants syndicaux, dans de multiples situations singulières, exercent leurs mandats, tissent du lien social et politique, et expérimentent des outils et d’autres manières de faire leur travail. Pour étudier et comprendre le système français de relations professionnelles, il convient donc de se poster à l’entrée du vestiaire d’une usine de mécanique et d’écouter les conservations du matin ; de grignoter un bout de galette des rois avec ces infirmières ; de participer à un groupe de travail sur l’égalité, décidé lors de la dernière réunion de NAO ; d’accompagner ce DRH dans l’atelier après qu’il eût décidé, avec le DG, d’organiser un référendum pour faire adopter un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail ; d’entendre les délibérations des membres de cet Observatoire départemental du dialogue social et découvrir le sérieux avec lequel ils s’apprêtent à fournir une aide concrète à la négociation collective dans les petites entreprises de leur département, en lien avec la Direccte locale, etc. Alors l’analyste pourra mieux comprendre ce qui est en jeu aujourd’hui, derrière les rodomontades des uns et des dérobades des autres : la restructuration du jeu social français. Il s’opère déjà - et par le bas.