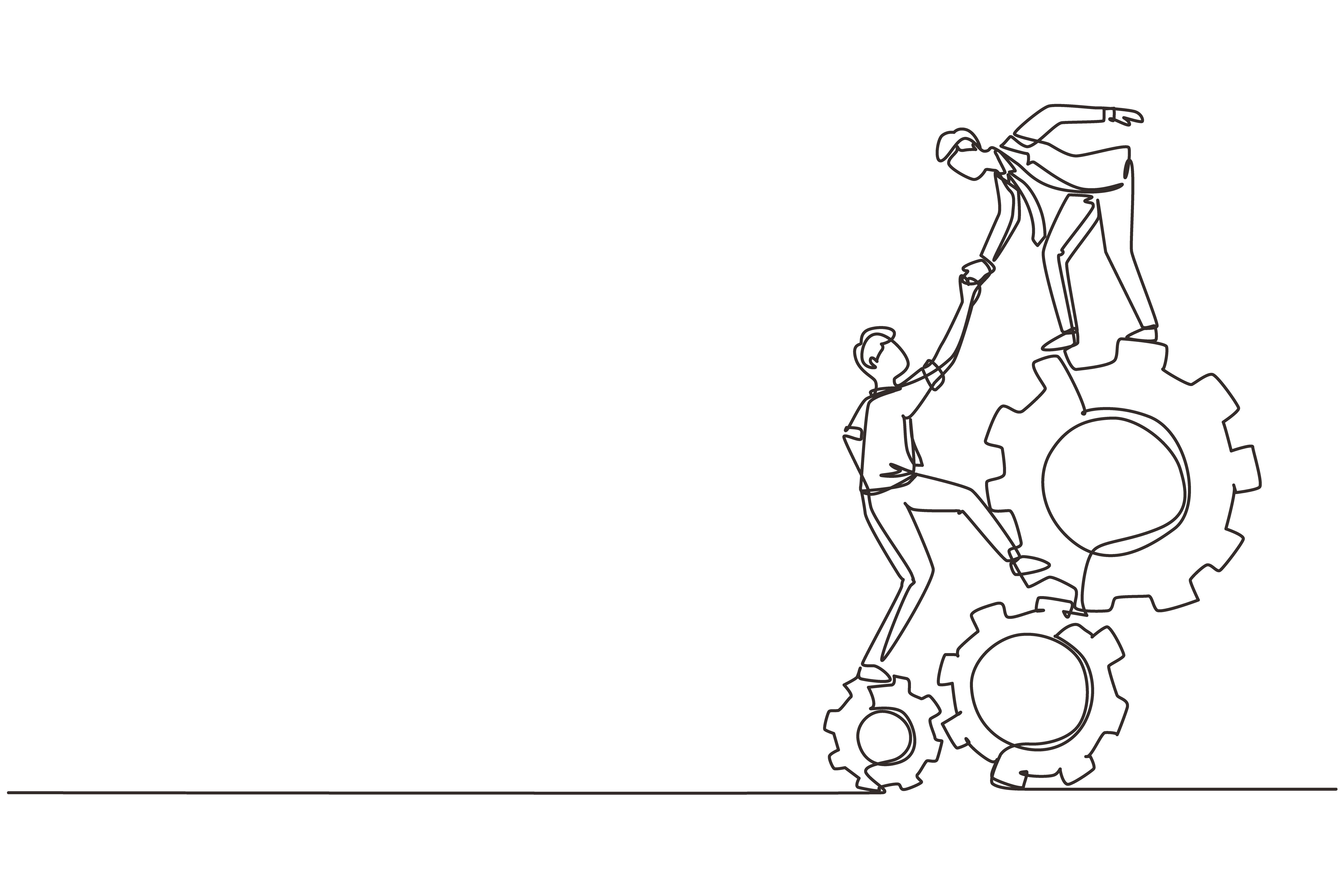Combien de temps travaille-t-on ? Celui durant lequel on utilise ses outils : pour faire du pain, imprimer un journal, étudier des réactions en laboratoire. Le temps de travail est aussi celui de l’occupation des lieux, si l’on rend un service à un public : magasin, banque, mairie. Mais quand l’outil tient dans le sac, comme l’ordinateur portable, voire dans la poche avec un smartphone, l’unité temps-lieu-action du vieux monde n’est plus collective, et surtout la durée de mise « à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (art. L. 3121-1 du Code du travail) est bien difficile à établir. Désormais décorées en flex office, les grandes tours de Paris-La Défense d’où le fier cadre jouait du présentéisme se battent contre le télétravail. Attention, ce n’est pas le caractère plus ou moins abstrait qui fait la mobilité, c’est bien l’outil et la finalité de l’activité : une coupe de cheveux ne se fait pas à distance. Quoique : l’intelligence artificielle permet de déplacer la relation de service même quand elle est physique. Avec la télémédecine, le corps du patient est à distance du médecin. Demain, un ouvrier spécialisé pilotera de chez lui des imprimantes 3D.
Bien qu’il soit de plus en plus difficile à cerner, nous n’en avons pas fini avec le temps de travail, bien au contraire. Combien d’heures travaillez-vous dans la semaine ? Et pourquoi d’ailleurs parler de semaine si les notions de repos et de déconnexion le week-end sont aujourd’hui questionnées ? Si la CFDT Cadres a inventé le forfait jours, c’est pour déplacer la question et la situer sur deux enjeux essentiels : la sanctuarisation du hors-travail et les moyens de l’autonomie dont dispose le travailleur, autrement dit la répartition de la charge individuelle et la coopération. Depuis les lois Aubry est apparue la transition numérique de l’activité, ce qui ne fait que démultiplier l’importance de ces enjeux. Si tous les salariés et agents cadres ne sont pas au forfait jours ou en télétravail, loin de là, la durée du travail est l’enjeu primordial de la reconnaissance financière comme celui du rythme.
Le problème est qu’on a du mal, lorsque l’embauche-débauche n’a plus sa portée symbolique, à rémunérer et à récupérer. Alors on éteint les serveurs pour imaginer un droit de déconnexion effectif. Car le travail n’est pas limité à sa durée, au chronos. Même quand la pointeuse protège, le véritable enjeu est celui de la charge, de l’intensité, des horaires. Une caissière qui attend des clients, c’est du temps mort pour qui veut optimiser, même si l’attente est en soi un travail. Alors on découpe sa journée et on l’accumule de tâches : nettoyer, gérer les stocks, jeter les emballages. Que penser de cet éboueur pris en flagrant délit de sieste (l’affaire avait fait du bruit début 2020) ? C’est la dureté des conditions de travail, ou plutôt une inadéquation entre contraintes et ressources, qui l’ont amené à chercher à récupérer des forces. Quand la frontière temporelle est floue, on cherche moins à la compter qu’à protéger du temps de non-travail, notamment avec des jours de récupération, les RTT, qui n’ont rien à voir avec les congés puisqu’ils répondent à l’intensité de la semaine plutôt qu’à un moment collectif de retrouvailles en famille.
La résistance à l’intensification, c’est moins l’oisiveté démissionnaire qu’une quête de maîtriser un peu son agenda professionnel, c’est-à-dire de l’articuler avec ses propres rythmes et ceux de ses proches. L’emprise du professionnel aujourd’hui dans nos vies – compétences personnelles au travail, préoccupations qui réveillent la nuit, injonction sociétale à optimiser son parcours dès la jeunesse, polyvalence fonctionnelle à tous les étages, interruptions et notifications en permanence – pousse beaucoup d’entre nous à vouloir travailler moins et surtout mieux. Ou plutôt d’avoir prise sur son temps libre, voire de le protéger. Car à l’intensification de l’activité a répondu celle du loisir. Depuis les années 1970, les penseurs du temps de travail – André Gorz en tête – ont remis au goût du jour le droit à la paresse libre (l’otium en romain, la skholè en grec) du temps citoyen, du repos et de l’épanouissement. La première revendication du mouvement ouvrier est la journée de huit heures. Étonnez-vous aujourd’hui que les étudiants adulent l’année de césure. On veut décompresser, mais aussi enfin agir comme on l’entend. C’est ce que demandent les cadres qui passent à la semaine de quatre jours : en 2012, une enquête CFDT « travail et temps » (au pluriel) identifiait que les RTT répondaient à un besoin de… dormir pour une grande part des répondants[1]. En 2023, un groupe CFDT en Occitanie interroge des adhérents cadres sur le cinquième jour de la semaine ; la réponse est la même : un besoin de repos.
Les temps qui comptent, ce sont les moments de transmission, de construction des collectifs, de création...
Ici vient une autre définition du temps, le kairos, celle du moment, du vécu. La plupart des temps ne sont pas objectivables. Comment l’employeur peut-il contrôler le temps de travail et garantir le repos ? Le droit impose une charge « raisonnable » que la jurisprudence précise : objectifs réalistes, ressources suffisantes, etc. L’absence d’évaluation de la charge, grand enjeu du monde professionnel[2], est un manquement à l’obligation de santé. Tous les observateurs et acteurs du travail dénoncent une vaste intensification qui touche tous les métiers et tous les secteurs. Nous sommes de plus en plus productifs, et les tableaux arguant d’une France devenue flemmarde depuis les 35 heures ne disent rien du monde réel. Notre rythme de travail est fixé par des contraintes dont le terme se réduit. Cette accélération est à la fois densification et dispersion. Il suffit de voir le nombre de mails traités chaque jour pour le ressentir. Ça vient de partout, à tous les niveaux et sur tous les sujets : la prescription est démultipliée : ce n’est plus seulement un manager mais aussi le client ou l’usager, les services internes, les collègues, et cela via des sources qui se diversifient et qu’on a du mal à hiérarchiser. Nombre de métiers vivent une compression des temps au travail. Le résultat attendu est souvent immédiat, ou presque, entraînant une dégradation du travail lui-même. On parle très justement de « modèle de la hâte »[3] qui incite à accélérer sans renier en principe sur la qualité. Une vraie injonction contradictoire car nous devons sans cesse être réactifs : à l’usager, au client, aux notifications du smartphone, à l’évolution du concurrent comme aux réorganisations internes et autres mises en place de systèmes numériques. Or, nous n’avons pas a priori conscience des dégâts possibles de ne pas reporter.
D’après la dernière enquête Sumer, deux cadres sur cinq sont exposés à « un temps insuffisant pour effectuer correctement leur travail » ; une grande majorité de cadres se dit exposée à « un abandon fréquent d’une tâche pour une autre non prévue », à « une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate »[4]. Des statistiques qui sont en forte hausse ces dernières années. En passant au tamis de la grille Gollac, l’exposition aux risques professionnels pour les cadres, c’est bien le facteur « intensité du travail et pression temporelle » pour la moitié d’entre eux qui ressort[5]. Confirmation par la sociologue Scarlett Salman qui a souligné les dimensions relatives aux temporalités du travail des cadres : le sentiment d’urgence, d’un présent omniprésent qui rendrait impossible l’anticipation (on cherche à planifier mais on doit sans cesse réagir) ; l’idée d’un temps fragmenté, qui empêcherait de se concentrer sur chaque tâche (phénomène de dispersion) ; le sentiment d’un trop-plein, du temps « qui déborde » jusque dans la sphère personnelle[6].
Il s’agit donc pour les militants et les managers d’imaginer un quotidien plus souple, des semaines plus courtes sur quatre jours par exemple pour avoir du temps pour penser à soi, mais également de décompacter le temps de la carrière professionnelle. La CFDT innove en proposant la création d’un véritable compte épargne-temps universel. En termes de management, c’est la question des délais et des moyens de réaliser un travail de qualité qui est posée. Mais également celle du lieu : à l’origine le temps de travail est celui du territoire avec l’industrialisation. La crise du covid a montré comment l’unité temps-lieu-action avait disparu pour beaucoup. Les entreprises et les services publics aujourd’hui tentent de maintenir une certaine discipline horaire. Il faut avouer qu’à l’heure du management hybride la question de la synchronisation revient. On l’avait perçu dans les négociations sur les aménagements et la réduction du temps de travail. Au cœur du temps, à quels moments y a-t-il un collectif ?
En ergonomes, Corinne Gaudart et Serge Volkoff identifient dans ce travail pressé « les temps qui comptent », « ceux par lesquels la santé et les compétences des femmes et des hommes au travail se régénèrent : le temps d’acquérir et de transmettre des savoirs, de contribuer à la construction du collectif de travail, de se créer de nouvelles pratiques professionnelles, de maintenir une cohérence dans son itinéraire[7] ». Bien sûr, la répartition de la charge et le développement d’appuis permettent de réduire l’intensification. Mais les temps qui comptent restent masqués s’il n’y a pas de dialogue sur le travail lui-même : que faisons-nous de notre temps ? « Poser que les personnes produisent du temps, c’est déconstruire une représentation du temps imposé à tous et sur lequel on ne peut agir. C’est poser que le temps est indissociable de son contenu et que c’est ce contenu même qui lui donne du sens. C’est réattribuer à chacun la capacité à élaborer son propre temps[8] ». Nous sommes producteurs de moments plus ou moins importants selon ce que nous en faisons ; l’analyse de C. Gaudart et S. Volkoff est rassurante. Les temps qui comptent, ce sont les moments de transmission (tutorat, apprentissage, changement d’équipe, etc.), de construction des collectifs (qualité des réunions et du pilotage des projets, dialogue professionnel sur la qualité du travail, formation pour consolider sa propre expérience, etc.), de création (à la différence de l’innovation, la créativité est la reconnaissance des critères de chacun)... Ici vient l’exemple de Sandra, une cadre supérieure appelée à réorganiser le temps de travail dans un Ehpad. En huit mois de débat, la question posée n’a pas été de travailler plus ou moins, mais de qualifier les temporalités et leurs usages autour de la question « Comment voulons-nous travailler ? ». En somme, de pas seulement ralentir, mais également choisir les gestes professionnels et les moments importants à ne faut pas bâcler, penser les temps à partir des contenus, répondre à l’autonomie contrôlée par de la coopération, ne pas seulement répartir la charge de travail mais déterminer les appuis pour que l’activité ne soit pas expédiée.
[1]- Monique Boutrand, « Le temps en déséquilibre », Revue Cadres, no 452, 2012. [2]- Laurent Tertrais, « Conditions de travail : L’injonction permanente à se dépasser, à s’adapter et à être autonome est épuisante », Le Monde, 25 juin 2023. [3]- Corinne Gaudart et Serge Volkoff, Le travail pressé. Pour une écologie des temps du travail, Les petits matins, 2022. [4]- Enquête Dares, Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels 2016-2017. [5]- Enquête CT-RPS, Conditions de travail et risques psychosociaux, 2016. [6]- Scarlett Salman, Aux bons soins du capitalisme. Le coaching en entreprise, Presses de Sciences Po, 2021. [7]- Corinne Gaudart et Serge Volkoff, « L’intensification du travail, longtemps niée, est à présent posée comme inéluctable », Le Monde, 26 octobre 2023. [8]- Corinne Gaudart et Serge Volkoff, Le travail pressé, op. cit., p. 193.