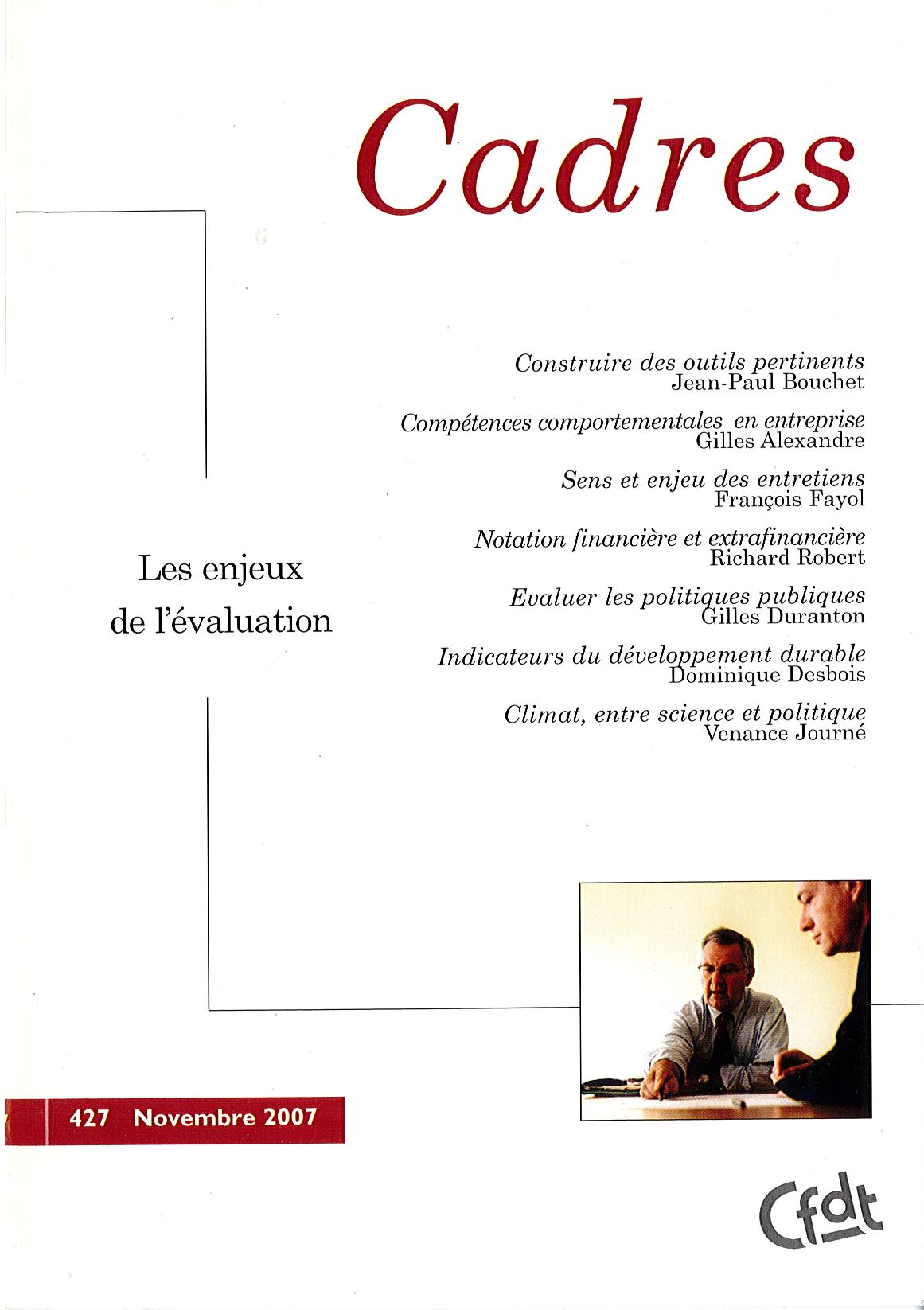Réforme de l’enseignement supérieur
Vouées dès l’origine à la professionnalisation, les écoles ont su éviter l’écueil d’une spécialisation excessive et forment de bons généralistes. Mais elles ne se sont jamais réellement donné les moyens suffisants pour jouer dans la cour des grands en matière de recherche, comme le note Pierre Veltz, ancien directeur de l’Ecole nationale supérieure des Ponts et chaussées, dans un ouvrage au titre provocateur : Faut-il sauver les grandes écoles ? (Presses de Sciences Po, 2007). Ce qui a longtemps fait la force des grandes écoles à la française pourrait bien devenir une faiblesse. En effet, si elles s’avèrent de très efficaces machines à sélectionner pour les grandes entreprises du CAC 40, elles peinent à « produire » les entrepreneurs innovants dont la France a besoin dans le cadre d’une économie de l’innovation. Dans un contexte d’internationalisation des firmes et du recrutement des cadres, la plupart d’entre elles souffrent en outre d’une taille insuffisante. L’élitisme est ici synonyme de malthusianisme, ce qui est préjudiciable à la notoriété des écoles sur le plan international, et donc à leur capacité à recruter des étudiants étrangers.
Dans un système franco-français, les recruteurs apprécient certes la qualité de ces diplômés triés sur le volet, et l’idéal méritocratique a pu donner aux plus prestigieuses une forte légitimité : elles sélectionnaient sur la valeur intellectuelle, et non sur la classe sociale comme le faisaient leur équivalentes anglaises par exemple. Mais ce brassage social n’est-il pas devenu un mythe ? La part des « héritiers » croît régulièrement et l’élitisme républicain tourne à la fermeture sociologique et à la reproduction sociale. Le système des grandes écoles satisfait sans doute ainsi ceux qui y participent, mais on peut repérer des signes de faiblesse, à la fois en termes de légitimité politique et de qualité de la formation. Car la diversité, aussi bien de conditions sociales que de nationalité, s’impose plus que jamais comme un plus dans un espace économique global où firmes et pays prendraient un gros risque à former des élites monochromes. Un effort de renouvellement s’impose donc, auquel Sciences Po, qui fut longtemps la caricature de l’institution pour « fils à papa », a ouvert la voie : gain de taille, diversification et internationalisation. Le livre récent de son directeur actuel Richard Descoing, Sciences Po. De La Courneuve à Shanghai (Presses de Sciences Po, 2007), montre ainsi comment un effort de démocratisation n’est pas antinomique avec le choix de l’excellence.
Les universités, quant à elles, ont longtemps vécu à l’écart du monde économique et ce n’est que très récemment qu’elles ont commencé à se poser sérieusement la question de l’insertion professionnelle. Jusque vers 1970, hors facultés de droit, de pharmacie et de médecine, leurs diplômés se destinaient majoritairement à la fonction publique. La massification de l’enseignement supérieur a rompu cet équilibre, et si depuis une vingtaine d’années beaucoup d’efforts ont été faits, notamment en deuxième cycle (niveaux M1 et M2), les perspectives des étudiants de premier et de troisième cycle demeurent préoccupantes. Les docteurs peinent à trouver leur place sur le marché du travail et se trouvent confrontés à la concurrence des ingénieurs-docteurs. La question se rejoue dans la construction des carrières de ceux qui ont trouvé du travail. Quant aux premiers cycles, on connaît leurs problèmes : un taux d’échec parfois dramatique, une orientation souvent défectueuse, un encadrement insuffisant, et enfin l’absence des meilleurs éléments, partis pour la plupart en classes préparatoires pour fuir un système dont ils contribuent ainsi à accentuer la dérive.
L’autonomie, oui, mais au service d’un projet
Bien qu’elle ait fait l’objet d’une négociation avec diverses parties prenantes dont les principaux syndicats étudiants, la loi sur les libertés et responsabilités des universités a fait l’objet de vives contestations cet automne. Ses quelques avancées vers une plus grande autonomie de gestion méritent pourtant d’être défendues, mais l’inquiétude des étudiants est une réalité à laquelle il convient d’apporter une réponse forte. L’autonomie sera d’autant plus légitime qu’elle sera associée à un projet ambitieux. La question des moyens a été posée, celle du taux d’échec en premier cycle peut sembler encore plus cruciale. La pédagogie notamment doit faire l’objet d’un effort, car les premiers cycles ne peuvent continuer à fonctionner comme si l’université accueillait toujours quelques pourcents d’une classe d’âge. C’est à une révolution culturelle qu’est ici appelée l’institution, qui sans renoncer à la massification doit apprendre à gérer plus finement ses effectifs, ses disciplines et l’orientation de ses étudiants. Sur ce point, une meilleure gouvernance sera un atout décisif, afin de construire des décisions qui ne soient pas le pur et simple reflet d’équilibres entre lobbies locaux. Mais il faudra aussi, il n’est pas inutile de le répéter, des moyens.
Les problèmes dont souffrent les universités et ceux qui affectent les grandes écoles se répondent ; mais de la même façon les unes et les autres ont développé des capacités et des méthodes qui pourraient être une source d’inspiration mutuelle. La gouvernance expérimentée dans les grandes écoles et leur lien fort avec le monde économique offre des leçons au monde universitaire, qui en retour peut inspirer les écoles dans la façon dont il a su articuler enseignement et recherche, même si tout n’est pas parfait.