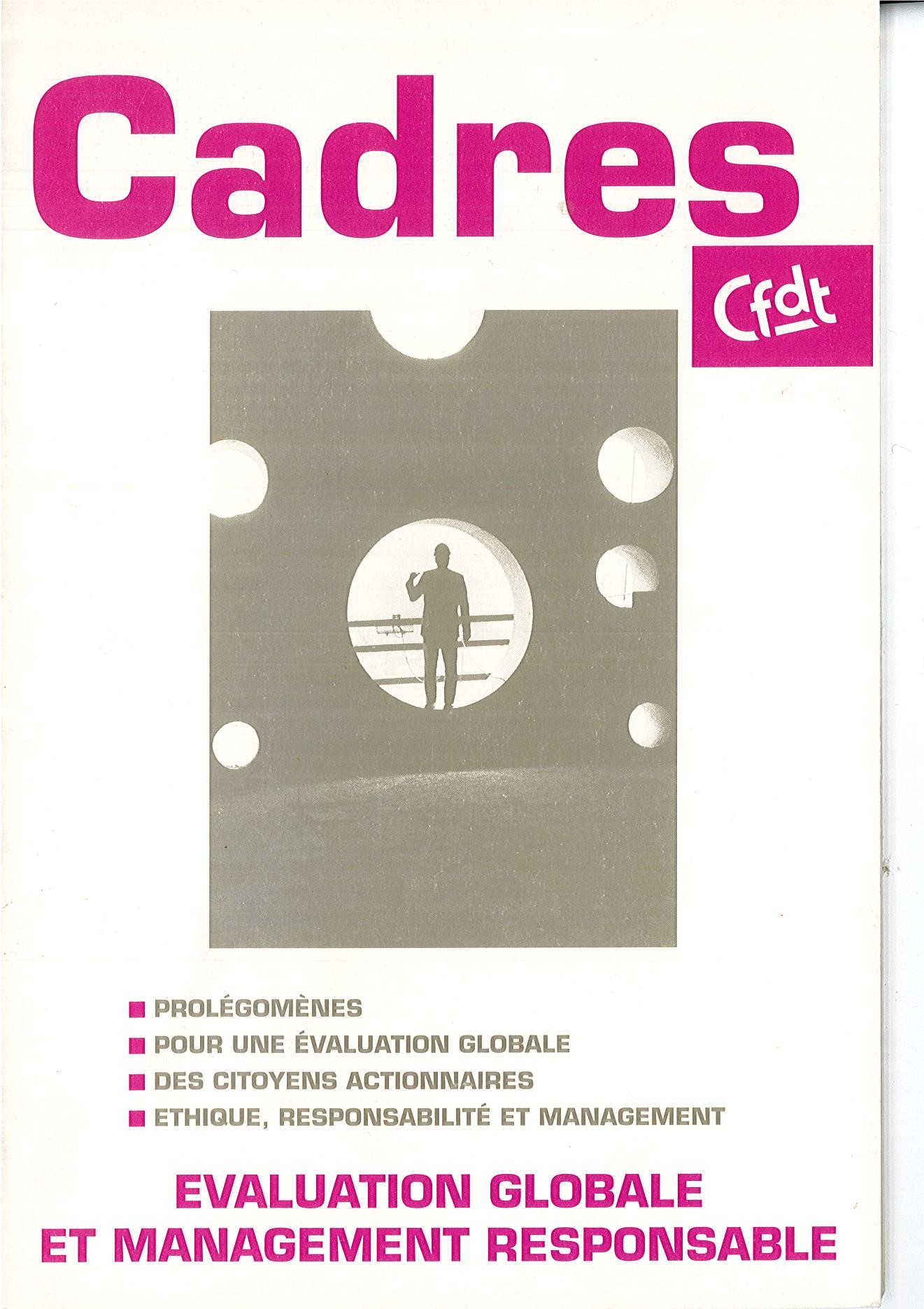Chaque fois qu’émerge un domaine nouveau de connaissance, celui-ci a besoin, à travers des mots, de forger des concepts qui vont porter le sens de ce que chacun veut dire. En l’espace d’un an ou deux, la thématique de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises a fait irruption dans les discours syndicaux et politiques et a été relayée par une grande partie de la presse écrite ; ainsi des mots, des notions sont apparus avec des sens souvent mal définis, utilisés de manière diverse dans des contextes différents et finalement, ballottés d’une acception à une autre. Les confusions sont donc nombreuses ; cet article n’a pas la prétention de les dissiper totalement mais, du moins, d’en éclairer les origines et de faire apparaître les grands enjeux des mouvements sémantiques relatifs à ce nouveau domaine.
«Responsabilité» et «social»
L’expression «responsabilité sociale» d’abord. Elle est loin d’être nouvelle, mais elle a pris une autre dimension. L’adjectif «social» en français est polysémique, bien qu’il soit le plus souvent utilisé dans son sens le plus restreint. On parle par exemple de comptes sociaux pour désigner les comptes de sociétés qui doivent être fournis aux actionnaires et aux tiers ; rien à voir donc avec le sens courant qui veut exprimer aussi bien ce qui est relatif aux relations entre des individus au sein d’une collectivité que ce qui est favorable au bien-être des personnes. Plus rare en français est l’acception qui désigne ce qui est relatif à une société dans son ensemble ; cette dernière qu’on trouve surtout dans le langage sociologique correspond à la signification anglo-saxonne, pour laquelle le français préfère généralement le terme «sociétal» afin d’éviter toute ambiguïté avec la précédente acception. Mais comme les emprunts à l’anglo-américain gagnent du terrain, l’expression «responsabilité sociale» peut aujourd’hui englober autant les responsabilités à l’égard des salariés et autres contractants de l’entreprise que celles à l’égard des communautés de proximité, voire à l’égard de l’environnement bio-physique : on est alors proche de l’idée «d’entreprise citoyenne».
La notion de responsabilité est également source fréquente de confusion pour le domaine qui nous préoccupe. Après le naufrage de l’Erika, le PDG de TotalFinaElf estimait que sa société n’était pas responsable, parce qu’elle avait respecté scrupuleusement les lois et règlements en vigueur. En fait il confondait culpabilité et responsabilité. La notion de culpabilité renvoie à une faute, à une infraction susceptible d’être qualifiée de contravention, de délit ou de crime alors que la responsabilité, notion plus large, implique d’assumer les conséquences de ses actes, ainsi que d’en rendre compte. La responsabilité sociale va au-delà de la satisfaction des obligations réglementaires et contractuelles. Le Livre Vert de la Commission des Communautés européennes publié en 2001 et traitant de ces questions a consacré ce sens en affirmant : «être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aller au-delà et «investir» davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes». Cette définition pose en fait le problème des relations des entreprises avec les sociétés humaines et notamment du degré d’acceptabilité des risques que les unes font courir aux autres dans l’exercice de leurs activités.
Où l’on retrouve l’éthique
On touche donc d’assez près aux questions d’ordre politique et éthique. Avant que le terme de responsabilité sociale finisse par s’imposer surtout en Europe, ces questions étaient souvent évoquées en accolant le terme éthique à un autre terme : on a ainsi parlé de «l’éthique d’entreprise», de «l’éthique des affaires», du «management éthique», de «l’éthique du management», de «fonds éthiques», plus récemment de «commerce éthique», «d’investissements éthiques», de «consommation éthique», «d’audits éthiques»… Ces appellations font référence peu ou prou au courant américain du «business ethics», courant moraliste-éthique considérant que l’entreprise doit agir de manière socialement responsable parce qu’il est de son devoir moral de le faire ; ce courant n’est cependant pas dénué de tout utilitarisme puisque cette morale est censée aller dans le sens des intérêts bien compris de la firme. En réalité, les approches en termes «d’éthique»1 n’ont jamais permis de mener une réflexion approfondie dans la mesure où elles butent rapidement sur le problème de la différenciation du «bien» et du «mal» ; on se cantonne alors souvent à définir le «bien» comme le respect des lois (exemple : ne pas corrompre, ne pas être corrompu…). Un célèbre cabinet d’audit proposait ainsi à ses clients des «audits éthiques» consistant ni plus, ni moins, en des audits de conformité des pratiques d’entreprises aux législations en vigueur…
L’ambiguïté du mot «durable»
La thématique de «l’entreprise socialement responsable» se devait donc de trouver une référence idéologique suffisamment sérieuse pour asseoir un corpus de «bonnes pratiques». Elle finit par le trouver dans le concept de «développement durable», à tel point qu’il y a aujourd’hui pratiquement une identification de l’entreprise «socialement responsable» à celle qui contribue au «développement durable». Restait néanmoins à préciser ce que signifie le développement durable pour une entreprise. Tout un courant managérial a provoqué un glissement sémantique et a rapidement assimilé « développement durable » à « pérennité » de l’entreprise : véritable détournement de sens, «capture managériale» d’un concept qui n’était pas destiné à l’origine à cet usage, mais qui n’est pas non plus sans fondement. Les promoteurs de cette «capture» estiment en effet que la durabilité de l’entreprise est favorable aux intérêts à long terme de l’humanité, ce qui ne trouve ni justification théorique, ni confirmation pratique.
Cette traduction française de la notion anglo-américaine de «sustainability» en a malencontreusement obscurci le contenu ; une dirigeante des Verts n’a probablement pas tort de dire que la bataille sémantique a été perdue ; en effet, la traduction la plus correcte aurait dû être «développement soutenable» (qui est encore parfois utilisé) ou encore mieux «développement supportable». Pourquoi «supportable» ? Pour deux raisons :
- «supportable» pour les ressources naturelles de la planète (sans risque de les épuiser),
- «supportable» pour les humains qui exploitent ces ressources (sans risque de les épuiser, c’est-à-dire sans risque de leur faire perdre leur vie à la gagner, au sens propre et au sens figuré).
L’exploration, par les politiques en particulier, des multiples facettes de cette expression ambiguë est loin d’être terminée : c’est d’ailleurs probablement cette ambiguïté de la notion qui est à l’origine de son succès.
Investissement=placement !
De l’entreprise socialement responsable, on est passé logiquement à l’investissement socialement responsable, mais là encore avec un curieux glissement sémantique. Tout étudiant d’économie ou de gestion qui découvre cette expression pour la première fois croit comprendre que l’on va parler d’acquisition d’immobilisations par l’entreprise visant à apporter un bénéfice à la communauté (par exemple dispositifs anti-pollution ou programme de formation pour les salariés) ; il met un certain temps à réaliser qu’en fait, il ne s’agit pas d’investissement, mais de placement financier répondant à certaines exigences de la part de gestionnaires de fonds. Curieusement, les vrais investissements qui pourraient être considérés comme socialement responsables sont rarement mis en valeur et peu de personnes se sont encore vraiment préoccupés de définir ce que pourrait être un management socialement responsable. Même les grandes entreprises (par exemple celles regroupées au sein de Corporate Social Responsibility Europe) sont plus enclines à mettre en valeur leurs actions de mécénat, de sponsoring, d’œuvres de bienfaisance que les mesures visant par exemple la préservation de postes de travail ou l’anticipation des conséquences de mutations économiques sur l’employabilité des salariés.
Cela nous conduit à la reddition (ou reporting externe) et à la communication. Cela a été dit plus haut : la responsabilité sociale ne se conçoit pas sans le fait de rendre compte de ses actes ; la reddition existe depuis longtemps dans les domaines comptable et financier. Elle est récente dans les domaines social et environnemental (cf. le bilan social et la loi sur les nouvelles régulations économiques pour les sociétés cotées) ; mais un long apprentissage va devoir être fait pour ne pas confondre reddition et communication. La reddition est obligatoire, destinée à éclairer les tiers de manière impartiale et répond à des normes de publication ; la communication est volontaire, destinée à mettre en valeur ce que l’entreprise estime être favorable à son image et ne répond à aucune norme de présentation. L’absence de nette distinction entre les deux ne peut qu’être la source de confusions, de désaccords et de polémiques futurs.
Le mot «norme» est polysémique
On vient d’évoquer les normes de publication des états de reporting externe. Ce n’est pas le seul domaine, en matière de responsabilité sociale de l’entreprise, où l’on parle de norme et de normalisation, à tel point que le novice a quelque peine à s’y retrouver. Cela tient au fait qu’il y a en réalité trois usages bien distincts des termes norme et normalisation :
- on parle souvent de respect de «normes sociales» lorsqu’on évoque le problème des entreprises qui investissent dans des pays en voie de développement : il s’agit d’un ensemble de règles et de comportements volontairement acceptés par les entreprises et qui ont tendance à s’imposer à toutes les entreprises dans une situation similaire ; on dit encore qu’il s’agit d’une régulation par le marché (par opposition à une régulation publique qui opère de façon contraignante sous la forme de réglementations) : un exemple de ce type est fourni par SA 8000 qui se réfère à certaines des conventions de l’OIT,
- lorsque, au niveau international, existent des tentatives d’harmonisation internationale de présentation des états de reporting et qu’elles ont tendance à s’imposer de manière universelle, on parle également de normes : c’est le cas des «normes comptables internationales» produites par l’IASB (ex-IASC) ; par extension abusive, on a parlé des «normes» du GRI (Global Reporting Initiative), initiative privée d’origine américaine tendant à promouvoir un référentiel de reporting social et environnemental,
- les «dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention d’un degré d’optimalité dans un contexte donné» (définition d’Hervé Penan) ; exemples : une meilleure adaptation des produits, des processus et des services grâce aux normes ISO et AFNOR.
La question de la normalisation renvoie au problème de la définition d’un référentiel et par conséquent de savoir qui décide (ou qui induit) les normes : c’est la fonction de régulation. Elle est souvent confondue avec la fonction de normalisation, parce que fréquemment le régulateur délègue cette responsabilité au normalisateur. Théoriquement, il existe trois types de régulation :
- la réglementation publique, aujourd’hui souvent critiquée, parce que trop contraignante et imposée d’en haut aux acteurs de la vie économique et sociale ;
- l’autorégulation par les principaux acteurs eux-mêmes qui définissent leurs propres règles, bien souvent pour anticiper les réactions des pouvoirs publics et éviter ainsi une régulation trop contraignante : par exemple, les grandes entreprises qui se dotent de codes de conduite ou adoptent des démarches volontaires ;
- la co-régulation associant sous forme de concertation, de dialogue, voire de partenariat, des parties prenantes aux intérêts divers qui, au travers de leurs confrontations, recherchent des compromis acceptables : le cas est encore assez rare, mais pourrait se développer grâce à l’instauration de lieux de contacts entre entreprises, syndicats, ONG et collectivités publiques.
En réalité, ces trois types de régulation ne s’opposent pas systématiquement et agissent plutôt dans une dynamique combinatoire qui les rend peu transparentes.
Le pouvoir des mots
Dans un domaine qui est en plein mouvement, la confusion actuelle profite à ceux qui disposent d’un pouvoir leur permettant de transformer et de stabiliser le sens des mots. Actuellement, ce sont les grands cabinets d’audit anglo-saxons («big four») qui véhiculent les nouvelles notions, développent des analogies parfois trompeuses (notamment avec le domaine comptable et financier) et qui constituent le fer de lance d’une «communauté épistémique»2 : véritable réseau d’alliances entre grandes firmes, cabinets de conseils, experts et certaines ONG (d’origine américaine et britannique) partageant les mêmes représentations du monde fondées sur la culture anglo-saxonne et la religion protestante, les mêmes croyances normatives et la même logique de l’efficacité. Cette communauté, au travers de nombreux colloques et séminaires, publications, déclarations de principes, lignes directrices, programmes d’action occupe le terrain, multiplie initiatives et propositions, façonne les modes de pensée et est en train de dégager progressivement des normes dont la vocation est de s’imposer à l’ensemble de la planète. A travers la sémantique, on retrouve ainsi les éternels effets de la puissance et de la domination.
* : Voir aussi du même auteur «Grandes et petites manœuvres autour de l’éthique d’entreprise», page 41 du numéro N° 390 de CADRES CFDT «Pour une gestion attentive», décembre 1999.
1 : Le Comité d’Orientation et de Programmation de l’AFNOR qui a publié un rapport «Ethique sociale» reconnaît que «l’éthique sociale» recouvre essentiellement la notion de responsabilité sociale de l’entreprise dans le cadre de son activité envers les parties prenantes.
2 : Le terme de «communauté épistémique» est emprunté à Ernst Haas qui les définit comme des groupes d’acteurs porteurs de la connaissance et de nouvelles références pour l’action collective.