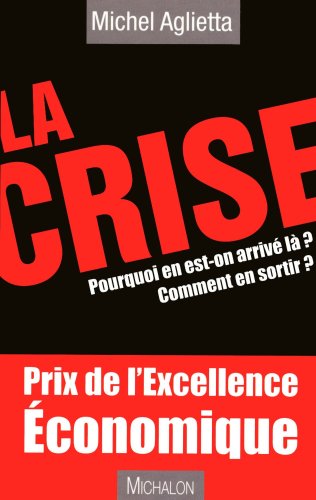Professeur de sciences économiques à l’université de Paris-X, théoricien de l’école de la régulation et spécialiste d’économie monétaire internationale, Michel Aglietta est aussi membre du comité d’orientation de la revue Cadres CFDT. Il donne avec ce petit livre destiné à un large public une explication des causes de la crise actuelle et une présentation des mesures qu’elle appelle pour s’en sortir.
L’auteur explique que les bulles sont inhérentes au capitalisme financier. Il y a une raison à cela : les prix des actifs financiers n’obéissent pas aux mêmes règles que ceux des biens ordinaires, en effet, plus leur prix monte, plus la demande augmente. Et cela est d’autant plus vrai que leur acquisition s’effectue en recourant davantage au crédit et n’est donc pas limitée par l’épargne disponible. Mais la valorisation des actifs à leur valeur de marché contribue également au phénomène : en faisant apparaître plus faible la dette contractée pour les acquérir, elle incite les banques à prêter tant et plus.
Le crédit a en effet atteint des niveaux jamais égalés auparavant. Cela, grâce à l’ingénierie financière et aux outils qu’elle a développés pour transférer les risques de crédit (titrisation, structuration en tranches, assurance crédit…) et autoriser ainsi à en prendre toujours plus, sans avoir à se soucier de la qualité des crédits.
La crise ne sort pas de nulle part. Ce sont les mécanismes qui se sont mis en place au sortir des crises précédentes qui ont finalement conduit à celle-ci. Après l’éclatement de la bulle Internet en 2001, les entreprises américaines se sont désendettées. Les ménages, en revanche, ont été incités à s’endetter massivement pour acquérir leur logement et pour consommer. La politique, longtemps très expansive, menée par la Fed a encouragé cet accroissement du crédit et de la consommation. De même que l’abondance des liquidités mondiales, liées aux excédents commerciaux des pays asiatiques puis à l’augmentation du prix des matières premières, que leurs détenteurs souhaitaient placer aux États-Unis.
Cette expansion du crédit s’est accompagnée d’une hausse très forte des prix de l’immobilier. Le retournement de ce marché aux États-Unis s’est opéré au troisième trimestre 2006. Cela a aussitôt accru les probabilités de défaut des crédits hypothécaires. La révision brutale, au printemps 2007, par les agences de notation des notes qu’elles avaient données aux titres adossés à ces crédits a fait que brusquement plus personne n’en a voulu. Et comme l’acquisition de ces titres était largement tributaire du marché monétaire à court terme, la perte de confiance des investisseurs s’est propagée à celui-ci (à partir d’août 2007). La crise s’est brutalement aggravée en septembre 2008, lorsque de nombreuses banques américaines et européennes (en particulier les banques d’affaires qui ne disposaient pas du matelas de sécurité des dépôts des particuliers) ont laissé voir qu’elles n’avaient pas assez de capital pour couvrir leurs pertes. Après la faillite effective de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, c’est le marché gigantesque des dérivés de crédits qui a fait l’objet d’une méfiance généralisée, le marché de gré à gré entre banques s’est alors totalement figé et la crise s’est propagée aux banques du monde entier.
Confrontées à cette situation, les banques centrales ont ouvert largement aux établissements bancaires des lignes de crédit, y compris en prenant en garantie des actifs dont la qualité prêtait parfois à discussion. Tandis que le Trésor américain soutenait les organismes de refinancement immobilier Freddie Mac et Fannie Mae. Et que les États prenaient des mesures pour, d’une part, assurer la recapitalisation des banques et, d’autre part, garantir le crédit interbancaire, en mobilisant pour cela des montants considérables, qui viendront gonfler la dette publique.
La forte contraction du crédit résultant de la crise financière entraîne une coupure des dépenses non indispensables, et donc une baisse de la production et des revenus, une montée du chômage et une forte baisse du profit des entreprises. Si l’on ne fait rien, la baisse des revenus des ménages et des profits des entreprises se traduira par de nouvelles pertes sur les crédits, une aggravation des difficultés des banques, un durcissement supplémentaire de l’offre de crédit et, finalement, un approfondissement de la récession. Pour conjurer celle-ci, la dépense publique doit absolument se substituer à la dépense privée.
La crise financière a montré l’importance d’une supervision bancaire européenne, qui soit capable de fournir une vue d’ensemble des activités d’une banque dans les différents pays de l’Union (qui fait aujourd’hui défaut). Pour le reste, la mise en ouvre d’une politique budgétaire offensive suppose, pour être efficace, une approche budgétaire commune au niveau de l’Union européenne. Celle-ci pourrait prendre la forme, explique l’auteur, d’un budget spécifique ciblé sur la recherche (un secteur où l’Europe a pris beaucoup de retard par rapport aux États-Unis et au Japon), qui pourrait être renforcé grâce à des emprunts contractés par la Banque européenne d’investissements, en espérant que ces investissements améliorent la croissance future.
Il apparaît en effet indispensable, au vu de la crise actuelle, d’exercer un contrôle plus vigilant sur l’accroissement du volume des crédits, et, pour cela, de contraindre les banques à se doter d’une couverture en capital plus importante, en particulier dans les phases d’expansion du crédit. La stabilité financière doit être un souci permanent des banques centrales en plus du contrôle de l’inflation. Par ailleurs, les banques d’affaires, y compris les Hedge funds, doivent se voir contraintes de constituer du capital en face de tout type de crédit, qu’il soit comptabilisé au bilan ou situé hors bilan. Ce qui suppose également de soumettre les places offshore aux mêmes règles que l’ensemble des autres places financières (ou d’interdire d’y transférer des actifs). Il convient également de réglementer l’ingénierie financière, et en particulier de normaliser les produits de titrisation, par exemple en créant à cet effet un ou des marchés administrés. Enfin, il faut s’occuper des agences de notation et, pourquoi pas, les transformer en organismes publics.
Les bonus des traders doivent prendre en compte les pertes et non pas seulement les profits qu’ils réalisent. De même pour les stock-options. La séparation entre la présidence du conseil d’administration et la direction opérationnelle doit être la règle dans les banques d’affaires. Enfin, il faut que les actionnaires importants exercent demain un rôle effectif dans la désignation de membres extérieurs des conseils d’administration, à même de constituer un contre-pouvoir par rapport à la direction en place.
Une fois la récession amortie, les États devront résoudre un nouveau problème, celui de leur dette publique qui aura beaucoup augmenté. Il y a tout lieu de penser que la sortie de crise se traduira, in fine par de forts investissements en portefeuille des pays émergents vers le monde occidental, via les fonds souverains. On pourrait ainsi assister dans les prochaines années à un changement du centre de gravité du pouvoir économique sur la planète.
On peut caractériser ce régime comme celui d’une gouvernance d’entreprise tournée exclusivement vers la création de valeur pour l’actionnaire qui a élargi démesurément les inégalités de revenus, aidée en cela par la montée des pays émergents, qui a créé un marché du travail beaucoup plus vaste avec un excès global de main d’ouvre, et parallèlement par le développement d’une consommation à crédit (tout particulièrement dans les pays anglo-saxons). Or, des évolutions se dessinent, notamment aux Etats-Unis, vers un autre partage de la valeur ajoutée. Tandis que les écarts de croissance entre les grands pays émergents et les pays occidentaux devraient s’accentuer et les opportunités d’investissement conduire les grands investisseurs institutionnels (mais aussi les fonds souverains des pays émergents) à s’intéresser davantage aux pays émergents, pour autant que les États de ces pays soient capables de mener une croissance plus soucieuse du bien être de leur population.
On notera que l’auteur a jugé que ce n’était pas le lieu de s’interroger davantage sur l’ampleur du déficit américain et les risques que celui-ci fait peser sur l’économie mondiale. Et qu’il se veut relativement rassurant s’agissant de la crise financière, même s’il évoque les situations encore précaires des banques d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est. À l’en croire, cette crise va nous coûter plusieurs années (sans doute trois ou quatre ans) de croissance molle, avec des conséquences pénibles en matière d’emploi et de pouvoir d’achat. Par ailleurs, elle va probablement favoriser ou accélérer un déplacement du pouvoir économique vers les grands pays émergents. C’est alors le moins d’espérer qu’elle puisse contribuer à un rééquilibrage dans le partage de la valeur ajoutée dans les pays développés, même si, évidemment, on a aujourd’hui aucune assurance sur ce plan.
Cette note est également parue sur le site nonfiction.fr