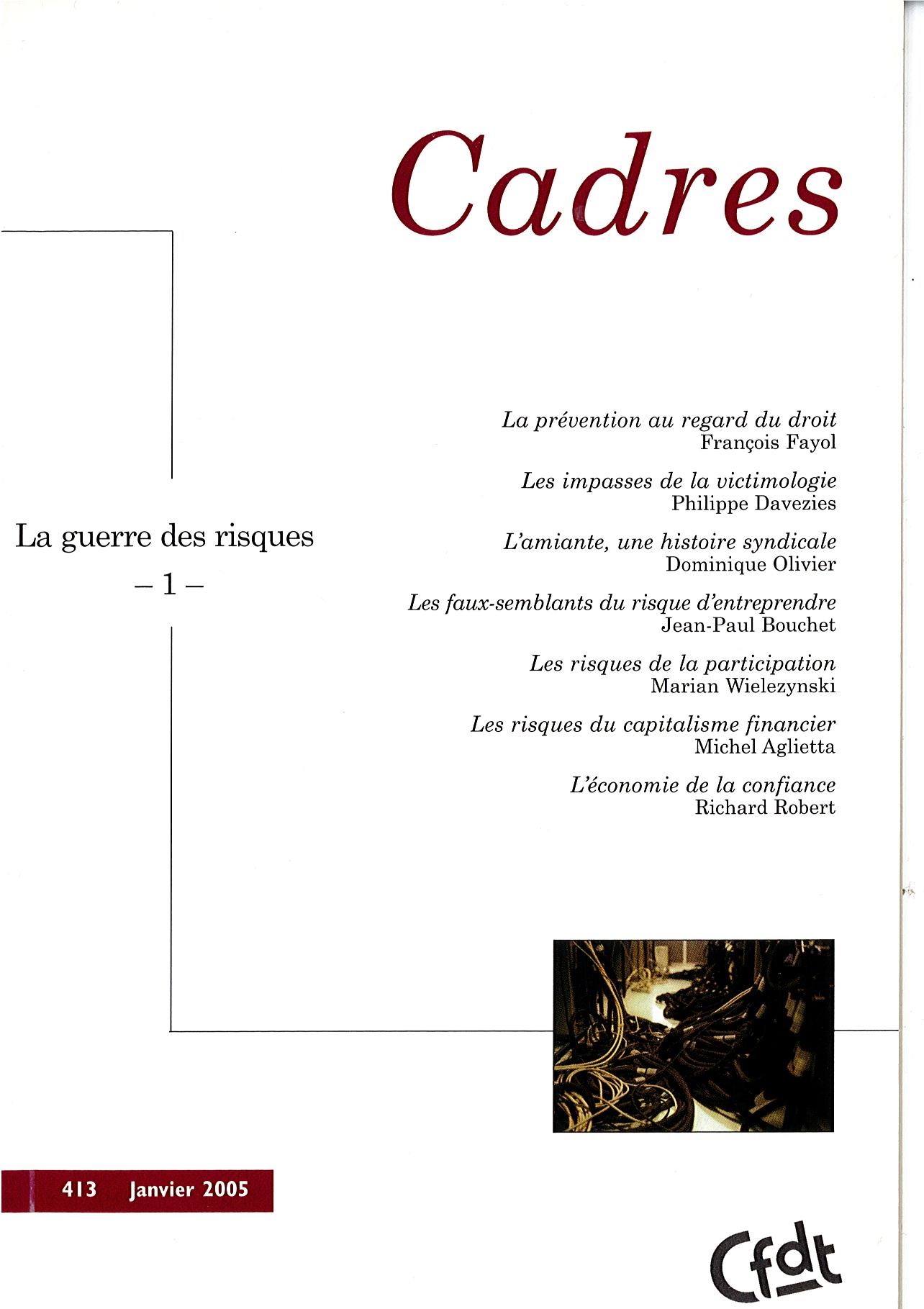Quand Ulrich Beck, en 1986, parlait de ÂŤ sociĂŠtĂŠ du risque Âť, il ne dĂŠcrivait pas notre monde comme celui de toutes les aventures, mais comme celui du contrĂ´le et de lâassurance. Lââge, la maladie, les colères de la nature, tout ce qui fut jadis une fatalitĂŠ, les hommes du vingtième siècle ont cherchĂŠ Ă le maĂŽtriser, et quand ils nây parvenaient pas Ă lâassurer. Lâaccident est devenu indissociable de sa rĂŠparation. Des empires se sont construits, des modèles de sociĂŠtĂŠ se sont ĂŠlaborĂŠs sur cette passion de la sĂŠcuritĂŠ, dont les images actuelles de lâinsĂŠcuritĂŠ ne sont peut-ĂŞtre que le revers.
Lâhistoire du mouvement social peut ainsi se dĂŠfinir comme une sĂŠrie de conquĂŞtes visant Ă circonscrire les risques, Ă les limiter, et quand câĂŠtait possible Ă les faire disparaĂŽtre. Le droit du travail sâinvente avec la lĂŠgislation sur les accidents du travail, dont la loi de 1898 est une ĂŠtape dĂŠcisive. En 1945, la sĂŠcuritĂŠ sociale assure autour du contrat de travail les grands risques de lâexistence : la vieillesse impĂŠcunieuse, la maladie, le chĂ´mage. Les dernières dĂŠcennies du siècle voient lâĂŠmergence dâun nouvel acteur, le ComitĂŠ dâhygiène, de sĂŠcuritĂŠ et des conditions de travail. Travailleurs et employeurs sont invitĂŠs Ă progresser ensemble dans une sĂŠcurisation des sites et des postes de travail.
En un peu plus de cent ans, que de chemin parcouru ! DâoĂš vient alors que le dĂŠbut du troisième millĂŠnaire donne une telle impression de surplace, voire de rĂŠgression ? Câest dâabord que la fragilitĂŠ de certains mĂŠcanismes assurantiels est apparue au grand jour. Lâallongement de la durĂŠe de la vie et la persistance dâun chĂ´mage de masse nâont pas eu raison des institutions de lâEtat-providence, mais tant lâUnedic que les caisses dâassurance vieillesse et dâassurance maladie ont dĂť subir des rĂŠformes. Lâalternative ĂŠtait simple, et les tenants dâune improbable ĂŠtatisation le savaient aussi bien que nous : câĂŠtait, tout simplement, la privatisation du système. Et la porte ouverte Ă de nouvelles et terribles inĂŠgalitĂŠs.
Cette fragilitĂŠ de notre système de protection sociale apparaĂŽt dâautant plus menaçante que les images de la crise ĂŠconomique dans lesquelles nous vivons depuis plus de trente ans ont ĂŠtĂŠ rĂŠactivĂŠes par celles de la mondialisation, du ÂŤ dĂŠclin Âť, des dĂŠlocalisations, mais aussi par les catastrophes et autres attaques terroristes qui ne cessent de dĂŠferler sur nos ĂŠcrans de tĂŠlĂŠvision, imposant la figure dâun monde irrationnel et incontrĂ´lable. Le sentiment diffus dâune ÂŤ insĂŠcuritĂŠ sociale Âť, pour reprendre la formule de Robert Castel, a trouvĂŠ dans les images de ces menaces un miroir dĂŠformant, mais parlant. La fameuse ÂŤ sinistrose Âť française dont parlent les prĂŠfets de 2005 serait lâexpression de cette attente angoissĂŠe que quelque chose arrive. Quelque chose de terrible, bien sĂťr. Ce sont de très vieilles images qui reviennent, des images de fatalitĂŠ - sociale ou naturelle - et des images oĂš la personne, loin de construire sa vie dans lâautonomie et la libertĂŠ de choix, est rĂŠduite Ă la passivitĂŠ craintive de la victime. Lâhorreur ĂŠconomique rejoindrait la terreur fanatique.
Notre sociĂŠtĂŠ du risque est marquĂŠe par un paradoxe. Elle multiplie les procĂŠdures, les systèmes dâalerte et de surveillance, dans une ambition technicienne de contrĂ´le et de maĂŽtrise de tous les risques dâaccidents. Et dans le mĂŞme temps, elle rĂŠinvente le fatalisme que deux cents ans de modernitĂŠ et de progrès social avaient fait oublier.
Il faut se rendre compte que dans un monde dominĂŠ par lâimaginaire du risque, il nâexiste plus de conflits : il nâexiste que des victimes. Celles, impuissantes, du grand capital ou de mĂŠchants cadres harceleurs : câest la posture que nombre de lectures proposent aujourdâhui aux salariĂŠs. Mais quâon y prenne garde, les entreprises ont appris elles aussi Ă jouer les victimes : elles ÂŤ subissent Âť les exigences des actionnaires, de la mondialisation, du marchĂŠ, de la nĂŠcessitĂŠ du changement... ÂŤ Je nây peux rien Âť : tel serait le refrain de cette sociĂŠtĂŠ du risque, lamento fataliste et enfantin qui peut masquer tous les abus. Quel plus grand pouvoir que de se draper dans la posture de la victime ? Celui qui nây peut rien construit une nĂŠcessitĂŠ contre laquelle toute rĂŠvolte est impossible.
La gĂŠnĂŠralisation de la figure du risque pĂŠtrifie ainsi les acteurs et rĂŠduit dâavance toute possibilitĂŠ dâaction. EnvisagĂŠ comme fatalitĂŠ, le risque ne peut ĂŞtre traitĂŠ quâĂ la marge, en aval : on peut rĂŠparer, consoler, dĂŠplorer. Au mieux, rĂŠsister. Mais surtout ne rien faire. Et ne pas sâinterroger sur la nature du système.
La gestion du risque, cet acte de management qui fait aujourdâhui lâobjet dâinnombrables sĂŠminaires et publications, apparaĂŽt ainsi comme une façon particulièrement habile dâĂŠluder la question. De la rĂŠduire, par exemple, Ă sa dimension sanitaire, en nĂŠgligeant de sâintĂŠresser Ă lâorganisation du travail ou aux nouvelles structures industrielles. Les conflits eux-mĂŞmes sont dorĂŠnavant envisagĂŠs comme des ÂŤ risques sociaux Âť, gĂŠrables au mĂŞme titre que les autres, pourvu quâon ait suivi la formation adĂŠquate.
La gestion technicienne et procĂŠdurale du risque participe dâune fascination qui est aussi une tentation de lâimmobilitĂŠ. Celui qui a peur ne rĂŠflĂŠchit pas. Celui qui gère le risque en admet la fatalitĂŠ. Le syndicalisme que nous portons privilĂŠgie depuis longtemps la prĂŠvention, notamment en matière de risques industriels et de santĂŠ au travail, et ce premier numĂŠro rend compte des ĂŠvolutions rĂŠcentes de ces questions. Mais il faut aujourdâhui aller plus loin, en sâinterrogeant sur ce qui se passe en amont. Comment lâexpĂŠrience du risque est-elle redevenue centrale dans le monde du travail ? La rĂŠpartition des risques ne serait-elle pas devenue lâenjeu principal des structures industrielles ? Pour dĂŠpasser la simple gestion du risque, il faut en comprendre lâĂŠconomie.